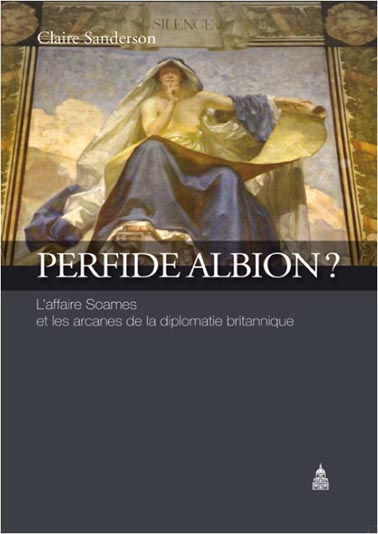
De la mésentente cordiale…
Au début 1969, les relations entre la France et la Grande-Bretagne sont exécrables. Le général De Gaulle a par deux fois mis son veto à l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE, en 1963 et 1967. Les diplomates britanniques guettent des divergences d’opinion au sein de son gouvernement et spéculent sur sa succession. Mais tous ne sont pas d’accord sur la démarche à adopter : le Foreign Office est dominé par des fonctionnaires décidés à affaiblir la France pour l’isoler, et à faire entrer la Grande-Bretagne dans la CEE sans renoncer au lien spécial avec les États-Unis. Lorsqu’en 1968 le premier ministre travailliste Harold Wilson nomme comme ambassadeur à Paris un homme politique et ancien ministre de tempérament qui n’est pas issu du sérail diplomatique, Christopher Soames, dont la francophilie est bien connue, un fossé se creuse qui conduira à l’une des pires crises diplomatiques entre les deux pays.
Soames pense possible un rapprochement bilatéral sur des thèmes larges, comme la coopération monétaire ou militaire. Le Foreign Office rejette toute idée de ce type, y compris si elle incluait l’Allemagne (le rapprochement franco-allemand suscite en effet une forte inquiétude à Londres, où on pense qu’il pourrait aboutir à un accord sur l’arme nucléaire) : on craint qu’elle n’entraîne un affaiblissement de l’OTAN. Lorsque l’ambassadeur rencontre le président français, le 4 février 1969, ce dernier se montre relativement ouvert à des discussions bilatérales, sans pour autant modifier son jugement sur l’américanisme des Britanniques. Cette ouverture est perçue à Londres comme un piège : en cas de rejet par Londres, Paris pourra dénoncer sa mauvaise foi et manque de volonté pour résoudre les problèmes. En cas d’acceptation, des négociations bilatérales pourraient mécontenter les cinq autres membres de la CEE.
… à la crise diplomatique
Pour se sortir de cette mauvaise passe, les responsables du Foreign Office déploient des trésors de perfidie albionesque : les comptes rendus de l’ambassadeur sont modifiés pour faire dire, entre autres, à De Gaulle qu’il souhaite mettre en place un « directoire » sur l’Europe. Ils sont ensuite divulgués au chancelier allemand avant d’être envoyés au gouvernement français, à l’encontre de tous les usages diplomatiques, puis sont transmis à la presse européenne. Soames est tenu à l’écart et découvre, effondré, l’usage qui a été fait de ses télégrammes et la trahison de la confidentialité promise. Le 22 février, l’affaire fait la une des journaux européens et la crise s’aggrave. Mais le Foreign Office se trouve en position difficile : ses agissements suscitent des fortes réticences à Londres même et, dans les jours qui suivent, des détails filtrent sur la manière dont les propos de De Gaulle ont été déformés.
Le prestige des diplomates de Sa Majesté est gravement atteint, Michel Debré se demande si le mot « honneur » ne doit pas être supprimé du dictionnaire anglais, mais De Gaulle n’en tient pas rigueur à l’ambassadeur, dont il déclare : « Pauvre Soames, il a été bien roulé, comme moi » et, dans les mois qui suivent, un rapprochement s’esquisse, qui s’accélère après la démission du général.
Claire Sanderson, professeur à Reims, analyse méticuleusement cette crise, non pour écrire une histoire des relations franco-britanniques, et on peut parfois regretter de ne pas disposer de tous les éléments de contexte, mais pour montrer comme les décisions de quelques individus orientent le cours de l’histoire : en ne transmettant pas ou pas à temps une information, en modifiant un télégramme, en exerçant une pression sur un ministre (même s’il est officiellement leur supérieur), ils font prévaloir leur vision du monde. En ce sens, l’ouvrage relève peut-être plus de la science politique que de l’histoire. S’y ajoute un autre axe : l’analyse de ces traditions du Foreign Office, développée dans un premier chapitre fascinant, qui montre bien comment ont été formés ces fonctionnaires brillants, issus des meilleures public schools et universités du pays, puis dans un épilogue consacré à l’évolution de la diplomatie britannique depuis les années 1970 (poids accru des questions économiques, pression du management…), dont l’articulation avec le sujet est moins nette, mais qu’on lira néanmoins avec profit pour lever le voile sur ce mystère séculaire : comment pensent les Britanniques ?

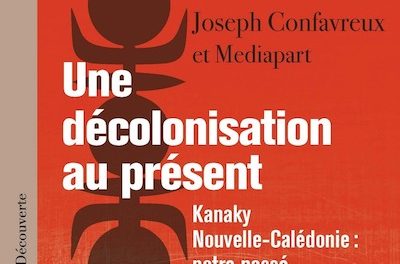

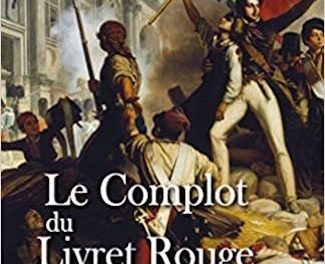










Trackbacks / Pingbacks