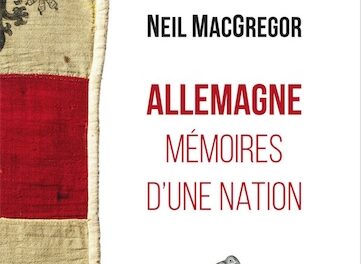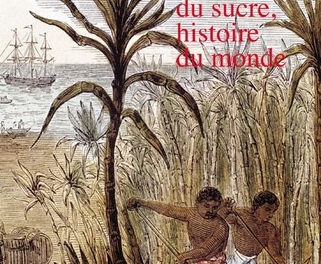En réponse au discours de Dakar voilà un livre de circonstance qui va bien au-delà . C’est à l’ignorance sur l’histoire de l’Afrique et ses réalités actuelles que ce livre est consacré. Des contributeurs d’horizons variés, une vingtaine au total, élaborent un tableau d’études récentes et de synthèses qui dénoncent une vision anhistorique et immobiliste de l’Afrique.
Dans la préface, l’incontournable historien de l’Afrique Elikia M’Bokolo rappelle que les stéréotypes sont ancrés depuis longtemps dans l’esprit de nombreux Français, stéréotypes aux quels Victor Schoelcher, lui-même n’a pas échappé et qu’il y a donc pour les combattre une nécessité de diffuser les connaissances accumulées depuis 50 ans.
Cette œuvre collective est organisée autour de quatre grands thèmes:
Qui a dit que l’Afrique n’avait pas d’histoire?
Un discours d’un autre âge?
Qui est responsable des “difficultés actuelles” de l’Afrique?
Qui a parlé de Renaissance africaine?
Qui a dit que l’Afrique n’avait pas d’histoire?
C’est Catherine Coquery-Vidrovitch qui propose d’entrée de jeu de réfléchir sur la périodisation : de l‘apparition de l’homme à l’Egypte pharaonique, de l’expansion de l’agriculture au contact avec l’Islam, des premiers contacts avec les Portugais à la traite négrière, de la colonisation aux indépendances. Cette périodisation classique est presque extérieure au continent, en particulier du fait de l’ancrage sur les sources écrites arabes et, européennes..Il serait pour l’auteur intéressant de la confronter aux mémoires collectives et donc de recentrer l’histoire de l’Afrique, y introduire une histoire des pensées, des rapports de genre ou bien l’analyse des identités multiples.
Les articles suivants présentent des travaux récents qui viennent illustrer cette question de la périodisation.
Eric Huysecom et Klena Danogo interrogent ainsi le concept de néolithisation. Des fouilles récentes (2006) ont mis au jour des vestiges de céramiques très anciennes (-10 000 ans avt J.C.) qui montrent que la domestication s’est développée associée à la céramique bien avant la sédentarisation et l’agriculture. A partir d’exemples pris dans la boucle du Niger, les auteurs montrent la nécessité d’une méthodologie spécifique pour l’étude des peuples semi-nomades.
A partir du témoignage d’Ibn Battuta, Drissa Diakité, professeur à l’Université de Bamako, analyse le système judiciaire de l’empire du Mali et les valeurs qui y avaient cours: équité, protection des personnes, fussent-elles étrangères, hospitalité, valeurs pas si faciles à percevoir en Europe à la même époque. Plus tard Mungo Park fut impressionné par l’hospitalité et la solidarité dans ses relations avec les populations rencontrées, l’auteur en conclut que ces valeurs ne sont en rien en retrait par rapport aux principes des droits de l’homme plus souvent cités qu’incarnés par les Européens.
Dans cette contribution qui peut intéresser tout particulièrement les collègues qui enseignent en classe de seconde, le socio-économiste et historien de l’Université de Niamey, Boureima Alpha Bado se propose de tordre le cou au cliché du fatalisme du paysan noir sorti tout droit de la littérature coloniale. L’auteur décrit trois stratégies face aux crises de subsistance: la prévention du risque avec les greniers de longue durée bonbattu qui en zarme-songhay signifie “penser à l’avenir”, l’adaptation aux variations climatiques avec, par exemple dans la région de Tombouctou, l’association de trois modes de culture: cultures pluviales (mil, sorgho), cultures de submersion (riz flottant) et cultures irriguées (riz, maïs) et face aux crises conjoncturelles: l’entraide et la solidarité, l’exploitation de ressources spontanées (cueillettes, chasse) ou la migration.
Mais la crise actuelle est d’une autre nature: c’est une crise d’accessibilité.
Dans son article: Le paradigme de l’opposition tradition/modernité comme modèle d’analyse des sociétés africaines, Doulaye Konaté, archéologue et ancien recteur de l’Université de Bamako, appuie sa démonstration sur le concept d’invention de la tradition développé en 1983 par Eric Hobsbawm et Térence Ranger et montre que le lien entre tradition et passé est souvent ténu et figé. Tout au long de l’histoire de l’Afrique on peut observer des situations de remise en cause des structures du passé par exemple lors de la fondation de l’empire du Mali ou encore avec à la veille de la colonisation, l’invention d’une écriture bamoun au Cameroun. Et même l’étude des structures foncières met en évidence des dynamiques dans la gestion du sol et des solutions qui aujourd’hui offrent des pistes face aux contraintes climatiques du Sahel. La modernité apportée, imposée par la colonisation s’est posée en opposition aux situations locales et a souvent contribué à les fixer, pour mieux contrôler comme avec la rédaction des “Grands coutumiers de l’A.O.F.”. La construction d’une modernité africaine est à l’ordre du jour, elle doit s’appuyer, selon l’auteur, sur la reconnaissance de l’altérité.
Un discours d’un autre âge?
Même si coexistent des visions françaises de l’Afrique et des Africains, pour Pierre Boilley, professeur d’histoire contemporaine à Paris 1, une part importante de la population exprime encore une vision stéréotypée dont l’origine remonte aux premiers contacts et au mythe du bon sauvage. Le discours colonial et le “devoir de civiliser” renforcés par les images de famines, de guerres et la notion de droit d’ingérence véhiculées par la presse s’expriment aujourd’hui dans l’afropessimisme .L’auteur montre comment des situations similaires par exemple de crise politique sont analysées de façon totalement différente selon qu’elles ne déroulent en Europe ou en Afrique, il plaide donc pour une large diffusion d’une information réelle sur ce continent.
Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite à Paris 7, nous entraîne dans une lecture critique du musée du quai Branly ou l’occasion ratée de resituer l’Afrique dans une dimension temporelle.
Le refus de savoir est, pour Bogumil Jewsiewicki de l’Université de Laval (Canada), un refus de reconnaissance, il insiste sur le droit pour les Africains de s’interroger sur leur mémoire, d’exprimer leur subjectivité en partant de sa connaissance de la peinture urbaine congolaise sous Mobutu.
Plus directement en phase avec les interrogations d’un enseignant d’histoire, Tayeb Chenntouf de l’Université d’Oran propose une analyse croisée Maghreb / France de l’enseignement du fait colonial. Dans les deux cas, le choix dominant est celui d’une lecture nationale alors même que ces deux histoires sont étroitement mêlées. Sa réflexion s’articule autour de 4 questions:
Quelle chronologie? Faut-il se limiter aux XIX-XXe siècles?
L’usage des concepts de colonisation, d’impérialisme et leurs équivalents en langue arabe.
Quelle didactique: comment simplifier sans dénaturer?
Quelle documentation pour la classe? Quelle place pour le témoignage des colonisés?
Enfin Olivier Le Cour Grandmaison pose la question des usages de l’histoire et de l’identité nationale. Il revient sur un courant politique qui cherche à réaffirmer la grandeur de la France coloniale. Ce spécialiste de sciences politiques montre les mécanismes à l’œuvre: un passé forcément prestigieux puisque ancien, un passé unique pour construire l’idée d’un destin unique et une relecture du passé à la lumière du présent enfin une histoire édifiante comme une suite au “catéchisme impérial” selon l’expression de l’auteur.
Qui est responsable des “difficultés actuelles” de l’Afrique?
Pour Hassimi Oumarou Maïga les esclaves africains ont largement contribué à la mise en valeur du nouveau monde grâce à leur connaissance du monde tropical. Il appuie sa démonstration sur l’introduction réussie de la riziculture en Louisiane à partir de variétés africaines et non asiatiques et de la technique du riz flottant mais aussi sur les apports linguistiques et architecturaux repérables dans cette région des États Unis.
La question des responsabilités africaines dans l’économie de traite est dans l’actualité historiographique, outre deux articles ici, on peut se reporter à l’ouvrage de Tidiane Diakité, La traite des Noirs et ses acteurs africains du XVe au XIXe siècle. http://www.clionautes.org/?p=2156)
Kinvi Logossah qui enseigne aux Antilles revient sur ce phénomène complexe comme il le reconnaît, il insiste pourtant sur l’action des Portugais dans les débuts de l’esclavage et de la traite, sur les résistances africaines en Sierra Léone et en Guinée. Pour lui la traite a imposé à l’Afrique une spécialisation dans la production de main-d’ œuvre servile et contraint les royaumes côtiers à y participer.
Dans l’article suivant : esclavage et traite, entre mémoires et histoires, Ibrahima THIOUS de l’Université de Dakar montre l’impérieuse nécessité de sortir d’une lecture “raciale” du phénomène qui évacue trop facilement les facteurs internes à l’Afrique. Il montre que les groupes les plus soumis au risque d’esclavage étaient aussi les groupes exclus du pouvoir. Il plaide pour une écriture de l’histoire de chaque groupe pour éviter tout détournement mémoriel et regrette que les travaux sur l’esclavage domestique soient trop peu nombreux et peu connus comme ceux de Mamadou Saliou Baldé sur le Fouta Djalon. Si les lectures plurielles de la traite qui se sont multipliées sont nées de la volonté de rompre avec le discours colonial, cette historiographie qui a mis en relief le rôle des sociétés de commerce et l’impact négatif de la traite a trop occulté, selon lui, les responsabilités africaines. Il est important de revenir sur d’autres études comme celles de Boubacar Barry à propos de la Sénégambie qui restitue une diachronie et des variables spatiales, un regard critique indispensable à la compréhension d’un phénomène complexe.
John O. Igué pose la question du rôle de la colonisation dans “l’immobilisme” des sociétés africaines, son approche est plus géographique, discipline qu’il enseigne à l’Université de Cotonou. Il décrit les grandes lignes du développement économique d’un ensemble écologique aux potentialités contrastées de la période pré-coloniale à nos jours: une inégale mise en valeur, des densités très variées, un monde confronté, au moment de la colonisation, à la désorganisation avec recul de l’autorité traditionnelle, apparition de frontières séparant des groupes autrefois organisés comme les Haoussa et migrations forcées de travailleurs.
De 1920 à 1946 la mise en valeur de l’actuel Benin n’a pu être réalisée sans l’apport de capitaux de la métropole et dans son intérêt: construction du réseau ferré, agriculture mono exportatrice du palmier à huile. Pour le Beninois Sébastien Dossa Sotindjo le financement des économies africaines par le financement étranger conduit à reproduire la dépendance : culture de rente même si on assiste à une petite diversification avec l’introduction du coton et exportation de produits semi-ouvrés.
Enfin Daouda Gary-Tounkara analyse le régime politique ivoirien longtemps dominé par Felix Houphouët-Boigny : petite paysannerie du café et du cacao, nationalisme et “ivoirité”, mécanismes largement à l’oeuvre dans la crise politique actuelle.
Qui a parlé de Renaissance africaine?
Existe-t-il une pensée philosophique africaine? Telle est la question au coeur de l’article de Sandra Fagbohoum. La crise politique, la réflexion anti-coloniale ont, de son point de vue, occulté toute la réflexion sur le rapport à la modernité, les cultures locales entre croyances et raison, la philosophie et les mythes dont l’importance a été affirmée par Marcel Mauss.
Isidore Ndaywel E Nziem analyse le projet sarkozien d’Union pour la Méditerranée qui occulte le vrai débat sur les migrations Sud-Nord. C’est un projet, pour reprendre le vocabulaire proposé par Ki Zerbo en 2003, de mondialisateurs pour des mondialisés. Face à ce projet qualifié de néo-colonialiste, il regrette l’abandon d’un outil potentiellement efficace: la francophonie.
Derrière l’affirmation : le Sahara n’est pas une frontière, Djehar Sidhoun Rahal veut montrer qu’il existe des parentés culturelles à l’échelle du continent, issues d’un fond paléo-africain centré sur le Sahara et un même destin de domination étrangère européenne ou orientale (romaine, arabe, ottomane). C’est la traite puis la colonisation qui ont inscrit une rupture entre nord et sud du Sahara, entre Afrique blanche et Afrique noire en imposant ce que l’auteur nomme une racialisation et une hiérarchisation encore à l’oeuvre si on compare les discours du président Sarkozy à Constantine et à Dakar.
Une Renaissance africaine suppose la construction d’une intelligentsia malgré la pauvreté et la question des langues nationales, le sociologue Alioune Sall considère que l’Afrique dispose d’atouts: une jeunesse nombreuse et une diaspora active, des ressources naturelles et des richesses culturelles, ainsi qu’un tissu associatif vecteur d’une nouvelle citoyenneté : vers les Peuples unis d’Afrique, une approche qui peut s’inspirer des idées avancées dès 1958 par Nkumah.
La dimension politique, une démocratie à l’africaine, c’est la conclusion proposée par Adame Ba Konaré, ex-première dame du Mali qui a coordonné cet ouvrage, à partir de l’expérience de son pays depuis la destitution de Moussa Traoré et la mise en place d’une vie démocratique reposant sur la recherche de points d’appui dans les structures traditionnelles du pouvoir. Elle évoque les différents régimes étatiques dans l’histoire du pays, montre une continuité dans la perception du rôle attendu du souverain, du président, garant de la sécurité et de la prospérité et les écueils d’un système de solidarité de proximité qui peuvent conduire à la corruption. Elle propose de repartir de la “charte du Mandé” recueilli en 1965 par l’ethnologue Youssouf Tata Cissé pour construire une culture du bien vivre ensemble.
Une bibliographie classée, en rapport avec chaque contribution clôt ce livre foisonnant, enrichissant et qui montre la vitalité des intellectuels africains.