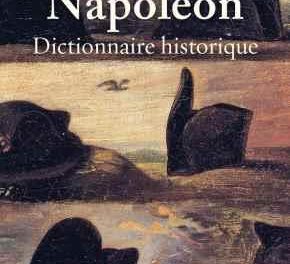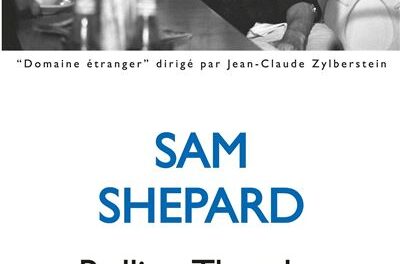Le numéro 135 de la revue Politique africaine, éditée aux éditions Karthala, s’ouvre sur un très dense dossier portant sur les politiques de la nostalgie, coordonné par Guillaume Lachenal et Aïssatou Mbodj-Pouye. En introduction ceux-ci reviennent sur les grandes interrogations épistémologiques de la recherche autour de la question de la nostalgie en Afrique, thématique large, invitant à examiner le paysage politique et affectif du continent et de ses populations, où s’entremêlent les temporalités et les discours nostalgiques d’un « âge d’or », qu’ils s’agissent du temps colonial, des indépendances ou des révolutions socialistes. Ces discours nostalgiques se développent sur un terreau propice, celui du déclassement des années 1990, marqué par le virage libéral des politiques publiques en Afrique. Sur ce point les coordinateurs rappellent l’importance des travaux pionniers de James Ferguson sur la désindustrialisation dans la Copperbelt, qui ouvrirent la voie à une « ethnographie du déclin » et de nombreuses études variant les espaces et les échelles.
Rob Ahearne, « Le développement ? C’est du passé » Une lecture historique des récits du progrès dans la Tanzanie du Sud
Le premier article du dossier, rédigé par Rob Ahearne, porte sur l’historicisation des récits du progrès dans la Tanzanie du Sud. Basé sur des récits de vie récoltés en Tanzanie du Sud auprès des wasee (anciens en Swahili), l’article de Rob Ahearne entend offrir une nouvelle lecture de l’historiographie tanzanienne à l’aune de la question du développement.
A ce titre, la déclaration d’Arusha, qui pose les bases de la politique économique et sociale de la Tanzanie pour les deux premières décennies post-coloniales, tient un plus grand rôle dans l’histoire du pays que l’indépendance elle-même. Elle marque le commencement de la villagisation, vaste réorganisation de la vie locale basée sur l’incitation au regroupement des populations rurales dans des villes nouvelles ou des communes plus importantes. Pensée sur le volontariat, la villagisation est rapidement devenue au cours des années 1970, à mesure que le régime socialiste de Julius Nyerre s’enfonçait dans l’autoritarisme, une obligation. Ce processus marqua profondément les populations touchées, qui perdirent une grande partie de leurs biens dans le processus. Elle fut de plus un échec économique retentissant : loin d’apporter l’autosuffisance souhaitée, elle fit du pays le premier importateur de produits agricoles au cours des années 1970.
Rob Ahearne note ainsi la rupture nette que représente, dans les témoignages recueillis, la villagisation. Bien qu’ayant aucun lien direct avec l’indépendance elle-même, les témoignages recueillis tendent à combiner les deux évènements, nourrissant de la sorte une représentation du temps passé marquée très nettement par une dégradation de la situation économique et un déclassement.
Il en va de même pour le programme arachide. Porté par les autorités britanniques à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, celui-ci est généralement perçu, d’un point de vue européen, comme un échec cuisant. Pour autant les récits recueillis tendent à relativiser ce point de vue. Le programme arachide, par les nombreuses infrastructures qu’il apporta à la Tanzanie du Sud (notamment le chemin de fer) et les emplois liés, fut perçu comme une opportunité de développement, offrant aux habitants les moyens de travailler, de se déplacer ou du moins d’acquérir les connaissances agricoles nécessaires au développement. A l’inverse de la situation présente perçue, à la lumière du progrès associé au passé, comme une époque de profonde dégradation des infrastructures disponibles (outils agricoles, moyens de communication).
Johan Lagae, Kim De Raedt et Jacob Sabakinu Kivulu, « Pour les écoles : tant mieux qu’elles sont là ». Patrimoine scolaire, pratiques mémorielles et politiques de la sauvegarde en République Démocratique du Congo
Le second article, rédigé par Johan Lagae, Kim de Raedt et Jacob Sabakinu Kivulu, porte sur le patrimoine scolaire, les pratiques mémorielles et les politiques de sauvetages en République Démocratique du Congo. Prenant pour point de départ l’ouvrage du Père Martin Ekwa bis Isal L’école trahie, déplorant la dégradation des conditions matérielles de l’éducation en RDC, les auteurs entendent aborder la question du développement par l’éducation en RDC et des politiques de patrimoine autour des complexes scolaires hérités de la période 1945-1975 et porteurs alors d’un message de progrès et de développement colonial et post-colonial.
En effet, devenu dans les années 1940 une priorité des politiques coloniales belges, la politique d’enseignement souffre néanmoins à l’indépendance d’un manque cruel d’infrastructures (la première université congolaise n’est fondée qu’en 1954). Le pays se lance à l’indépendance dans de vastes chantiers de constructions de complexes scolaires. Ceux-ci frappent par leur architecture moderniste et soignée, porteuse de progrès et d’optimisme. L’état vétuste dans lequel se trouvent aujourd’hui nombre de ces écoles, ces « ruines de modernité », nourrit d’autant plus la nostalgie d’un temps de progrès et de développement pour les anciens colonisés, et la « mélancolie coloniale » des anciens colons. La culpabilité grandissante des autorités congolaise face à l’état de délabrement des complexes en question a donné naissance au projet des Cinq Chantiers du président Joseph Kabila, dans lequel la réhabilitation des ces bâtiments figure. A ce titre les auteurs prennent l’exemple du lycée Kiwele de Lumumbashi, qui fut l’objet des attentions des politiques de sauvegarde, et des conséquences sociales et politiques de tels projets, à différentes échelles.
Ces écoles furent aussi des lieux de mémoire et à ce titre ont été réappropriés par les mémoires congolaises. Ainsi est cité l’exemple du lycée Lubusha de Luishia. Ecole d’excellence, fondée en 1948 sur le site d’une ancienne mine, l’école fut l’objet d’une vaste mobilisation des anciens élèves en 2007 lorsqu’un projet de réouverture des mines fut envisagé. Le troisième exemple abordé par les auteurs est l’école pour filles de Kimwenza, ayant bénéficié des soins des organisations religieuses, ce qui fut le cas pour cette école.
Ferdinand de Jong et Brian Quinn, Ruines d’utopie : l’école William Ponty et l’Université du Temps Futur
Le troisième article du dossier, rédigé par Ferdinand de Jong et Brian Quinn, aborde l’école William Ponty et l’Université du Temps Futur. Intéressé par la question de la modernité et de la place des ruines dans ce processus, les deux auteurs entendent discuter la condition de la modernité africaine à travers les ruines, et notamment de l’école William Ponty et du projet de l’Université du Temps Futur au Sénégal.
Les deux écoles se croisent dans leurs spatialités. En effet le projet d’université du président Wade fut localisé à Sébi Ponty, à quelques trente kilomètres de Dakar, sur les lieux où fut fondée un siècle plus tôt l’école William Ponty dont il fut pensionnaire. Il s’agissait alors pour lui de faire renaitre l’ambition d’un avenir africain prospère et panafricain, sur les lieux où fut formée l’école coloniale française. Les deux auteurs reviennent sur le choix de localisation de l’école Ponty à Sédi Ponty. Celui-ci répondait à une évolution du paradigme colonial : de la politique d’assimilation la France évoluait, dans une volonté de mettre à profit ses colonies, vers la politique d’association : les africains, éduqués, devaient néanmoins demeurés dans leur identité « indigène » : la localisation de l’école permettait ainsi de développer l’enseignement agricole et manuel.
Au sortir de l’indépendance, et du déclin de l’école, les anciens élèves préservèrent l’héritage élitiste de l’école, dans leurs souvenirs mais aussi par un vaste réseau professionnel et amical, sur lequel Wade entendait fonder son université panafricaine, en redéployant la mémoire du passé colonial, dans un souhait de régénération de l’Afrique. Lancé en grandes pompes et pensé comme l’équivalent des plus grandes universités mondiales à l’échelle du continent africain, le projet avorta, fautes de financement, stoppant quasiment du jour au lendemain le projet de construction, qui demeure inachevé.
Ainsi, par l’appropriation des lieux sur des bases mémorielles, afin de servir de fondations à un projet panafricain, Sébi Ponty est devenu « le palimpseste des futurs où se superposent les ruines à des degrés divers ».
Charles Piot, Fin des temps et nouveaux départs. Un schème de Ponzi dans le Lomé des années 2010
Le quatrième article, rédigé par Charles Piot, porte sur un schème de Ponzi dans le Togo des années 2010. Revenant dans un premier temps sur l’histoire du pays, Charles Piot rappelle la rupture que marqua la fin de la guerre froide pour le pays. Devenu un pays d’intérêt stratégique secondaire pour la France et les Etats-Unis d’Amérique, le pays plongea dans une grave crise économique, accentuée par la dévaluation du franc CFA de 50% en 1994. Cette période favorisa le développement d’une culture et d’un imaginaire de l’exil, physique mais bien souvent par le jeu, les cyber-cafés ou aussi la foi (explosion des cultes pentecôtistes).
C’est dans ce contexte que le programme d’enrichissement personnel ReDéMare (Réseau pour le Développement de la Masse sans Ressources) vit le jour. Promettant un rendement de 200%, en nature ou en liquidité, ce programme gagna en audience au cours de la campagne électorale. Bien que les rumeurs les plus folles couraient à son sujet (l’argent viendrait de Khadafi), le programme poursuivit sa croissance, jusqu’à toucher 50 000 personnes à Lomé et ses environs. Le gouvernement ordonna la fermeture finalement en juillet 2010, provoquant le tollé : personne n’avait perdu d’argent, le programme tenait ses objectifs, et remplissaient les missions que l’État n’assurait plus. Au cours de l’année 2012 un programme similaire, le Marché de Crédit en Nature Pérenne (MCNP) fut ouvert et rencontra le même succès que ReDéMare.
Charles Piot note que l’engouement pour ReDéMare revêt un sens particulier dans le Togo d’alors : en effet ReDéMare, qui n’est autre qu’un système de Ponzi, apparait aux togolais comme un moyen de pallier aux dévaluations successives de la monnaie et des valeurs depuis 20 ans. De plus, la philosophie même de la pyramide de Ponzi (emprunter à l’un pour payer l’autre) s’inscrit dans les logiques économiques locales où la dette doit circuler. Offrant la possibilité de transformer le présent en un futur plein d’espoir, le schéma de Ponzi s’inscrit dans les mêmes désirs sur lesquels les mouvements pentecôtistes ont pu se développer : les désirs qui confinent à une certaine nostalgie du futur, celle d’un temps où la tromperie n’était pas la règle, où l’État assurait ses missions et où la pérennité des valeurs était assurée.
Nancy Rose Hunt, Espace, temporalité et rêverie : écrire l’histoire des futurs au Congo belge
Le cinquième article, rédigé par Nancy Rose Hunt, aborde la question de l’espace, de la temporalité et de la rêverie dans l’écriture de l’histoire des futurs au Congo belge. Revenant sur ses propres recherches passés sur les débris colonial dans l’histoire du pays, l’auteur entend s’éloigner de celles-ci pour questionner de nouvelles archives à l’aune du concept de « rêverie » dans une heuristique y mêlant les concepts « d’espace d’expériences » et « d’horizon d’attente ». Le but est ainsi de faire ressortir les rêves éveillés des populations et d’en étudier les tensions et les temporalités variées.
La première approche de l’auteur se focalise sur les mémoires de la violence coloniale, à travers le concours littéraire de 1953 du missionnaire Boelaert portant sur les décennies dites du « caoutchouc rouge ». La plupart des témoignages font ressortir la violence extrême de la période. Une particularité alors des témoignages est le refus de se remémorer le malheur seul. Plusieurs contenaient des oublis volontaires, des réticences à raconter et rédiger les évènements pour des blancs. Au-delà de tous les exemples cités par l’auteur ressort une appropriation de l’occasion pour s’adonner aux souvenirs et aux rêveries, sans supposer ni dénoncer le trauma de la période.
Dans un second temps l’auteur s’arrête sur la notion des nganda, lieu de refuge dans la période coloniale, d’autant plus dans les années 1930, alors que le maillage colonial progressait et se densifiait. Ceux-ci devinrent rapidement des lieux d’évasion de l’ennui de la vie villageoise codifiée par les autorités coloniales.
Dans ces espaces préservés se développa la rêverie d’éviction, le songe d’un futur victorieux où les congolais auraient expulsé les belges, comme en témoigne les interrogatoires de police. Incapable de comprendre ces rêveries, les autorités coloniales belges intensifièrent leur appareil sécuritaire et répressif.
David Bozzini, Surveillance, répression et construction collective de l’insécurité en Érythrée
Le sixième article, rédigé par David Bozzini, aborde la question de la surveillance, de la répression et de la construction collective de l’insécurité en Érythrée. En abordant le dispositif de surveillance des conscrits, l’article aborde les dynamiques sociales et politiques de l’État despotique en question. En effet le fonctionnement imparfait de la bureaucratie et l’arbitraire des contrôles développent la peur et la suspicion entre citoyens. L’atomisation sociale obtenue assure alors la pérennité du régime et des élites qui le dirige.
Revenant dans un premier temps sur la naissance de l’État érythréen dans les années 1990, l’auteur met particulièrement en avant l’importance de la mobilisation militaire mise en place en 1994 et dont la période de service s’étire indéfiniment depuis la guerre contre l’Éthiopie en 1998. Dès 2002 cette mobilisation devient le pilier central du pays, illustrant sa militarisation croissante et s’apparentant à du travail forcé. De plus les droits pleins et entiers de citoyens étant assurés à l’issue du service, les milliers d’érythréens mobilisés ne peuvent bénéficier de ces droits et sont contraints dans leurs études et leurs emplois par l’État. Face aux désertions massives, la surveillance des conscrits prend des proportions colossales. L’illustration la plus probante demeure les nombreux checkpoints se multipliant sur les routes. Pour autant les désertions demeurent massives, et l’État ne souhaitent pas davantage les restreindre. Celles-ci assurent un turnover qui garantit à l’État de ne pas voir la masse de personnes sous sa charge s’agrandir indéfiniment, et des rentrées économiques substantielles avec les envois de fond depuis l’étranger.
A l’échelle des villes les rafles policières en direction des conscrits se multiplient : alors que chaque appelé doit disposer d’une carte d’identité, le service chargé de la question n’existe tout simplement pas. Ces manquements bureaucratiques créent une peur permanente de la rafle et des tensions quotidiennes sur les individus concernés. Ainsi quelles stratégies les jeunes érythréens touchés mettent-ils en place pour contourner cette insécurité ? La fraude constitue la solution la plus usitée, d’autant qu’elle reste très simple (simple papier à en tête pour assurer un laissez-passer). Néanmoins beaucoup refusent d’y avoir recours, craignant une contre-offensive éminente du pouvoir. En plus de la violence physique, le système de contrôle distille une violence sourde, faite d’anticipation et de crainte d’un futur coup de filet. Cette peur se trouve renforcée par la peur de la délation, à des fins personnelles, et de la surveillance généralisée de la population. Cette crainte frappe durement les interactions sociales les plus simples.
Si l’État érythréen tenta de moderniser son système de surveillance afin de le rendre plus efficace, cela fut un échec. Ceci eut pourtant des conséquences positives pour lui. En effet cette crainte généralisée pousse les citoyens à croire l’appareil répressif plus efficace qu’il ne l’est.
Lotje de Vries et Peter Hakim Justin, Un mode de gouvernement mis en échec : dynamiques de conflit au Soudan du Sud, au delà de la crise politique et humanitaire
Le septième article de ce numéro, rédigé par Lotje de Vries et Peter Hakim Justin, porte sur les dynamiques de conflit au Soudan du Sud. Prenant pour point de départ le début de la guerre civile sud-soudanaise du 15 décembre 2013, les auteurs entendent mettre en avant le rôle du mode de gouvernance dans la crise et l’absence de dialogue entre les autorités du pays et les citoyens à propos du type de gouvernance désiré.
Dans une première partie les auteurs reviennent sur la chronologie des faits, des premières violences du 15 décembre 2013 au processus de paix du 9 mai 2014. Les racines de la crise sont lointaines et remontent à l’accord de paix global signé en 2005 avec la République du Soudan. Le SPML, mouvement rebelle armé sud-soudanais, doit alors entamer sa transition vers la sphère politique. Souhaitant ouvrir le gouvernement et l’armé à d’autres milices et mouvements opposés, le leader du SPML Salva Kiir, assura une paix relative jusqu’aux élections de 2010 et la réouverture des tensions entre groupes politiques. Soucieux de s’assurer le contrôle du gouvernement et la stabilité des institutions, celui-ci prit des décisions à la limite de ses prérogatives et usa de la persuasion et de la menace pour faire adopter une Constitution renforçant ses pouvoirs. Ce renforcement progressif et cette concentration des pouvoirs, issues des années de lutte du SPML, constituent des freins au progrès.
En effet les consultations citoyennes, prévues durant la période de transition sur les institutions, furent remises en cause par les dirigeants du SPML, cumulant les pouvoirs et souhaitant un Etat centralisé là où la tentation fédérale était puissante. Si celle approche est revenue sur le devant de la scène avec la crise politique du pays, les auteurs mettent en lumière, dans la conclusion de leur article, la fausse solution que constitue le fédéralisme, en ce sens qu’elle substitue une forme de gouvernent à la question du mode de gouvernance, demeurée celle de la guerre d’indépendance.
Elena Vezzadini, Créer des étrangers : lois de citoyenneté de 2011 aux Soudans et désirs d’Etat pour une nationalité ethnique
Enfin le dernier article de ce numéro, rédigé par Elena Vezzadini, aborde la question des lois de citoyenneté de 2011 aux Soudans. L’auteur revient sur l’une des préoccupations majeures au sortir de la guerre civile soudanaise : la question des « réfugiés » sud-soudanais qui doivent « rentrez chez-eux ». Cette préoccupation pose la question de la citoyenneté, toujours complexe lorsque se constituent des États-nations. En promulguant des lois sur la citoyenneté posant l’appartenance nationale sur des bases ethniques, les deux États ont rendu de facto apatrides des millions d’individus.
Dans un premier temps l’auteur revient rapidement sur l’histoire du Soudan, depuis la colonisation britannique jusqu’aux prémices de la guerre civile. Celle-ci débute en 1957 lorsque les nationalistes soudanais refusent de reconnaitre les spécificités culturelles du sud dans la nouvelle nation. C’est à cette époque que la première loi sur la citoyenneté est prise, assurant la nationalité par droit du sang et du sol (10 ans avec une connaissance de la langue arabe, 20 ans dans le cas contraire). A l’issue d’une période de paix de dix ans, la guerre civile reprend en 1983 avec l’arrivée des islamistes au pouvoir. C’est sous leur gouvernance pourtant que la loi sur la citoyenneté sera amendée. Une dernière grande réforme du droit sur la citoyenneté sera entreprise durant la période de transition vers le référendum. Dans le but de définir le corps électoral du référendum à venir, les autorités soudanaises posent une définition ethnique des sud-soudanais, appelés à voter. Dans le même temps la République du Soudan modifie profondément son droit à la citoyenneté en la retirant à toute personne pouvant prétendre de facto à la nationalité sud-soudanaise, même en dehors de toute démarche de sa part.
Cette approche n’est pas sans poser de nombreuses questions de droit, notamment dans la définition même de « communautés indigènes » qui figure au centre de la loi sur la citoyenneté sud-soudanaise. Quels sont les contours des « communautés indigènes » qui constituent le Sud-Soudan ? De même, sur le plan pratique, le système mis en place pour l’obtention des documents de nationalité complique énormément les choses (un seul bureau délivre les documents de nationalité sud-soudanais pour les deux pays).
Les plus durement frappés par ces politiques furent les sud-soudanais ayant fui dans les années 1960 la misère au sud, pour gagner les terres riches du nord, et leurs descendants. Ceux-ci deviennent, avec les nouvelles lois, du jour au lendemain, des étrangers. La rédaction du droit soudanais tend ainsi à essentialiser les individus et en niant les échanges nombreux et forts anciens entre les deux parties de l’ancien pays.