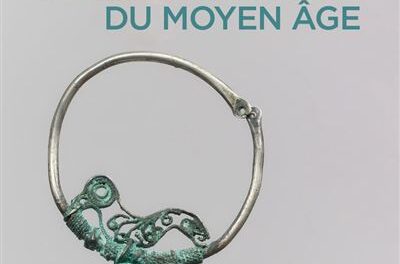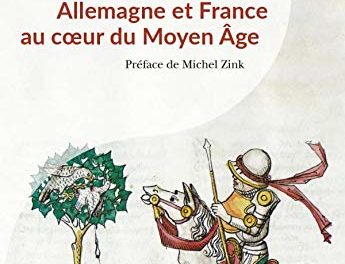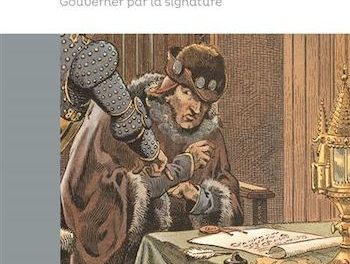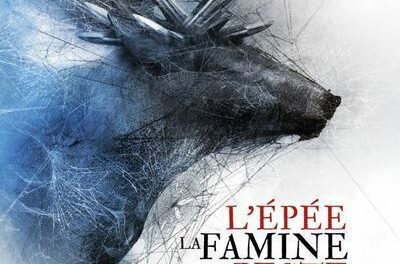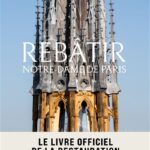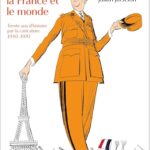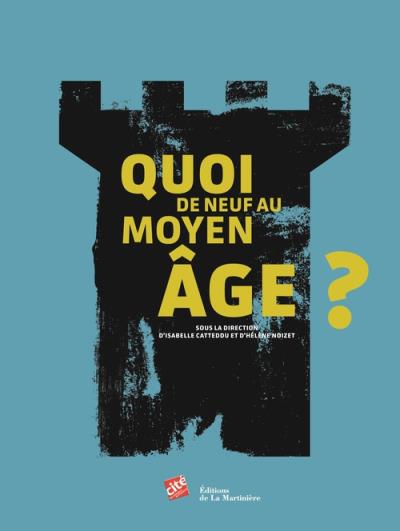
Coup de balai sur les vieilles idées sur le Moyen Age
Une nouvelle exposition de la Cité des Sciences vient d’ouvrir, intitulée « Quoi de neuf au Moyen-Age ? ». Elle donne lieu à un très utile catalogue d’exposition. Cette réalisation menée en lien avec l’Inrap, est en quelque sorte une synthèse du renouvellement d’approche sur cette période. Depuis une dizaine d’années en effet, plusieurs livres ont mis en lumière un Moyen Age autre, repensé, débarrassé de vieux attributs. A ce titre, on peut citer le livre de Joëlle Burnouf « Archéologie médiévale en France XIIe-XVIe siècle » ou celui écrit en collaboration avec Isabelle Catteddu en 2015 et intitulé « Archéologie du Moyen Age ».
Des thématiques et des éclairages
Le livre propose onze parties subdivisées en chapitres qui n’apparaissent malheureusement pas dans le sommaire. A chaque début de chapitre, un visuel parle de la chronologie du thème qui va être abordé. C’est l’occasion de montrer qu’il faut varier les temporalités car on s’aperçoit bien en les juxtaposant combien les charnières sont différentes selon les thématiques. A la fin de chaque grande partie, un éclairage est proposé en lien avec aujourd’hui. Ainsi, après le chapitre sur « Les débuts du Moyen Age », l’éclairage contemporain est le fait de l’artiste plasticien François Lelong qui évoque son rapport au Moyen Age et, notamment, combien les bestiaires médiévaux ont été une source d’inspiration pour lui. On dispose d’une bibliographie à la fin des chapitres. Les auteurs du catalogue insistent également sur une iconographie riche, souvent inédite, qui apporte donc sa part au renouvellement sur le sujet.
Retour vers le Moyen Age
Jean-Luc Boudartchouk et Isabelle Catteddu posent d’abord le fait que de nouveaux découpages chronologiques sont aujourd’hui envisageables et, à ce titre, l’archéologie joue un rôle majeur, invitant à se débarrasser des scansions habituelles du Moyen Age. On irait d’ailleurs plutôt vers deux que trois Moyen Age, avec le douzième siècle comme charnière. Cette remise en cause doit être aussi spatiale et les articles invitent à multiplier les échelles d’observation. Une carte issue des travaux de Christian Grataloup suffit d’ailleurs à prouver les connexions qui existaient dans ce monde médiéval.
Les débuts du Moyen Age : entre héritages et apports nouveaux
Ce chapitre décrypte un thème souvent objet de fantasmes qu’on appelait « les invasions barbares ». Or, tous les travaux montrent aujourd’hui qu’il s’agit de migrations. Des « barbares sont installés avant le Ve siècle en toute légalité dans l’Empire car ils assument ou encadrent la défense intérieure ». Les auteurs proposent ensuite plusieurs focus sur des peuples comme les Goths ou sur des zones comme le Sud de la Gaule. « Les travaux récents montrent la grande hétérogénéité des migrants germaniques et non germaniques et leurs divers itinéraires ».
Des environnements, des climats et des hommes
Les recherches archéologiques insistent sur l’optimum médiéval et le petit âge glaciaire, notions pressenties depuis longtemps par Emmanuel Leroy Ladurie. Le chapitre s’intéresse aux impacts de ces variations climatiques. Il remet en cause également certaines idées reçues sur la forêt. C’est un domaine entretenu, réservé et réglementé. Il évoque également les étangs, ce qui permet de constater qu’il y avait déjà à l’époque des phénomènes de surpêche.
Les campagnes : des lieux de vie dynamiques et privilégiés
Sur ce sujet également, les connaissances évoluent car pour le premier Moyen Age les documents étaient peu nombreux et étaient constituées par exemple de polyptiques, c’est-à-dire d’inventaires détaillés des biens du fisc royal et des grandes abbayes. Le chapitre traite également de la grande diversité du paysage médiéval. Il faut savoir que souvent l’élevage échappait aux sources. Les archéologues ont aussi montré depuis plusieurs années la multiplication des moulins ce qui a permis une économie de main-d’œuvre tout en améliorant la mouture et l’alimentation. S’il faut réfléchir à des dates charnière, il faut mettre en avant le milieu du VIIe, milieu du VIII ème qui représente un tournant tout comme le Xe siècle. A partir du XIIe siècle, la croissance rurale est soutenue. On utilisera avec profit ces données en seconde si on choisit d’aborder les sociétés rurales. Une autre partie s’intitule « Ouvrer et besogner au Moyen Age : à l’atelier à l’usine » et rappelle qu’un habitant sur dix est un artisan, même s’il conserve une activité agricole. Les travailleurs ne sont pas figés dans une réalité immuable. Les auteurs évoquent les produits qui ont fait l’objet d’une industrie et invitent à dépasser le simple cas de la laine.
L’émergence de la ville au Moyen Age
Ce chapitre pourra servir si on choisit l’autre exemple possible en classe de seconde autour des sociétés urbaines. Il faut là aussi revoir nos façons de penser car trop souvent, et trop longtemps, on a examiné le fait urbain à la lumière de ce qu’il fut à partir du XIII ème siècle. Avec un tel regard, les périodes précédentes apparaissaient comme toujours moins développées. A partir du XIVe siècle, la conception de l’espace urbain change. Auparavant fondamentalement polynucléaire et organisé en réseaux, celui ci tend à se singulariser comme un lieu doté de sa propre unité et à se territorialiser en devenant un espace continu ». Si l’on devait encore citer un exemple d’évolution de nos connaissances, on peut citer ce qu’on appelle les « terres noires ». Elles furent longtemps considérées comme des preuves de l’abandon des villes, alors qu’elles sont aujourd’hui comprises au contraire comme des « marqueurs de la densité urbaine ». En effet, ces couches sont en fait le résultat de l’accumulation des déchets produits par les habitants.
Architecture et décor du IVe au XVe siècle
Dans le coup de balai général, les auteurs invitent également à se séparer de la division entre « roman » et « gothique ». Ils insistent ensuite sur les facteurs dont dépendent les projets architecturaux : la culture du commanditaire et son exigence intellectuelle, les moyens financiers, le bâtiment et sa fonction. Au Moyen Age, les hommes sont « sociologiquement chrétiens » comme dit Jean Delumeau. La religion n’est pas une affaire personnelle, elle est un fait de société. Plusieurs pages sont consacrées au culte des saints et des reliques. On pourra poursuivre par le chapitre « Les vivants et les morts » qui souligne combien les morts étaient proches des vivants. Les auteures insistent sur le dépôt d’objets dans la tombe sous forme d’accessoires vestimentaires.
Du monde à l’homme
Plusieurs pages sont consacrées à la médecine ou à la géographie. Joël Chandelier et Emmanuelle Vagnon rappellent que les mappemondes étaient des œuvres d’information et de culture, et pas des instruments pour le quotidien. Les voyageurs n’emportaient pas ces cartes avec eux dans leurs expéditions. Ils parlent de l’école de médecine de Salerne qui, vue sa position géographique, se trouvait au contact du monde islamique et bénéficiait aussi des traductions de textes arabes et grecs effectuées en Italie.
Médecine et géographie sont à la fois les témoins d’un intérêt pour le savoir, tant théorique que pratique, mais aussi d’un dynamisme de la science médiévale. Le chapitre « Rythmes du monde au Moyen Age » invite à décloisonner géographiquement notre approche du Moyen Age. On pourra citer un fait très frappant : quand les Francs frappent des monnaies d’or ou d’argent, ce sont des imitations des dinars et dirhams.
Pour conclure, on peut rassembler le dernier chapitre du livre et la conclusion qui montrent « un Moyen Age entre exotisme et héritages ». De façon très logique, l’ouvrage se termine sur notre façon d’envisager le Moyen Age et sur ses usages. « Nous sommes moins des héritiers du Moyen Age que des recycleurs ». Joëlle Burnouf et Joseph Morsel précisent que les objets parlent de notre société mais indirectement, et c’est le même type de raisonnement qu’il faut adopter pour ceux qui viennent du Moyen Age.
Il s’agit donc d’un ouvrage indispensable qui permet d’actualiser ses connaissances sur le Moyen Age. Il permet surtout de remettre en cause des grandes idées figées, mais il propose aussi de nombreux éclairages qui peuvent être autant d’exemples utilisables dans un cours de seconde. Il faut aussi signaler le site-relais de l’exposition tout à fait utilisable par des élèves.