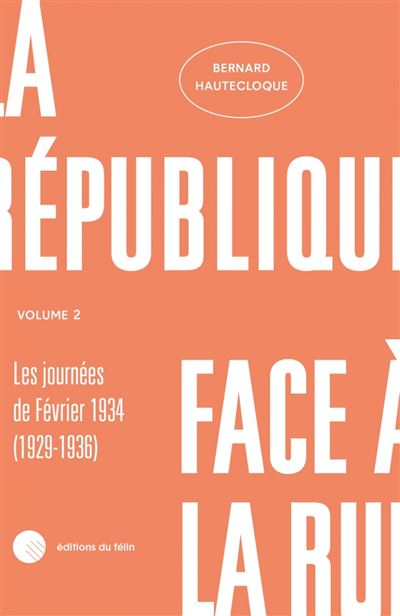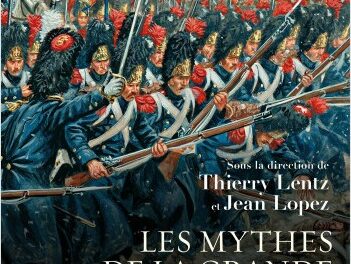Dans ce second volumeVoir te 1er volume : La République face à la Rue. Volume 1, De la Commune à la Grande Guerre (1871-1914), publié en début d’année, d’une série d’ouvrages consacrés à l’histoire du maintien de l’ordre en France de 1871 à 1968, l’auteur s’intéresse à la période qui va de la crise de 1929 à la victoire du Front populaire en 1936. Cependant, le sujet central de son étude a trait aux journées de février 1934.
La France des années 30 et les forces en présence
Sortie victorieuse du premier conflit mondial, la France des années 1933-1934, même si elle n’est pas aussi durement impactée par le krach de Wall Street que l’Allemagne de Weimar ou de l’Italie, subit plus tardivement cette crise.
Dans une France archaïque, sclérosée économiquement et à bout de souffle politiquement, les mécontentements se multiplient. Les extrémistes de droite et de gauche abhorrent la forme républicaine du pouvoir. Aussi usent-ils de violence comme seul moyen d’expression ou de pression.
Ultime rempart au maintien des institutions républicaines, les forces de l’ordre vont devoir faire face à une extrême gauche, dominée par les communistes, mais encore à une extrême droite protéiforme. En effet, si les communistes détiennent le quasi-monopole de l’agitation gauchiste, le contraste est saisissant face à une pléiade de ligues d’extrême droite, sans unité et bien souvent rivales, voire ennemies.
Organisation paramilitaire, l’association des Croix de Feu est assurément la mieux structurée et la plus puissante numériquement. Si son chef admire Mussolini et la réalisation du régime fasciste, il récuse cependant tout antisémitisme et clame haut et fort sa détestation de Hitler et du IIIe Reich.
Si l’association des Croix de Feu est puissante, de toutes les ligues d’extrême droite, l’Action française est toutefois la plus influente. Faisant œuvre de restauration monarchique, ses membres entendent combattre le régime républicain par tous les moyens.
À côté de ces deux organisations coexistent de petites formations comme les Jeunesses patriotes — mouvement bonapartiste, mais non fasciste, favorable à une démocratie plébiscitaire — ainsi que Solidarité française et le Francisme, deux groupuscules ouvertement fascisants.
En dernier lieu, anciens combattants et contribuables s’organisent en mouvements afin de « restaurer l’autorité, de rejeter l’intolérable tyrannie des partis ». En agissant ainsi, ces derniers peuvent être assimilés à des supplétifs de l’extrême droite ?
Le maintien de l’ordre au début des années 1930
Bien que jacobin, le régime dispose paradoxalement de trois forces de police distinctes : la police parisienne, les polices municipales, enfin la Sûreté générale.
Véritable « roi de Paris », le préfet de police jouit de pouvoirs considérables. Il agit en lieu et place de premier magistrat de la ville, la capitale n’ayant pas de premier magistrat. Si le préfet de police reste en moyenne deux à trois ans en poste, Louis Lépine (18 ans) et Jean Chiappe (6 ans) sont toutefois deux exceptions notables. Le préfet de police commande environ 25 000 hommes — soit l’équivalent d’une division militaire, — auxquels il faut y ajouter quelque 3000 gardes républicains et 500 gendarmes qui, bien que dépendant du gouvernement militaire de Paris, peuvent être mis, au besoin, à disposition du préfet de police.
Héritière directe de la police de Fouché, la Sûreté générale a quant à elle, une compétence sur l’ensemble du territoire métropolitain. Seules les villes dites à police d’État : Lyon (1851), Marseille (1908), Nice (1920), Toulon-La Seyne (1918), Strasbourg, Metz, Mulhouse (toutes trois en 1925) sont municipales.
Cette multiplicité de polices conduit à une véritable « guerre des polices », principalement entre la préfecture de police et la Sûreté générale. Les dysfonctionnements – volontaires ou non sont légions et les enquêtes parallèles néfastes au bon déroulement de la justice. Toutefois, principalement grâce à Louis Lépine, la Préfecture de police est la seule à jouir d’un réel savoir-faire en matière de maintien de l’ordre.
Dans le reste de la France, le maintien de l’ordre est assuré par la gendarmerie mobile lors des grèves et des manifestations. Avant 1914, le maintien de l’ordre était assuré par les gendarmes départementaux ainsi que par les soldats de ligne. En 1933 la France semble un des rares pays à jouir d’une réelle stabilité politique. À cette date, le pouvoir sait pouvoir compter sur des forces spécialisées, en termes de maintien l’ordre. Avec la création de la gendarmerie en 1921, ce sont 111 pelotons mobiles de gendarmerie (24 en région parisienne et 87 dans le reste du pays) qui sont à même de maintenir l’ordre en France.
La crise politique et morale
Si la crise que connaît la France en 1934 n’a pas été prévue, elle n’est toutefois pas une surprise. Depuis la fin des années 1920, le phénomène d’imprégnation fasciste, fait du refus du monde bourgeois, nourrit par la crise et les scandales. Hostilité pour la République parlementaire, par la droite, mais aussi par la gauche qui vire vers l’antiparlementarisme, sinon le fascisme ou un pouvoir fort.
Dans ce contexte d’antiparlementarisme, nourri par une série de scandales politico-financiers (Hanau, Oustric), les révélations d’une demi-douzaine d’informations judiciaires contre l’escroc Stavisky, restées en suspens depuis une dizaine d’années vont avoir pour effet d’ébranler les institutions républicaines.
Auteur d’une kyrielle d’escroqueries, défendu par son avocat, le sénateur radical René Rioult, Stavisky sait pouvoir compter sur le président du Conseil Chautemps, et plus particulièrement sur le beau-frère de ce dernier, Pressard, procureur de la République de la Seine, pour être à chaque fois remis en liberté.
Cependant, les révélations de l’escroquerie au Crédit municipal de Bayonne poussent Stavisky à fuir Paris pour se réfugier à Chamonix, dans un chalet où il est retrouvé suicidé. Rapidement, dans la presse court le bruit que la Sûreté a éliminé l’escroc, avec le soutien bienveillant de la Justice. In fin, après enquête, aucune négligence ne sera relevée à l’encontre de la Sûreté et du Parquet de la Seine. Pour autant, alors la fièvre ne baisse pas dans l’opinion publique. Au moment même de la rentrée des Chambres et alors que le député de Bayonne et le ministre Dalimier sont directement mis en cause dans l’affaire du Crédit municipal, 2000 militants de l’Action française se massent autour du Palais-Bourbon aux cris de « À bas les voleurs ». Les jours suivants, ce sont une centaine de Camelots qui manifestent rue de Solférino, puis les Croix de feu qui tiennent meeting salle Wagram, enfin ce sont 4000 manifestants de l’Action franciste, des Jeunesses patriotes et de Solidarité française qui mettent directement en cause le gouvernement. Le gouvernement ne tarde pas à démissionner. Daladier est aussitôt chargé par le président de la République de former un nouveau cabinet. Le remplacement du préfet de police Chiappe — bête noire des socialistes et communistes — par Daladier a pour effet immédiat d’exciter les oppositions.
Crise du 6 février 1934
Alors que Paris bruisse de fausses rumeurs, une foule nombreuse et déterminée fait mouvement depuis les Champs Élysées et l’Étoile, en direction de la Concorde. N’entendant rien au maintien de l’ordre, le nouveau préfet de police assiste va assister impuissant aux premières violences qui débuteront aux alentours 17 heures.
La capitale est en ébullition. En effet, près de 5000 membres de l’Union nationale des combattants se trouvent place de l’Étoile alors que 2000 à 3000 Croix de feux convergent au même moment sur les Champs Élysées. Place de l’Opéra, ce sont 2000 membres de Solidarité française qui se regroupent alors que 4000 sympathisants de Jeunesse patriote remontent la rue de Rivoli, accompagnés d’une cinquantaine de conseillers de Pris ceints de leur écharpe tricolore. Enfin, 4000 manifestants de l’ARAC se rassemblent au Grand Palais, avec pour consigne de ne pas se mélanger aux troupes de l’extrême droite. Nonobstant, les deux camps ne tarderont pas à s’affronter. Au même moment, les membres de l’Action française manifestent autour du Palais-Bourbon, alors que Daladier y obtient la confiance de la Chambre.
Pour faire face aux émeutiers, le nouveau préfet de police tente d’improviser un service d’ordre regroupant environ 6500 policiers et militaires et laisse en réserve à la préfecture de police 4000 hommes. Mission est donnée aux forces de l’ordre de ménager les anciens combattants.
Afin de protéger le Palais-Bourbon de tout envahissement, le pont de la Concorde est solidement barré. Il sera bientôt constamment harcelé par les ligueurs. De 18 heures à minuit, les combats de rue font rage. Cependant, les forces de l’ordre parviennent à contenir les émeutiers place de la Concorde.
Si la place de la Concorde est vide de manifestants à minuit, il faut attendre 3 heures du matin pour que cesse toute violence dans la capitale. Le bilan humain de cette soirée d’affrontements est lourd : 18 morts sont à déplorer (17 civils et 1 garde républicain) et 328 personnes blessées (236 manifestants, 70 gendarmes mobiles et 22 gardiens de la paix).
Devant ce tableau apocalyptique, Daladier décide financement de remettre sa démission, sous la pression de certains de ses ministres et celles des présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Cette démission a pour conséquence directe de démobiliser les manifestants. Symboliquement, le chef d’État fait appel au modéré Doumergue, qui constitue un gouvernement d’union nationale pour apaiser la situation.
Conséquences des journées de février 1934
Durant ces journées de février 1934, 37 personnes perdront la vie et des milliers d’autres seront blessées (1 mort et 1664 blessés du côté des forces de l’ordre). Celles-ci n’ont assurément pas été à la hauteur. Les prévisions des renseignements généraux étaient inexactes ; l’organisation du commandement mauvaise ; l’inertie du préfet de police criante ; enfin les forces de l’ordre étaient en nombre insuffisant et éparpillées. La question de réformer les polices se pose avec la création d’une Police nationale, à laquelle le ministre de l’Intérieur met son veto. Les manquements éthiques et professionnels de la Sûreté conduisent à son remplacement par la création de la Sûreté nationale. In fine, il ne s’agit de rien moins que d’un « ripolinage » de l’institution.
Une nouvelle fois de plus la question de l’usage de l’armée dans les maintiens de l’ordre se pose. Sur les instances de Pétain, ministre de la Guerre, il est décidé que la troupe ne sera pas en contact direct avec les manifestations. D’abord interviendront la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine, puis dans un second temps la Gendarmerie mobile. L’armée ne devra intervenir qu’en dernier lieu. Enfin, l’usage de toute arme devra se faire en dernière limite.
Alors en exil en France, Trostski dresse un tableau sombre de notre pays, à partir de 1934. Celui-ci a la conviction que la France est à la veille de devenir un État fascisant. La lecture de Mein kempf fait comprendre à la gauche que le Reich est plus dangereux que les démocraties parlementaires. Aussi socialistes et communistes organisent-ils un grand défilé unitaire — (800 000 participants) le 14 juillet 1934, jetant ainsi les bases fondatrices du Front populaire.
En réaction le gouvernement — par décret-loi — soumet tous les rassemblements, manifestations sur la voie publique à une autorisation préalable, déposée au minimum 3, maximum 15 jours auparavant à la mairie et à la préfecture contresignée de 3 organisateurs. Peu après, le garde des Sceaux prépare un projet de loi sur les groupes de combat et milices privées, voté le 10 juin 1936. Bientôt, une demi-douzaine d’organisations de droite, sont dissoutes par le gouvernement : le Mouvement social français des Croix de fer, le Parti national, le Parti national populaire, enfin le Parti franciste.
Conclusion
Bernard Hautecloque, conclut son ouvrage en notant que les journées de février 1934 sont un mythe. La droite y voit une révolution du peuple parisien quand la gauche y voit une tentative de coup d’État fasciste contre la démocratie. Ces manifestations ont toutefois marqué l’opinion publique par leur spontanéité et par leur violence.
Si ce court épisode de notre histoire fut une crise politique, ce fut aussi une crise policière. Si la police a su maintenir l’ordre en France entre 1893 et 1934, les faits du mois de février 1934 sont le fait d’un service d’ordre trop brutal, qui par son inefficacité a risqué de remettre en cause la stabilité même du régime. Les fautifs sont ici nombreux. Le nouveau préfet de police a sa part de responsabilité, tout comme la droite qui a joué les apprentis sorciers. Enfin, Daladier et son ministre de l’Intérieur ont capitulé en rase campagne, donnant raison aux émeutiers. Aujourd’hui encore, une question demeure en suspens. Quel rôle Chiappe a-t-il joué lors de ces journées de février ?
Enfin, le décret-loi Paganon, portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public, qui autorise les manifestations sur la voie publique tout en encadrant des organisations, sera une conséquence indirecte des journées de février 1934.