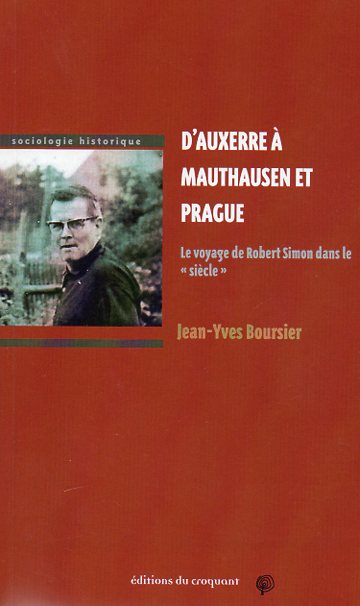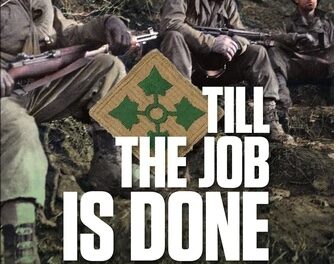Jean-Yves Boursier, professeur émérite des Universités, était professeur d’anthropologie à l’université de Nice Sophia Antipolis jusqu’à sa retraite en 2014. Ses thèmes de recherche portent sur l’« anthropologie de la mémoire, l’anthropologie politique et l’anthropologie du patrimoine ». Il a publié divers ouvrages dans ces domaines : Musées de guerre et mémoriaux : Politiques de la mémoire ; La fabrique du passé : construction de la mémoire sociale : pratiques, politiques et enjeux ; Les enjeux politiques des musées de la Résistance. Multiplicité des lieux. Ses recherches portent aussi sur l’histoire du parti communiste (La politiques du PCF, 1939-1945 : le Parti communiste français et la question nationale) et sur la Résistance. Il connait l’histoire la Résistance dans le département de l’Yonne et a travaillé dans le cadre de la rénovation du musée-mémorial du groupe Bayard à Joigny, groupe de résistance sur lequel il a publié un livre en 1993, La Résistance dans le Jovinien et le groupe Bayard. Mémoire et engagement. En 2013, il a publié aux éditions de l’Harmattan, Armand Simonnot, bûcheron du Morvan. Communisme, Résistance, Maquis. Cet ouvrage est consacré à Armand Simonnot, bûcheron du Morvan, militant communiste des années 1930, résistant FTP de la première heure, membre puis chef élu du maquis Vauban, garde du corps de Charles Tillon qu’il suivit dans son exil politique. Cet ouvrage était le fruit de plusieurs années de recherches, de lectures et de rencontres. Le livre qu’il publie aujourd’hui aux éditions du Croquant est aussi consacré à un militant communiste originaire du département de l’Yonne, lui aussi résistant FTP. Mais c’est un parcours bien plus complexe pour l’analyse duquel Jean-Yves Boursier mobilise son intérêt pour l’histoire du communisme et pour celle de la Résistance.
Un ouvrage dense aux sources en partie privées sur un parcours politique complexe
Anthropologue, publiant son ouvrage dans la collection « Sociologie historique » de son éditeur, Jean-Yves Boursier n’appartient pas au monde des historiens universitaires. Dans l’ouvrage qu’il a publié sur Armand Simonnot, il affirme refuser les problématiques dominantes dans le champ historiographique de la Résistance, en dehors desquelles il entend se situer. Il y fait part d’une conception très personnelle de l’histoire définie comme « une activité idéologique au sens où elle est fondée sur des jugements de valeur subjective, des manières de penser ».
Composé de 13 chapitres qui suivent un plan chronologique, l’ouvrage est dense, les informations riches, les faits exposés nombreux, précis et souvent mis en perspective. L’auteur s’appuie essentiellement sur les entretiens qu’il a eus avec Robert Simon et sur l’exploitation des archives personnelles de ce dernier, qui semblent être d’une extrême richesse : correspondances (avec d’anciens socialistes et socialistes dissidents des années 1930, d’anciens résistants FTP, d’anciens déportés de Mauthausen, des oppositionnels du PCF), nombreux articles écrits au cours de sa carrière de journaliste, dossiers récupérés à la préfecture de l’Yonne par des membres du PCF ou des FTP lors de la libération de la ville et qui lui furent transmis après son retour de déportation, correspondances adressées aux journaux, autobiographie écrite sous la forme d’un roman qu’il ne parvint pas à achever etc. Les notes infrapaginales font également référence aux archives de la préfecture de police, à celles du parti communiste et à quelques ouvrages universitaires. On remarque cependant que très peu d’ouvrages universitaires sur l’histoire de la Résistance sont référencés et que la production historique réalisée dans le département de l’Yonne sur l’histoire de la Résistance de l’Yonne n’est citée qu’avec la plus extrême parcimonie. On est également gêné par une certaine opacité des sources. Les archives de Robert Simon sont l’objet de nombreuses références, mais les documents auxquels l’auteur se réfère ne sont connus que de lui, et ne sont pas accessibles. Un inventaire de ces sources n’est pas disponible et aucun document n’est reproduit.
Un engagement pacifiste, antifasciste et socialiste « déterminé par la haine de la guerre et des notables »
Robert Simon est né le 28 juillet 1909 à Noyers-sur-Serein (Yonne). Son père, petit vigneron, était charretier de bois l’hiver et sa mère, couturière à domicile. Ils élevèrent trois enfants qui furent tous instituteurs, deux furent résistants de l’intérieur et l’un combattit dans l’armée de Lattre ; tous trois eurent « rapport avec le communisme ». En 1913, le vigneron Ernest Simon participa, avec d’autres paysans de Noyers, à la création d’une section socialiste. Il fut tué sur la Somme en 1916 et Robert devint pupille de la Nation. « Le cadre dans lequel le jeune Robert sera élevé par sa mère est empreint de chagrin et de deuil ». Sa mère avait perdu un fils de six ans à la veille de la guerre au cours de laquelle furent tués son mari et ses deux frères. « La sortie de guerre n’eut jamais lieu pour lui, puisque 70 ans après, il revenait sans cesse sur cette déchirure ». Reçu à l’École normale d’Auxerre en 1925, Robert Simon y étudie jusqu’à sa première nomination, en 1928, dans son village natal. En 1927, il participe aux réunions et manifestations à Auxerre en faveur de Sacco et Vanzetti mais, à cette époque, il n’a pas encore choisi entre la SFIO et le Parti communiste ce qui se traduit dans ses choix syndicaux puisqu’il adhère d’abord au SNI-CGT (qui est alors contrôlé par les socialistes) puis à la CGTU (contrôlée par les communistes). Il adhère à la SFIO en 1932 et soutient la tendance « Action socialiste », favorable à une alliance avec les communistes dans le cadre du développement du combat antifasciste
Simon est fondamentalement, viscéralement, pacifiste. A Noyers, son village, dans l’Yonne, département rural, la guerre a tué surtout des petits paysans, des gens du peuple. Simon constate que les notables et leurs réseaux ont versé un tribut bien plus faible. Il est fortement hostile à deux notables icaunais Perreau-Pradier et Pierre-Etienne Flandin (sur lequel il accumulera de gros dossiers d’archives). Lorsqu’il accomplit son service militaire, à Auxerre en 1932-1933, il refuse de suivre le peloton des élèves-officiers de réserve (ce qui lui vaut de la prison). Il participe alors, en uniforme, à la création de deux comités du mouvement Amsterdam-Pleyel. Le travail au sein des « Comités de lutte contre la guerre et le fascisme » et la participation active aux actions antifascistes consécutives au 6 février 1934, lui vaut d’être invité par l’Internationale des travailleurs de l’enseignement, en août 1934, en URSS avec des syndicalistes CGTU de l’enseignement.
Habitant Auxerre mais exerçant à Migennes, gros centre cheminot, Robert Simon milite dans ces deux villes. Quand le conseil départemental des comités de lutte décide de doter le mouvement d’un mensuel, Front populaire, il en devient secrétaire de rédaction. Dès l’été 1935, dans les meetings, comme dans le journal, le militant communiste Louis Aubry, secrétaire des comités, refuse d’exalter la politique de Staline et, de son côté, Robert Simon appelle les socialistes à renforcer le mouvement. En 1936, une motion Aubry-Simon « contre toute adhésion matérielle ou morale à la guerre » l’emporte au congrès départemental contre une motion appelant à « la défense de l’URSS, principal facteur de paix ». La division du mouvement devient évidente. Au lendemain des élections municipales de 1935, un comité départemental du Front populaire est mis sur pied à Auxerre et Robert Simon y participe comme secrétaire du comité de Migennes. Les tâches principales sont le soutien aux chômeurs, la riposte contre les mobilisations fascistes et, en mai 1936, le soutien aux grèves avec occupation, notamment à celle des ouvriers des usines auxerroises Guillet. Peu après, au cours de l’été 1936, quand se constitue le Comité départemental d’aide à l’Espagne républicaine, Robert Simon en devient le trésorier. Il participe à de nombreuses actions d’aide aux réfugiés républicains espagnols.
Sympathisant de la Gauche révolutionnaire, tendance animée par Marceau Pivert au sein de la SFIO, Robert Simon la rejoint dès que Paul Faure dissout la Fédération SFIO de la Seine (tenue par les Pivertistes), en avril 1938. Pivert crée alors le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP). Simon participe à la fondation du PSOP dans l’Yonne, puis en devient le secrétaire départemental. Il groupe une quinzaine de militants issus de la SFIO, quelques employés, des instituteurs, des postiers, des cheminots. A Migennes, où il est secrétaire adjoint de l’UL-CGT, il participe activement à la grève du 30 novembre 1938.
Ultra pacifisme, désertion, errance politique
S’ouvre alors une courte période que Simon a rejeté plus tard et qui fut le fondement des affirmations malveillantes dont il fut par la suite l’objet. Trésorier départemental du mouvement pacifiste « Paix et Liberté », avec Louis Aubry, il organise la dissidence au sein du mouvement. Il évolue alors vers le courant ultra-pacifiste, celui des comités de lutte contre la guerre fondés par le militant icaunais Georges Clémendot qui proclame « Entre la guerre et le fascisme, nous ne choisissons pas. Nous mettons les deux choses dans le même sac d’ignominies ». Simon est signataire d’un texte qui évoque ceux qui « essayent de dresser le peuple français contre le peuple allemand ».
Le 2 septembre 1939, Robert Simon est arrêté par les gendarmes alors qu’il distribue aux cheminots de Migennesun tract du PSOP condamnant le Pacte germano-soviétique et la politique du gouvernement Daladier. Fiché comme « propagandiste révolutionnaire », il est traduit devant des officiers qui l’insultent et lui reprochent, son comportement pendant son service militaire en 1932-1933. « Il rejette l’idée de refaire le chemin imposé à son père en 1914-1916 ». Le 16 septembre 1939, enfermé dans l’attente de son départ pour le front, il s’échappe par la fenêtre et se rend chez un camarade : il déserte. La quasi-totalité des militants trotskystes, anarchistes, psopistes, communistes ont rejoint leurs unités. Un tribunal militaire le condamne par contumace à six ans de prison ; il est révoqué de l’Éducation nationale. Thorez déserte sur ordre de l’Internationale communiste le 2 octobre 1939 et gagne l’URSS.
Simon se rend à Paris, participe à l’exode, arrive en Haute-Loire puis décide de se rendre. Il se constitue prisonnier dans une gendarmerie, est emprisonné et arrive à Auxerre le 13 juin au soir. Il est envoyé à Dijon et incorporé durant la journée du 14 juin à un convoi hétéroclite de déserteurs, de militants communistes internés, de civils accusés de propos défaitistes. La colonne est rattrapée par les Allemands et Simon, désormais prisonnier de guerre mais en tenue civile réussit à s’évader après diverses pérégrinations. Il prend le train pour Migennes, puis Auxerre, occupé depuis le 15 juin. Il gagne sa vie pendant quelques temps en vendant L’Informateur auxerrois, journal ouvertement pétainiste qui se fait l’écho des positions de Pierre-Etienne Flandin et de la majorité des notables de l’Yonne, qu’il exécrait avant guerre. Il distribue aussi un lexique franco-allemand : « ce qui revient à considérer que la domination allemande est établie pour longtemps et qu’il est nécessaire d’apprendre la langue des nouveaux maitres du pays ». Il se rend plusieurs fois à Paris où il participe à des réunions d’anciens membres du PSOP au cours desquelles est il est question de créer un « Mouvement national révolutionnaire (MNR)». Prenant acte de la domination nazie, il s’agissait de travailler au « redressement national et social de la France ». Simon envisage-t-il de « composer avec l’occupant », à une époque où, rappelons-le, le Parti communiste négocie avec lui la reparution de L’Humanité et demande à ses militants de paraitre au grand jour ?
Engagement résistant à la confluence d’un réseau gaulliste et du groupe FTP Valmy
Dès janvier 1941, Robert Simon distribue des tracts gaullistes refusant, par là, de s’engager dans la voie prônée par le MNR. Fin septembre 1941, il est mis en contact avec Raymond Laverdet, un ancien du PSOP de Montrouge, devenu le responsable d’une mission envoyée en France par le BCRA (Service d’action et de renseignement de la France libre à Londres), la mission « Dastard ». Sur cet engagement gaulliste de Simon, Jean-Yves Boursier utilise essentiellement la correspondance entre Laverdet et Simon après guerre, négligeant les archives du BCRA du Centre historique de la Défense à Vincennes, et les études historiques sur la mission Dastard.
Laverdet a gagné Londres, s’est engagé au BCRA, a été formé dans les camps d’entrainement anglais puis a été parachuté en France (dans le nord de l’Yonne) le 7 septembre 1941, avec pour mission de prendre contact avec des groupes de résistants. Les premiers résistants que Laverdet rencontre à Paris appartenaient à l’« Armée des Volontaires », nom donné au rassemblement des rescapés d’une nébuleuse de petits groupes décimés par les polices allemandes. Ces premiers contacts lui permettent d’organiser matériellement sa mission et de trouver un lieu d’émission radio. Les archives du BCRA confirment un contact régulier de Laverdet avec Londres à partir du 9 octobre. Laverdet entre en contact avec des responsables clandestins de la SFIO, dont Henri Ribière (l’un des fondateurs de Libération-Nord), à qui il remet des fonds. Son objectif est de constituer un groupe de sabotage d’usines et de propagande.
Il rencontre Robert Simon qui a pour sa part fait connaissance avec André Jacquot. Ancien des Brigades internationales, entré au Parti communiste avant guerre, Jacquot est devenu responsable militaire du groupe FTP « Valmy ». Dans un entretien avec Roger Faligot et Rémi Kauffer (Les Résistants. De la guerre de l’Ombre aux allées du pouvoir ; 1944-1989, Fayard, 1989, chapitre 6), les 15 et 22 mai 1987, Robert Simon confirmait cette rencontre : « Dans un restaurant à deux issues boulevard Bonne-Nouvelle, j’étais entré en relation de sympathie avec André Jacquot, qui a fini par m’avouer son appartenance au PC clandestin. Ce devait être en octobre ou novembre 1941 et Jacquot mettait sur pied le groupe Valmy, une unité de choc des FTP. Jacquot m’a expliqué qu’il souhaitait entrer en contact avec les gaullistes. (…) Dans l’organigramme de Valmy, chaque militant était désigné par un nom de ville, je suis entré dans le groupe sous le nom de Lyon. J’ai établi le contact entre Jacquot et Laverdet, et constaté avec plaisir que tous les deux s’entendaient très bien. Si bien que le second a accepté, au nom du BCRA, de nous remettre des armes ». Les contacts entre Laverdet et les responsables communistes aboutissent donc positivement. Londres accepte un parachutage d’armes destinées au groupe Valmy sur un terrain que Laverdet fait homologuer et un parachutage a lieu le 1er mai 1942, sur le territoire de la commune de Courlon, dans le nord de l’Yonne.
Le « détachement Valmy » a été créé par la commission des cadres du Parti communiste, elle-même aux ordres directs de Jacques Duclos. Ce fut dans un premier temps une police interne au Parti chargée de « liquider les traîtres » (c’est le titre de l’ouvrage de Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre qui en retrace l’histoire, l’action et la chute, Robert Laffont, 2007). A l’été 1942, une seconde mission lui est donnée et un groupe d’action spécialisé dans les attentats contre les troupes d’occupation dans la capitale est constitué il reçoit l’ordre de commettre des attentats contre les troupes d’occupation, afin de servir d’exemple aux FTP. Les hommes disposent désormais d’armes et d’explosifs anglais de grande qualité, fournis par le parachutage de la mission Dastard. Le 8 août 1942, Robert Simon, qui a adhéré au parti communiste, lance une grenade par la fenêtre ouverte de la salle du restaurant de l’hôtel Bedford, occupée uniquement par des militaires allemands. En 1946 Robert Simon signera dans la collection « Jeunesse héroïque » publiée « avec le concours de l’association nationale des anciens FTP-F » un petit ouvrage édifiant et romancé : Les grillages de l’hôtel Bedford. A l’automne 1942, le groupe « Valmy » réalise plusieurs attentats spectaculaires : une bombe explose au cinéma Rex le 17 septembre (2 morts, 20 blessés), à la gare Montparnasse le 13 octobre. Le bilan est certes modeste (25 Allemands tués dans le département de la Seine entre juin 1941 et décembre 1942) mais le PCF veut affirmer sa place dans la Résistance et conquérir une légitimité compromise par la politique qui a été la sienne jusqu’au printemps 1941. Fin octobre 1942, le groupe « Valmy » est démantelé par les policiers des brigades spéciales. Torturé puis livré aux Allemands qui le condamnent à mort, Robert Simon est emprisonné à Fresnes durant l’hiver 1942-1943, puis à Romainville d’où il est déporté, avec ses camarades, pour Mauthausen (Autriche) en mars 1943.
Déporté à Mauthausen, organisateur de la résistance au sein du camp
Sur les 26 hommes du groupe Valmy déportés, 12 décédèrent dans les camps. Simon est déporté NN à Mauthausen, centre d’un vaste complexe concentrationnaire d’environ 80 annexes. Il passe 270 jours en quarantaine au block 16, où des centaines de détenus sont isolés, transformés en cobayes, livrés à de pseudo-médecins pour subir des expériences alimentaires. A sa sortie du block, il contracte une dysenterie hémorragique et échappe de peu à la mort, grâce à la solidarité d’autres déportés, en particulier espagnols. Affecté à la carrière, Robert Simon y rencontre Octave Rabaté, qu’il connaissait de l’époque du mouvement « Paix et Liberté » et qui s’était employé à organiser, avec Jean Laffitte, l’appareil communiste clandestin. Le 9 mars 1944, Lafitte et Simon sont envoyés à Ebensee, une annexe du camp principal où d’anciennes galeries de mines de sel sont aménagées en usines souterraines productrices de fusées V1. Là, avec Souque, Rabaté et Simon organisent le triangle de direction de la résistance communiste clandestine. Grâce à l’organisation communiste clandestine, Simon est nommé kapo des latrines, un poste stratégique dans le camp car on y recevait des informations et on pouvait y communiquer avec l’ensemble du camp.
En janvier 1945, Simon est désigné pour se consacrer à l’organisation militaire qu’il dirige en liaison avec Jean Laffitte. Les troupes américaines libèrent le camp le 6 mai 1945. Quelques jours après, le Comité international, de fait le Parti communiste, prend le pouvoir au sein du camp libéré. Simon est chargé de mettre en place une police du camp..
Militant de la mémoire communiste de la déportation
Robert Simon est rapatrié fin mai 1945 et regagne Auxerre en juin. En octobre 1945, des rescapés français du camp de Mauthausen créent l’ « Amicale des déportés politiques de la Résistance de Mauthausen et de ses commandos dépendants » (aujourd’hui « Amicale de Mauthausen -déportés, familles et amis »). En 1953 est créé le « Comité international des Anciens de Mauthausen » regroupant les associations nationales d’anciens déportés du complexe concentrationnaire. L’Amicale fait édifier des monuments à Mauthausen et à Paris, se mobilise pour la chasse aux criminels de guerre, et, avec la guerre froide, contre le réarmement de l’Allemagne. Simon participe aux activités de l’Amicale de Mauthausen et rédige de nombreux articles et discours. Il est également le responsable de la section d’Auxerre de l’ADIRP (Association départementale des déportés, internés et résistants patriotes), fédération départementale de la FNDIRP (Fédération nationale des déportés, internés et résistants patriotes), fondée en 1945 et liée au PCF. « Pendant des décennies, Robert Simon est le cadre du PCF dans la FNDIRP de l’Yonne (…) Cette forme de prestige assure du pouvoir dans le Parti et Robert Simon en avait conscience, d’autant plus que personne dans la fédération de l’Yonne ne pouvait afficher dans les années 1960 des états de service équivalents. »
Militant communiste à l’échelle départementale, nationale et internationale dans la ligne stalinienne
Dans l’Yonne, le parti communiste sort de la guerre beaucoup plus puissant qu’il n’y était entré. Sa place dans la Résistance, l’importance du Front national et l’activité des FTP ont très largement amplifié les débuts de l’implantation réalisée dans les années du Front populaire et du mouvement pacifiste et antifasciste. Ses adhérents sont bien plus nombreux. Il en va de même de ses électeurs. Plus d’un électeur icaunais sur quatre vote communiste en 1946, alors qu’ils étaient moins de un sur dix en 1936. Le parti communiste est devenu la seconde formation politique du département derrière la droite modérée. La fédération dispose désormais d’un journal, d’un local, Le Travailleur, et d’une dizaine de permanents.
De retour à Auxerre le 6 juin 1945, Robert Simon est appelé à la direction de la fédération de l’Yonne du PCF. Affecté au journal bi-hebdomadaire Le Travailleur, qui tire à 20 000 exemplaires, il en devint le directeur de 1947 à janvier 1949, date de sa disparition. « Il retrouve un travail de journaliste politique (…), un travail de polémiste (…) Il occupe un excellent poste d’observation, de collecte d’informations et de travail de propagande, de mobilisation politique. Il donnera une forte impulsion à ce journal. » Simon mène dans Le Travailleur une virulente campagne contre les notables non épurés : Jean Moreau par exemple a été réélu maire d’Auxerre malgré son passé vichyste judiciairement sanctionné. La guerre froide venue, la droite étant fortement implantée dans l’Yonne, Simon est violemment attaqué dans différents journaux comme « Simon le déserteur », sur fond de campagne anticommuniste. Simon reçoit peu de soutiens et ces accusations vont le poursuivre longtemps, reprises par certains socialistes. Simon a été amnistié par décret en novembre 1945 de la condamnation du tribunal militaire de 1940. Il a été décoré en 1946 de la Médaille de la Résistance.
La disparition du Travailleur pour des raisons financière fait perdre son emploi à Simon au début de 1949. L’appui de Laffitte, avec lequel il est resté ami, va le tirer d’affaire. Il est affecté au « Comité de préparation du Congrès mondial de la Paix » présidé par Aragon et dont Laffitte est le secrétaire général. Simon devient secrétaire de rédaction et administrateur de la revue en France et des éditions nationales dans les pays occidentaux. Rôle qui le conduit à Bâle, à Bruxelles, à Londres, à Vienne, à Berlin, et à Prague au siège du Conseil. « Dès lors Simon passe de l’appareil local icaunais su PCF à l’appareil central, et même à l’appareil international dans le contexte de la guerre froide. » La revue est publiée en plusieurs langues ; elle est un vecteur de diffusion des thèses du Kominform et une source de financement pour le PCF. Simon occupe un poste de confiance, celui de secrétaire de rédaction, qui contrôle et corrige les articles. Quand le service des cadres du PCF lui demande de faire de l’espionnage politique sur les rédacteurs, il refuse. Sa situation va alors vite se dégrader, alors qu’il était tout à fait dans la ligne stalinienne antititiste.
Dans les années 1947-1951, la fédération de l’Yonne du PCF traverse une crise profonde. Les hostilités personnelles et les affaires privées semblent y avoir plus d’importance que les luttes idéologiques qui accompagnent alors la Guerre froide, la stalinisation et la campagne « antititiste ». Insultes, diffamations, violentes altercations, démissions, évictions, interventions du Comité central déchirent le parti. Les résistants influents sont tous évincés du secrétariat fédéral, perdent leurs fonctions de permanent et parfois s’éloignent du parti. En 1952, son origine auxerroise vaut à Simon d’être suspecté au moment où se prépare la mise à l’écart de Charles Tillon ; celui-ci ayant un secrétaire, Marcel Valtat et un garde du corps, Armand Simonnot, l’ancien commandant du maquis Vauban, tous les deux déjà originaires de l’Yonne. Robert Simon est alors démissionné de ses fonctions. Réintégré à sa demande dans l’Éducation nationale, il retrouve un poste d’instituteur dans l’Yonne à la rentrée de 1953. Il redevient membre du comité fédéral du PCF de l’Yonne à partir de 1956.
Exclu du Parti communiste pour « activités fractionnelles et désagrégatrices »
En 1959, Robert Simon s’engage dans la tentative oppositionnelle du groupe « Unir-Débat pour le socialisme », dont l’objectif était « le redressement démocratique du PCF ». Les abonnés et sympathisants du bulletin Unir sont principalement de vieux communistes des années 1930 et de la Résistance, surtout des intellectuels et des cadres intermédiaires. La direction fédérale ne réussit pas à l’écarter du Comité fédéral en 1959 ; par contre plusieurs de ses amis le sont. Simon s’engage ensuite dans la campagne pour la réhabilitation de Marty. Il « conduit bien une activité oppositionnelle et fractionnelle », mais son opposition ne remet pas en cause le PCF en tant que parti. Simon reste populaire au sein du PCF de l’Yonne, à Auxerre tout particulièrement, et Jean Cordillot, « l’homme de confiance de la direction du PCF dans l’Yonne », qui a pris en main la fédération, n’ose pas encore s’en prendre directement à lui. Il faudra attendre les événements de 1968 et la crise tchécoslovaque pour qu’il agisse.
Condamnant immédiatement l’invasion de la Tchécoslovaquie dans l’Yonne républicaine, Simon participe à la création du « Mouvement du 5 janvier » pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, et en est secrétaire de 1972 à 1977. Il est exclu du PCF le 13 novembre 1970 par trois voix contre deux, pour « activités fractionnelles et désagrégatrices » et parce qu’il « s’est révélé l’un des dirigeants d’opérations menées en ce sens par divers groupes d’exclus, de renégats, de trotskystes et d’autres anti-communistes notoires ».
L’itinéraire politique de cet instituteur pacifiste, antifasciste, socialiste puis communiste « peut apparaître complexe et sinueux ». Jean-Yves Boursier estime qu’il « est largement représentatif de celui de nombreux militants venus au PCF pendant la Résistance et ayant, par la suite, tenté sans succès de « redresser le Parti de l’intérieur ». L’ouvrage de Jean-Yves Boursier fournit une grande quantité d’informations sur la vie politique du département de l’Yonne et sur l’histoire de la fédération communiste de l’Yonne en particulier. Il vient compléter les connaissances déjà solides sur l’histoire du département des années 1930 aux années 1970 Mais le parcours de Robert Simon étant complexe, touchant au pacifisme, au communisme, à la Résistance, à la Guerre froide, à la contestation interne au sein du Parti communiste, l’intérêt de l’ouvrage va au-delà de l’histoire du département de l’Yonne, d’autant plus qu’il est émaillé de réflexions sur les conditions dans lesquelles se construit le récit historique.