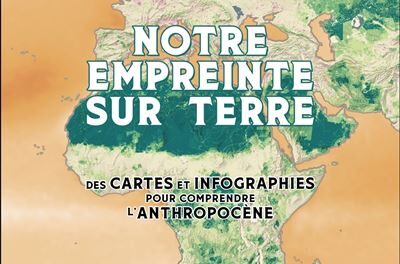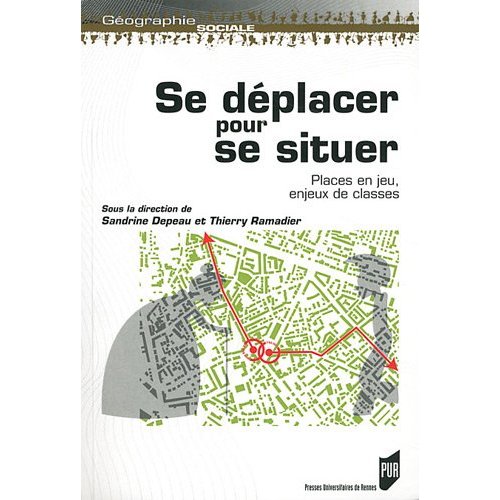
C’est un petit livre (193 pages) qui « donne du grain à moudre » pour qui s’intéresse aux mobilités et à leur évolution épistémologique. Les actes du Colloque « Mobilités, Identités, Altérités » de 2006, aujourd’hui édités par les Presses Universitaires de Rennes, offrent une matière à réflexion de qualité sur les thématiques d’identité et de mobilité. Thierry Ramadier et Sandrine Depeau, tous deux psychologues et directeurs de recherche à l’université de Strasbourg (pour le premier) et de Haute-Bretagne (pour la seconde) présentent ici les actes du colloque et replacent le rôle que la psychologie peut jouer dans la question d’identité de déplacement.
La mobilité questionne l’identité. « Se déplacer dans un espace géographique, c’est exprimer son rapport aux autres par le trajet et le lieu de destination, par le mode utilisé, par son rapport au temps et à ceux que l’on croise lors du déplacement. » Pour autant, cela ne signifie pas que la mobilité soit productrice d’identité sociale. Les auteurs estiment, au contraire, que c’est l’identité qui détermine les rapports à l’espace géographique. La question de l’identité est centrale dans le basculement opéré entre géographie des transports et géographie des mobilités. Aux analyses d’infrastructures physiques des déplacements s’est substitué un questionnement centré sur l’individu. Les auteurs regrettent que cette nouvelle approche soit trop centrée sur les compétences de l’individu en termes de mobilités. Les effets sociaux, en tant que tels, ne sont pas assez étudiés.
L’article d’Hélène Bailleul et de Benoît Feildel introduit le volume par une mise au point épistémologique de haute volée ! Après avoir fait la genèse du concept de mobilité, ils montrent que, pour appréhender cette notion, il est nécessaire de focaliser son attention « sur l’acteur et non uniquement sur ses pratiques ». Et c’est en cela que psychologues et sociologues ont leur mot à dire dans ce domaine. « La déclinaison essentiellement géographique de la mobilité n’est plus satisfaisante, celle-ci étant envisagée comme « fait socio-spatial » (Carpentier, 2007). » Cette réflexion les amène ensuite à exposer la technique d’enquête « récits de vie spatialisés » dans la lignée de la « Time Geography ». Et, c’est là qu’il vaut mieux avoir sous la main du papier et un crayon car c’est passionnant à lire mais costaud !
Les autres articles apparaissent nettement plus faciles. Nathalie Ortar et Caroline Legrand analysent les mobilités des « célibataires géographiques », ces personnes hyper-mobiles dans le cadre de leur travail. A partir de l’exposé de quatre cas d’hyper-mobiles, la mobilité apparaît bien comme constitutive de l’identité de ces personnes et questionne la notion d’ancrage. L’approche par l’étude de cas rend très concrète l’ensemble. De la même manière, l’article d’Hadrien Dubucs, qui a réalisé sa thèse sur les migrants japonais à Paris (environ 20 000 en Ile de France), se base sur des profils types de migrants et montre ainsi les limites de leur ancrage parisien, souvent proportionnel à la durée de leur séjour (le plus souvent temporaire et organisé dans un cadre professionnel ou étudiant). Le cas des travailleurs intérimaires (qu’Yves Jouffe désigne sous le terme de « précaires flexibles ») permet de voir en quoi la mobilité, condition indispensable à l’obtention d’un contrat, est cruciale pour des personnes qui ne sont pas autonomes (pas de voitures, situation d’illettrisme). Une approche historique des mobilités et de l’identité est présente dans ce recueil avec l’article d’histoire des arts qui montre le fonctionnement des avant-gardes au XXème siècle à partir du cas de deux écrivains italiens. Dans un autre registre, Guillaume Courty étudie la constitution de l’identité des Routiers et son évolution depuis l’apparition de ce métier en tant que tel dans les années 1930. Le groupe de recherche qui a travaillé sur la co-territorialité dans le périurbain de l’estuaire de la Seine, à la suite de la construction du Pont de Normandie, comme Samuel Carpentier, qui travaille sur l’identité d’habitation au Luxembourg, réfutent que le territoire soit premier dans la construction de l’identité. L’approche déterministe qui « supposait un ancrage fort au territoire et une conjonction entre celui-ci et les réseaux sociaux » n’a plus lieu d’être avec « l’augmentation des mobilités tant résidentielles que quotidiennes (qui) indique un changement profond des modes d’habiter et ce faisant, du rapport de l’individu à l’espace et aux groupes sociaux. » Michel Koebel, à qui revient l’honneur de conclure l’ouvrage, met toutefois en garde contre un centrage sur l’individu au détriment des groupes sociaux. Il souligne l’effort fait par les contributeurs pour classer et quantifier alors que « classer socialement des pratiques n’est plus tellement dans l’ère du temps ». Il faut toutefois reconnaître que ces pratiques « qui flattent profondément l’ego » sont bien plus séduisantes à découvrir que la présentation de modèles théoriques de classement !