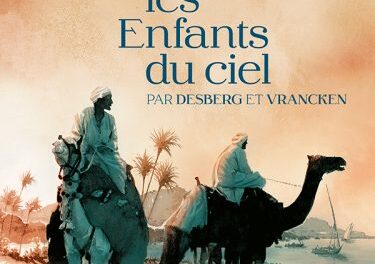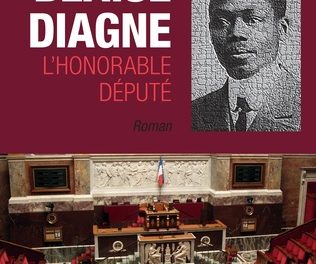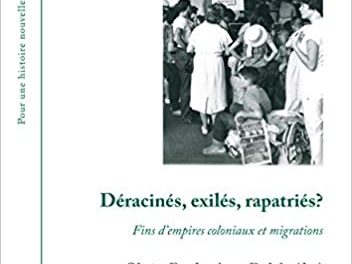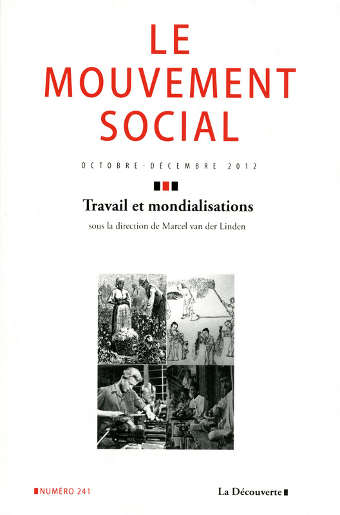
Fruit d’une initiative de Patrick Fridenson, dont on peut lire un portrait dans le numéro de L’Histoire de février 2013, la publication de ce numéro du Mouvement social permet au lecteur francophone de se faire une idée de ce qu’est l’histoire globale ou mondiale du travail, traduction de l’anglais global labour history. On peut se demander pourquoi les éditeurs ont choisi d’intituler le numéro de la revue, « Travail et mondialisations » plutôt que « Histoire globale du travail » ou « Histoire mondiale du travail. » Aucune explication ou justification de choix n’est fournie.
Celle-ci est en particulier développée depuis plus d’une dizaine d’années par l’Institut International d’Histoire Sociale d’Amsterdam où elle est née et où elle est devenue un programme de recherche. [http://socialhistory.org/en/research/global-labour-history->http://socialhistory.org/en/research/global-labour-history]
L’IIHS est un très grand centre de recherche historique en même temps qu’un très important centre d’archives qui a été créé en 1935, notamment pour recueillir les archives des différentes composantes des mouvements ouvriers européens, victimes de la répression des régimes totalitaires ou autoritaires des années 19303. Au sein de l’IIHS, c’est en particulier un des directeurs de recherches, Marcel van der Linden, par ailleurs professeur d’histoire des mouvements sociaux à l’Université d’Amsterdam, qui a promu l’histoire globale du travail.
Assez naturellement, c’est lui qui a dirigé ce numéro du Mouvement social et qui en a rédigé la présentation intitulée « Enjeux pour une histoire mondiale du travail »
L’auteur n’explique pas pourquoi il a choisi de traduire global labour history par « histoire mondiale du travail » plutôt que par « histoire globale du travail » mais cela n’a sans doute pas grande importance. Il établit cependant une distinction entre histoire globale et histoire mondiale plus loin dans son éditorial (pages 15-16) mais sans que l’on sache si celle-ci s’applique à son choix de traduction.
et conçue comme un éditorial.
Les autres articles présentent des exemples des résultats qui peuvent être obtenus par les historiens pratiquant l’histoire globale du travail. Certains au moins sont la traduction de textes parus d’abord en anglais. Sur neuf auteurs, deux seulement travaillent dans des centres de recherches français ; il s’agit d’Alessandro Stanziani et Michel Pigenet. Les autres occupent des postes à IIHS d’Amsterdam, à Genève, en Belgique, en Allemagne ou aux Etats-Unis. L’histoire globale du travail est donc un courant historiographique international et, naturellement, elle s’écrit principalement en anglais comme en témoigne la liste des publications de Marcel van der Linden lui-même. http://socialhistory.org/en/staff/marcel-van-der-lindenhttp://socialhistory.org/en/staff/marcel-van-der-linden
Histoire du travail et histoire globale du travail.
Avant de définir ce qu’il faut entendre par histoire globale du travail, Marcel van der Linden revient sur l’historiographie de l’histoire du travail telle qu’elle s’est développée depuis le XIXe siècle. Il montre que celle-ci a été largement marquée par le « nationalisme méthodologique » et l’eurocentrisme, deux biais que l’histoire globale du travail cherche à dépasser : « Les nationalistes méthodologiques sont victimes de deux erreurs intellectuelles majeures. Premièrement, ils naturalisent l’État-nation. Nous entendons par là qu’ils considèrent l’État-nation comme l’unité analytique de base pour la recherche historique. […] Deuxièmement, ils postulent un lien direct entre « sociétés » et États-nations. Les sociétés sont considérées comme l’extension des frontières nationales.
En ce sens nous pouvons parler de sociétés française, japonaise ou nigérienne. Cependant il semble plus logique de partir du principe que toutes les personnes exerçant une influence sur les vies sociales d’autres personnes appartiennent à la même société. La « société » devient ainsi une entité sans frontières dans laquelle, en raison des flux migratoires, des échanges commerciaux, des guerres, etc., les habitants des régions différentes sont en contact (et il existe également des personnes qui n’appartiennent par à la société mondiale parce que leur propre société est isolée). » On comprend que l’histoire globale du travail postule l’existence d’une « société mondiale ». Marcel van der Linden souligne par ailleurs que la « nouvelle histoire du travail » qui s’est développé à partir des années 1960 n’a pas échappé au « nationalisme méthodologique » et à l’ « eurocentrisme » comme le montrent La formation de la classe ouvrière anglaise publiée pour la première fois en 1963 par Edward P. Thompson et les travaux de Jean Maitron, Rolande Trempé, Michelle Perrot et Yves Lequin en France. « Thompson reconstruit le processus anglais de formation des classes (dans la période 1792-1832) en tant que système indépendant » (page 6) sans se préoccuper des influences extérieures que ce processus a pu subir et de la place du colonialisme dans celui-ci.
Après un développement sur l’essor de l’histoire du travail hors d’Europe, en particulier dans le « Sud », Marcel van der Linden souligne une autre insuffisance historiographique ; les historiens du travail, au Sud comme au Nord, se sont focalisés sur certaines catégories de travailleurs et certaines formes de travail : « Les historiens du « Sud » eux-aussi se focalisèrent sur les mineurs, les dockers ou les travailleurs des plantations ; ils négligèrent les familles, les ménages et le travail fait en leur sein. De même, ils effectuèrent des recherches surtout sur les grèves, les syndicats et les partis politiques. » (page 10).
A partir des années 1970, sont publiés quelques travaux qui ne peuvent pas faire l’objet des mêmes critiques et qui sont les marqueurs de l’émergence d’une nouvelle façon d’envisager l’histoire du travail. Celle-ci est formalisée et prolongée en 1999, par l’auteur lui-même et Jan Lucassen, dans « une petite brochure » intitulée Prolegomena for a Global Labour History : « Prolegomena soulignait les limites géographiques, temporelles et thématiques de l’histoire du travail traditionnelle. […] Il suggérait en particulier le besoin de rapprochements transcontinentaux et diachroniques » (page 12). A plus de dix ans de distance, Marcel van der Linden a le sentiment que lui et Jan Lucassen ont été entendus ou en tout cas d’avoir été en phase avec l’évolution de la production historienne : « Le concept est fréquemment mentionné lors de conférences et dans diverses publications ; il inspire aujourd’hui un nombre modeste, mais croissant, de projets de recherche dans le monde entier. » (pages 12-13). Il estime aussi que le moment est venu de définir plus précisément ce qu’il faut entendre par « histoire mondiale du travail »
On peut regretter que l’auteur ne précise pas quelle est la place (ou l’absence de place) du développement de l’histoire globale comme courant historiographique, en particulier aux Etats-Unis, dans la genèse de l’histoire globale du travail.
Plus qu’un concept, il s’agit d’un domaine de recherche : « Je considère l’histoire mondiale du travail (GLH) comme un « domaine de recherche » distinct, tout comme l’histoire de l’art ou la linguistique. Au sein de ce domaine de recherches, différentes théories peuvent être élaborées et testées […]. Intrinsèquement, l’histoire mondiale du travail n’est pas une « théorie » en soi, et, par conséquent, ne représente pas une alternative à la théorie des systèmes-mondes d’Immanuel Wallerstein ou toute autre interprétation de l’ordre mondial capitaliste. » (page 14).
Par ailleurs, les historiens du travail, et en particulier ceux dont les travaux relèvent de l’histoire globale du travail, ont redéfini ou élargi l’objet « travail » en s’intéressant à toutes les formes de travail et pas seulement au salariat (travail en famille, travail indépendant), à des salariés jusque-là négligés, comme les policiers, les militaires ou les prostituées On peut lire à ce propos un article de Magaly Rodríguez García, « La Société des Nations face à la traite des femmes et au travail sexuel à l’échelle du monde » publié dans le présent numéro du Mouvement social (pages 105-125)., et ont montré que la frontière entre le salariat « libre » et l’esclavage était souvent floue et fluide.
Marcel van der Linden, avant de présenter les articles réunis pour Le Mouvement social, achève son éditorial en exposant les directions qu’il souhaiterait voir prendre à l’histoire mondiale du travail, non sans avoir précisé qu’il s’agit à ses yeux d’une « domaine de recherche énorme » (page 20). Il voudrait notamment qu’elle relève le défi de « L’analyse du développement à long terme de la classe ouvrière mondiale », que soient multipliées les « études de cas problématisées » et les « recherches comparatives internationales », les travaux montrant « comment le développement de la classe ouvrière dans les différentes continents a été interconnecté » (page 22) ou « l’auto-organisation et la résistance8 » (page 25) étudiées elles-aussi à l’échelle mondiale.
Exemples de mise en œuvre de l’histoire globale du travail.
Les études réunies dans la suite de ce numéro du Mouvement social permettent donc de lire ce que peut produire concrètement une histoire globale du travail. Même si je n’en évoque que deux ci-après, toutes méritent l’attention. On peut prendre connaissance de leur titre et en lire un résumé sur le site de la revue. http://www.lemouvementsocial.net/
L’article d’Adam Mc Keown, professeur à l’université de Columbia, intitulé « Les migrations internationales à l’ère de la mondialisation industrielle, 1840-1940 », offre un bon exemple de dépassement de l’eurocentrisme. Il montre, notamment, l’existence de trois systèmes principaux de migrations entre 1840 et 1940 : un système transatlantique, un système sud-est asiatique et un système nord-asiatique qui « pèsent » chacun une cinquantaine de millions de migrants. Il relative par ailleurs l’importance des « coolies » ou des « engagés » dans les migrations asiatiques (moins de 8 % du total) et déconstruit ces deux catégories : celles-ci « permirent de cataloguer les migrations asiatiques comme un phénomène foncièrement distinct des migrations européennes et l’Asie comme un continent immobile tant qu’il n’était pas soumis à l’intervention directe ou à la contrainte des Européens. » (page 42). Dans la mesure où cet article fourmille de données et d’évaluations statistiques, il peut être utile pour traiter le premier thème du programme d’histoire de seconde, « La place des Européens dans le peuplement de la Terre ».
Dans « Les diamants, de la mine à la bague : pour une histoire globale du travail au moyen d’un article de luxe », Karin Hofmeester, chercheuse à l’IIHS d’Amsterdam, présente une partie des résultats d’un projet de recherche qu’elle y mène, qui s’intitule : « Luxury and Labour : A Global Trajectory of Diamond Consumption and Production, 16th to 19th Century »10 (pages 85-103) et qui s’insère dans le plus vaste projet de recherche de l’IIHS sur l’histoire mondiale du travail évoqué plus haut :
« Comme la filière et la vente de cet article [le diamant] est mondiale depuis ses débuts, la production de diamants nous offre une exemple parfait de la façon dont on peut faire une histoire globale du travail » (page 85).
Karin Hofmeester évoque les circulations du diamant le long de la chaîne de production, de la mine à l’atelier de taille, et de l’Inde à l’Europe, de l’Antiquité à nos jours, puis du Brésil à l’Europe à partir du XVIIIe siècle. Compte tenu du titre de l’article, on peut regretter qu’elle laisse de côté, sans véritablement se justifier, une partie essentielle de l’histoire du diamant : celle qui suit le début de l’exploitation des mines d’Afrique du Sud, au tournant des années 1870, qui entraîne un développement rapide de l’industrie de la taille du diamant en Europe, principalement à Amsterdam et Anvers, avant que l’Inde, après la Deuxième guerre mondiale, ne redevienne le principal pays où sont taillés les diamants. Karin Hofmeester a sans doute voulu se concentrer sur la période la moins défrichée de l’histoire du diamant, l’époque moderne, et sur le territoire du diamant le moins exploré par les historiens, l’Inde. Elle nous apprend effectivement beaucoup sur les conditions de travail dans les mines, en Inde et au Brésil, sur le travail de la taille du diamant avec une comparaison intéressante des savoir-faire mis au point ou maîtrisés en Inde et en Europe et leur circulation entre ces deux territoires, en particulier la technique du facettage, et sur l’organisation du commerce et de la commercialisation du diamant à l’échelle mondiale à l’époque moderne. Elle montre surtout que l’histoire du diamant à l’époque moderne ne peut être comprise que par le biais des interconnexions entre l’Europe et l’Inde, que l’on se place du point de vue de l’Europe ou de celui de l’Inde.
Comme on l’aura compris, ce numéro du Mouvement social mérite d’être lu par tous ceux qui s’intéressent à la mondialisation en général et au poids de celle-ci dans l’histoire du travail sous tous ses aspects en particulier, qu’il s’agisse de l’histoire des techniques et des savoir-faire et de leur circulation à l’échelle mondiale, de l’histoire des conditions de travail ou de l’histoire du marché du travail comme le montre Sven Beckert dans « La main d’œuvre du capitalisme. Révolution industrielle et transformation des campagnes cotonnières dans le monde » (pages 147-161).