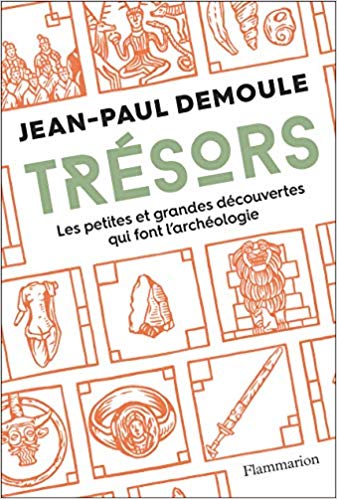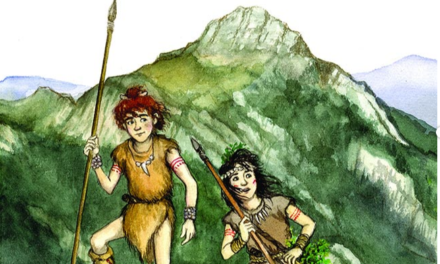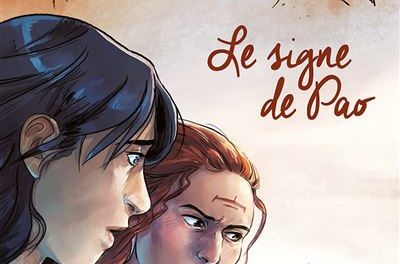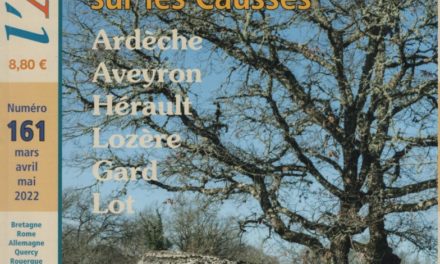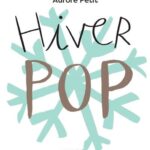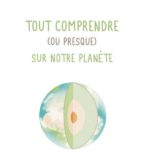Trésors, ouvrage de trente-quatre chapitres, est le produit de quatre années de chroniques de l’auteur dans le mensuel Archéologia.
Le choix du titre est explicité dans le propos liminaire, puisque le vocable est souvent la porte d’entrée du grand public mais également des médias vers la pratique archéologique. Après une évocation de ce que peuvent être les « trésors » de l’archéologie, l’introduction est aussi l’occasion de poser que « discipline totale, discipline dans la société, l’archéologie est (…) bien l’avenir du passé ».Le propos est ensuite structuré autour de cinq grands axes ayant pour titres respectifs « qui? », « quoi? », « quand? », « où? » et « comment? ».
Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire européenne et fondateur de l’INRAP.
« Qui ? » débute par un premier chapitre dans lequel est interrogé l’apport de l’archéologie sur l’enfance à travers l’archéologie funéraire mais également la problématique de la transmission des savoirs.
Suit une réflexion très stimulante sur génétique et archéologie (dans laquelle l’auteur rappelle, même si ce n’est pas l’objet principal de son propos, que « nous descendons toutes et tous, par une chaîne ininterrompue de copulations, du premier des primates, Purgatorius, sorte de souris qui trottinait il y a 65 millions d’années dans les Montagnes Rocheuses américaines »).
Le chapitre 3, « quand l’humanité était plurielle », présente Homo sapiens et les quatre autres espèces humaines avec lesquelles il a coexisté : Denisoviens, Homo naledi (identifié en 2015 en Afrique du Sud dans les grottes de Rising Star), Homo floresiensis (exhumé dans la grotte de Liang Bua, dans l’île indonésienne de Florès) et Néandertal.
C’est ce dernier qui est l’objet du chapitre suivant, avec un historique de son identification, l’origine de son nom et sa place par rapport à Sapiens.
L’avant-dernier chapitre de ce premier axe est consacré à l’archéologie de la santé et du soin (l’occasion, entre autres, de relever que la plus ancienne amputation reconnue date du début du Ve millénaire et concerne l’avant-bras d’un défunt d’une quarantaine d’années) ; le dernier, ayant pour titre « les invisibles », concerne l’archéologie des dominés, avec notamment un développement sur l’archéologie de l’esclavage et des résistances au pouvoir (J.-P. Demoule, op.cit, p.57 écrit qu’ « à chaque fois, des périodes marquées par des vestiges spectaculaires font place à ce que les archéologues, désappointés, nomment des « âges sombres ». Mais en réalité, il s’agit plutôt d’un retour à des communautés agricoles plus égalitaires et mieux à même d’exploiter leur environnement. Ces « âges » n’ont pas été forcément « sombres » pour tout le monde ! »).
« Quoi ? » s’ouvre sur les découvertes de Vix et de Lavau accompagnées d’une réflexion sur ce que sont les « celtes ».
L’archéologie des conflits (l’auteur y écrit, entre autres, que le premier conflit mondial a été l’occasion de s’interroger sur les limites chronologiques de l’archéologie. Il précise (p.72) qu’ « à ce jour, les vestiges les plus récents considérés comme relevant de l’archéologie ont été ceux de camps de prisonniers allemands en Normandie datant de 1948 »), les relations entre archéologie et Bible, entre religions et archéologie (p.86 : « sauf à leur profit, les religions n’aiment guère l’archéologie »), les faux (avec un passage sur « l’homme de Piltdown », un faux constitué d’un crâne humain médiéval et d’une mandibule d’orang-outang), les instruments de musique et les rapprochements entre art contemporain et archéologie (notamment avec Daniel Spoerri et son œuvre Le Déjeuner sous l’herbe) constituent le reste des chapitres de ce second axe.
« Quand ? » s’intéresse tout d’abord au devenir des vestiges lorsque change une époque.
Le chapitre suivant revient sur l’essor et les apports de l’archéologie médiévale (avec un passage très intéressant où l’auteur (p.123) rappelle, évoquant le père de Clovis, que « la tombe de Childéric (…) est l’exemple d’un métissage culturel complexe entre « Romains » et « Barbares » »).
Dans « les trésors d’un « peuple », J.-P. Demoule offre une réflexion sur ce qu’est une « culture » et dans le chapitre suivant, il revient sur les Dark Ages, les fameux « âges sombres » des archéologues. La chronique suivante analyse les rapports entre politique, identité et archéologie et le dernier chapitre (p.150) est l’occasion de définir l’archéologie « comme l’étude des vestiges matériels d’une société, quel que soit son éloignement dans le temps, et qu’ils soient ou non enfouis dans le sol ».
« Où ? » contient des chroniques sur les origines du peuplement de l’Amérique (la question de la « découverte » du continent faisant encore l’objet d’âpres débats), les communautés Jômon au Japon, les mouvements migratoires (p.172, l’auteur rappelle que « l’un des enseignements de l’histoire et de l’archéologie (est qu’) il n’y a pas d’identités ethniques ou nationales qui se perpétueraient inchangées au fil des siècles, sinon des millénaires »), les catastrophes et l’archéologie ( avec le désastre de Fukushima), les fouilles françaises à l’étranger et leur histoire et un dernier propos, « les trésors des contes de fées » , relatif, en partie, à la fouille de l’un des sites du tournage du Peau d’Âne de Jacques Demy.
« Comment ? » vient clôturer l’ouvrage. Dans « du danger de fouiller », J.-P. Demoule rappelle (p.200) que « toute fouille archéologique est avant tout une destruction ». Il évoque ensuite les destructions récentes de sites mis au jour en France et les difficultés de conservation des vestiges. Les rapports entre les sciences et l’archéologie sont ensuite abordés (p.212 : « ce qui fait de l’archéologie une science, ce ne sont pas les apports, indispensables, des autres sciences (…), mais ses raisonnements et ses mécanismes de preuve, qui incluent la « falsifiabilité », l’expérimentation et la prédiction »). Les dernières mesures législatives en matière de pratique archéologique, la question de la restitution de certains objets conservés dans les musées à destination de leurs pays d’origine, le pillage et l’écoulement de certains artefacts, l’ethnoarchéologie, la bande dessinée et l’archéologie, la question de la muséographie archéologique et un plaidoyer pour « un grand musée d’Archéologie nationale » structurent cette dernière entité.
L’ouvrage de J.-P. Demoule est d’une grande richesse. Polymorphe, il mêle une approche destinée à un public large et des réflexions épistémologiques de grande qualité.
Trésors, incontestablement, porte fort bien son nom.