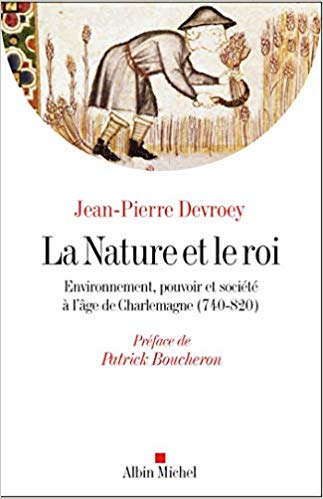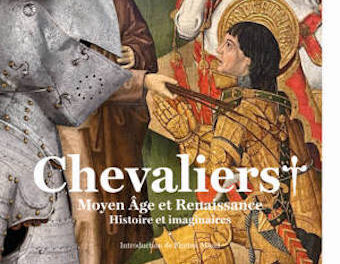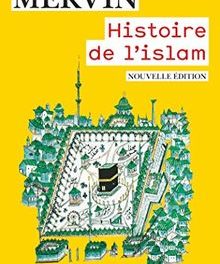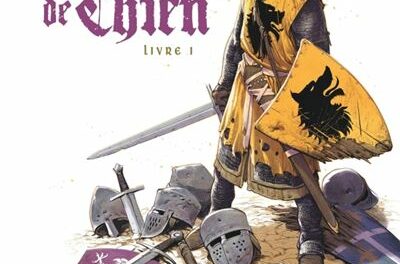C’est un livre important que les éditions Albin Michel publient. L’auteur, Jean-Pierre Devroey, professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, est bien connu des spécialistes du haut Moyen Âge pour ses études consacrées à l’économie rurale du monde franc.
Avec ce livre, l’auteur entend contribuer à l’écriture d’une éco-histoire du système social carolingien, affranchie de la « forme de néo-déterminisme naturel » qui, trop souvent, « attribue au climat le rôle de variable principale du changement social. » (p. 31) Il s’essaye là à une micro-histoire des dynamiques écologiques centrée sur la Francia, autrement dit le royaume des Francs dilaté du temps de Charlemagne, entre les décennies 740 et 820, même si l’auteur ne s’interdit pas des incursions jusqu’à la fin du règne de Charles le Chauve (877). Le règne de Charlemagne (768-814) constitue donc le cœur d’une enquête qui vise, par le biais des « calamités », à analyser les « relations entre le roi, le système social et la Nature en période de ‘crise’ alimentaire. » (p. 27)
Huit des treize chapitres du riche travail de l’historien nous plongent au cœur de quelques « crises alimentaires », principalement celles de 763-764, 779 et 792-794. Les pénuries alimentaires ne sont pas systématiquement liées à des conditions météorologiques défavorables : la pénurie ne découle pas mécaniquement du froid extrême qui sévit entre décembre 763 et mars 764 ; la crise de subsistance de 779, la première du règne de Charlemagne, intervient dans un contexte météorologique banal ; quant à la deuxième crise alimentaire du règne, elle ne s’explique par aucun événement météorologique contraignant. Ces pénuries sont par ailleurs spatialement différenciées et d’intensité inégale : la « grande faim » de 779, qui ne semble localisée que dans la région du Rhin, est sans doute le fruit d’une disette de soudure liée à l’insuffisance des moissons de l’été précédent et du manque de réserves pour nourrir les « pauvres gens » qui forment le gros de la population rurale ; quant à ce qui semble être la plus grave crise alimentaire du règne de Charlemagne (792-794), elle paraît avoir surtout touché « les régions méridionales du royaume franc, avec un foyer situé plus au nord, dans l’Est de la France actuelle » (p. 253). Pour les années postérieures à 800, l’empire est affecté par deux phases de crises, avec deux apogées, l’un en 805-809, l’autre en 820-824. Au cours de ces années, la répétition des intempéries a indéniablement impacté la productivité agricole des régions concernées. L’augmentation non négligeable des prix céréaliers en est un signe évident : ainsi, entre 794 et 806 (tarifs de Francfort puis de Nimègue), le prix du seigle augmente de 30%, celui du froment de 50% et celui de l’avoine de 100% !
Les contemporains n’ont pas manqué de chercher des clés d’interprétation aux épisodes de dérèglement « climatique » et de pénurie alimentaire. En 763-764, on considère que l’hiver, exceptionnel, est une « tribulation », soit une épreuve envoyée par Dieu en guise de réponse « aux fautes personnelles et collectives du roi [Pépin le Bref] et de ses sujets. » (p. 187) La Providence, croit-on alors, détermine l’équilibre de la Nature en fonction de la capacité du roi à régner dans la justice. De même, en 779, les sources écrites qui mentionnent la ‘grande faim’ laissent transparaître un certain trouble des élites quant à la « droiture » du roi Charles après les revers subis par les Francs face aux musulmans et aux Saxons.
De multiples indices laissent penser que la crise des années 792-794 n’est pas d’origine climatique. Les sources, qu’elles soient monastiques (abbaye de Metz-Gorze) ou civiles (capitulaire de Francfort), témoignent d’un certain malaise : « Pourquoi les grains de 793 pouvaient-ils être vus et touchés, mais ne pouvaient être mangés ? » (p. 260) Dans le capitulaire de Francfort, les élites du pouvoir franc attestent de l’abondance des récoltes mais constatent que les grains sont vides ; leur substance, affirment-ils, a été ‘dévoré[e] par des démons’ (p. 264). Il s’agit là de la reprise, christianisée, d’un motif folklorique : pour les habitants, il est bien connu que les déités de la Nature ont la faculté « de subtiliser des nourritures ou de les priver de leur valeur nutritive. » (p. 220) L’historien ne peut bien entendu se contenter de ce type d’explications : dans les chapitres 9 à 11, l’auteur se lance donc dans une passionnante enquête pour déterminer ce qui a pu provoquer cette crise. « Des prédateurs minuscules se dissimulent-ils derrière le motif des grains vides ? » (p. 305) Comme les sources occidentales n’en disent rien, Jean-Pierre Devroey opère un détour par la chronique syriaque de Zuqnin, une chronique chrétienne rédigée à la fin du VIIIè siècle dans le Nord de la Syrie contenant la description d’une crise alimentaire de trois années-récoltes, de 749-750 à 751-752. Le chroniqueur met en évidence l’action d’insectes ravageurs. Jean-Pierre Devroey formule alors un constat essentiel pour son analyse globale :
« L’exemple des années 749-750 et 750-751 montre […] qu’il est difficile de corréler mécaniquement les déficits de récoltes avec des événements météorologiques extrêmes (hiver 749-750) ou avec des changements climatiques plus lents, comme on le fait souvent. Les destructions de récoltes peuvent en effet découler directement de ces aléas (des semences d’automne détruites par un gel hivernal profond par exemple), mais, lorsqu’elles sont le produit de l’interaction des plantes cultivées avec leurs commensaux [ce qui semble être le cas ici], elles découlent de la synchronisation des cycles de vie des prédateurs et des plantes cibles. » (pp. 311-312)
L’auteur considère donc qu’en Syrie comme en Francia, les grains ont été victimes d’un insecte prédateur qui s’y est attaqué avant leur moisson et leur stockage. Au terme d’une passionnante enquête entomologique, l’auteur pense avoir identifié le responsable principal : un minuscule moucheron, une « cécidomyie » ou « mouche à galle »… Pour que les cécidomyies prolifèrent, il faut « un hiver froid ainsi qu’une forte humidité combinée à une fin de printemps ou un début d’été chaud et une faible rotation des cultures. » (p. 320) Contrairement au chroniqueur syrien, les moines de Gorze n’ont pas détecté le minuscule prédateur, mais seulement ses dégâts, pour des raisons sûrement culturelles :
« Une part importante des dégâts qui étaient provoqués par des insectes demeuraient littéralement incompréhensibles en raison du statut que ceux-ci occupaient dans la conception culturelle et religieuse du monde et de la Nature. Les croyances dans la génération spontanée inscrivaient les ravageurs dans une dimension téléologique [qui] faisait en quelque sorte de la dévoration des céréales par des insectes à l’intérieur d’un grenier une fin ontologique du grain, ce qui rendait sans doute les ravageurs imperceptibles et dès lors empêchait la mise en place de stratégies de défense et de préservation. » (p. 335)
La réparation des péchés révélés par les « calamités » passait par une démarche de réconciliation avec Dieu : cérémonies liturgiques, gestes de pénitence, appel aux élites à manifester leur charité et, surtout, rappel de l’injonction à payer les dîmes. Concernant les mesures de charité, on trouve par exemple dans le capitulaire d’Herstal II (779) des instructions visant à l’organisation par les grands ecclésiastiques et laïcs du royaume de liturgies et de mesures d’assistance aux pauvres victimes de la faim. Or, comme l’indique Jean-Pierre Devroey : « Le nombre insignifiant de pauvres faméliques à aider jusqu’à la prochaine moisson (1 à 4 personnes) place les mesures d’Herstal II dans le registre de l’action symbolique. » (p. 201) S’inscrivant dans une « économie providentielle », le paiement de la dîme constitue, quant à lui une « dette préalable » (p. 186) : l’action bienfaisante de la Nature oblige à un contre-don, soit l’offrande d’une part de la récolte. Qui tente de s’y soustraire commet une faute individuelle, forme majeure d’infidélité, à Dieu comme au roi, qu’il convient de réprimer. D’ailleurs, dans le récit du synode de Francfort sur les grains vides, les « voix de blâme » entendues après la dévoration des grains disaient qu’ « il fallait payer volontairement la dîme si on ne voulait pas mettre en péril le succès des récoltes assuré par la Providence. » (p. 280)
Le processus d’établissement de l’impôt décimal est relativement bien connu ; ses différentes étapes paraissent épouser la chronologie des crises complexes vécues par le pouvoir carolingien dans la seconde moitié du VIIIe siècle. C’est Pépin III qui, en 764 ou 765, instaure l’obligation pour tous de payer la dîme paroissiale, un tiers à un quart de son produit étant réservé à l’assistance aux pauvres de la paroisse. Cette obligation est rappelée dans le capitulaire d’Herstal I (779) comme dans d’autres documents jusqu’aux règnes de Louis le Pieux et de Lothaire, indication de la difficulté récurrente à convaincre les paysans de verser la dîme… Celle-ci joue pourtant un rôle notable en tant que dispositif de protection face à d’éventuelles difficultés :
« La dîme constituait […] un stock local de grains mobilisable en cas de soudure difficile, dans lequel on pouvait puiser des semences ou des secours d’urgence en cas de nécessité absolue. La portion de dîme réservée aux pauvres et aux voyageurs (un tiers à un quart) était également utilisée en temps normal pour soutenir ou parfois stipendier les plus fragiles au sein de la communauté paroissiale. La dîme peut donc être invoquée par les tenants de l’économie morale des campagnes comme un exemple d’application collective du principe de sécurité, puisqu’elle permet de constituer une réserve en cas de nécessité. » (p. 207)
En juin 794, l’assemblée générale de Francfort réitère l’obligation civile de verser la dîme paroissiale et l’accompagne d’un train de mesures économiques comme la fixation d’un prix maximum pour les céréales, la mise en vente à prix réduit des grains publics et l’introduction d’un nouveau muid. Si l’on a du mal à savoir si ces mesures énergiques prises pour pallier les effets des crises alimentaires furent efficaces, on peut dire qu’elles n’ont pas été reconduites par les successeurs de Charlemagne et, en tout cas, qu’elles vont bien au-delà de celles de 779 :
« L’ordonnance de 794 s’inscrit dans le cadre des idéaux de correction des sujets et de réformation de la société adoptés par Charlemagne et son entourage à partir des années 780 […]. Elle déborde largement de la sphère religieuse des rites propitiatoires (jeûne et prières), de la caritas (assistance et aumônes) et des échanges avec Dieu (obligation de payer la dîme), à laquelle l’action royale s’était limitée en 779, pour dégager les lignes d’ensemble d’une économie politique et morale des subsistances encadrant le marché et les transactions. » (p. 340)
Le livre dont nous n’avons donné qu’un bref aperçu est foisonnant et témoigne de l’impressionnante maîtrise de l’auteur dans de multiples domaines des sciences sociales et expérimentales. C’est à la fois un livre-étape (nombre de conclusions ne sont que provisoires) et un livre-programme (requérant sur de nombreux points un approfondissement des recherches) qui entend montrer la complexité des crises environnementales, inviter un certain nombre d’historiens à manier avec mesure et discernement le facteur climatique dans l’explication des crises alimentaires ainsi qu’à ne pas sous-estimer ou ignorer les « contraintes biotiques » (p. 313), en particulier la notion capitale de coévolution des phytophages et des plantes cultivées, et, enfin, à être moins sévères avec les sociétés du passé :
« Le croisement des données paléoclimatiques avec la ‘politique économique’ de Charlemagne et de ses successeurs, documentée par les capitulaires, contribue à briser l’a priori historiographique de la passivité et de l’irrationnalité de l’homme médiéval face aux ‘forces naturelles’. » (p. 361)
Par ailleurs, Jean-Pierre Devroey se livre à un beau travail critique sur les sources mobilisées. Il rappelle, évidemment, « qu’il ne faut pas attendre des chroniqueurs médiévaux qu’ils fassent systématiquement mention de tous les aléas ou de toutes les calamités auxquels ils assistaient. » (p. 176) L‘évocation dans les sources monastiques des « tribulations » est ainsi « un indicateur assez fidèle de la dégradation de l’image du roi dans l’opinion publique […]. Alors qu’au Palais on est peu disert, avant les dernières années du règne de Charlemagne et durant le règne de Louis le Pieux, sur les revers, les désordres ou les perturbations naturelles qui affectaient le royaume des Francs, cette retenue n’était pas de rigueur parmi les auteurs des annales monastiques. » (p. 232)
Enfin, le livre teste un certain nombre de notions et concepts utilisés ou proposés par quelques grands auteurs, historiens (E.P. Thompson), économistes (A. Sen) ou philosophes (M. Foucault). Parmi les nombreuses remarques intéressantes de l’auteur tirées de sa réflexion-confrontation, citons l’une de celles qui questionnent la « figure idéologique du roi nourricier qui a pu être endossée par Charlemagne » (p. 394) :
« Le roi […] était à la fois un père de famille (au sens archaïque du patriarcat restreint), le chef évolué (senior) d’une grande communauté domestique (oikos) et le maître placé par Dieu à la tête de la pyramide terrestre. La métaphore familiale était utilisée par les moralistes carolingiens pour insister sur le devoir d’exemplarité qui s’impose au souverain. Toutefois, Charlemagne ne pouvait pas, comme le ferait Louis XIV se présenter comme un ‘père’ auquel serait revenue exclusivement la responsabilité de nourrir son peuple, puisque la figure du nourricier suggérait ce comportement à tous les échelons de la hiérarchie féodale. » (pp. 147-148)
En dernière analyse, le livre de Jean-Pierre Devroey constitue une magistrale démonstration du principe suivant lequel un excellent chercheur doit se garder de confondre coïncidence et corrélation, corrélation et causalité…