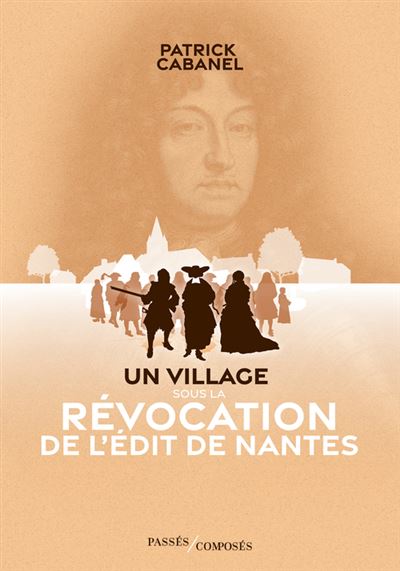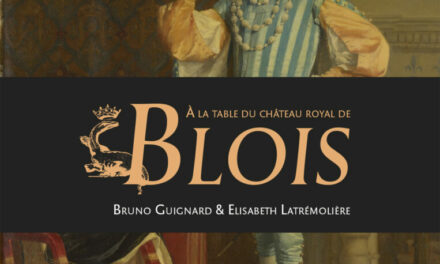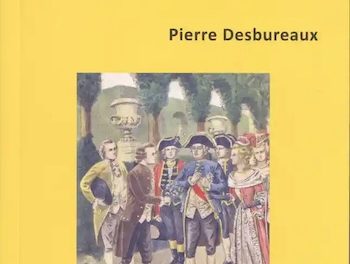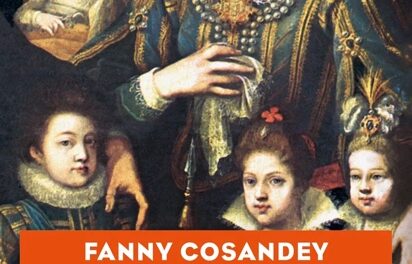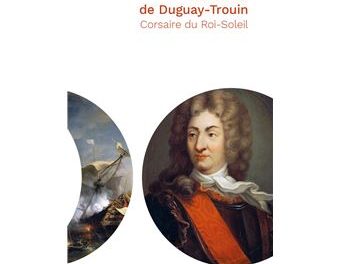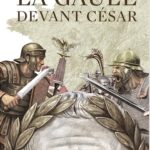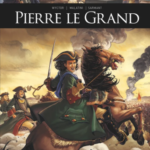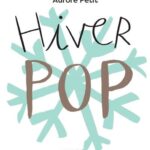Saint Germain de Calberte, au pied du Mont Lozère est un bon observatoire de la situation des protestants dans ces vallées étroites aux limites du Languedoc et du Vivarais. La Réforme y fut quasi généralisée vers 1560 et combattue avec vigueur au tournant du XVIIe siècle. C’est cet observatoire qu’analyse Patrick Cabanel, spécialiste d’histoire du protestantismeHistoire des protestants en France (XVIe-XXIe siècle), Fayard, 2012, son dernier ouvrage Un village sous la révocation de l’édit de Nantes.
La reconquête catholique au XVIIe siècle
L’état des lieux d’avril 1603, quelques mois après la promulgation de l’Édit de Nantes qui impose le rétablissement du catholicisme, montre bien l’écrasante adhésion au protestantisme. Le recul après les sièges de Montpellier, La Rochelle, la chute de Privas est acté dans les années 1620. La reconquête est menée par les Capucins, aidés des soldats de Louis XIII, elle est attestée lors des visites pastorales du diocèse de Mende (1631-1656).
À Saint Germain de Calberte, le poids de la seigneurie de la Marquise des PortesUne parente des Condés et des Conti, tante de Saint-Simon. Son père a été tué en 1629, au siège de Privas. a favorisé la reconquête. Célibataire, janséniste, la Marquise a été le bras armé de cette politique. Elle a laissé dans la mémoire collective l’image d’une femme cruelle. Son château est une forteresse tournée contre les vallées protestantes, elle abrite en tout temps une garnison des troupes royales.
L’auteur décrit la politique très ferme de la royauté, avant même la révocation de l’édit de Nantes : démolitions de temple, exil des pasteurs, installation de dragons (1683-1684). Il montre les moyens employés : la force, la justice, mais aussi l’achat de conversions dont il analyse les motivations, souvent l’extrême pauvreté.
Malgré tout, le nombre de huguenots reste important, il est estimé à 16 000 dans le diocèse de Mende404 familles pour 21 catholiques, dont les nouveaux convertis, à Saint Germain, d’après le curé Boissière..
La Nuit
Octobre 168518 octobre 1685, édit de Fontainebleau, ce sont des conversions générales, « la promenade victorieuse des dragons ». La Marquise, vu son zèle, espère en tirer avantage en s’emparant des biens des nobles en exil, comme en Vallée-Française. Les registres de baptêmes-mariages-sépultures protestants s’arrêtent le 9 octobre, quelques jours plus tard, on trouve dans les registres catholiques des listes d’abjuration.
Ceux qui refusent soit s’exilent, soit se cachent comme Jean d’André du Pont De Montvert dont l’auteur rapporte le sort cruel
Il rappelle le refus royal que soient enterrés les protestants ayant refusé d’abjurer. Il montre l’ampleur des risques pour les récalcitrants : mort, prison, confiscation de leurs biens, enfants envoyés dans des établissements religieux, son destin nous est connu par l’écho dans la communauté des réfugiés de Genève, Rotterdam, Berlin. Il prend d’autres exemples comme celui des pasteurs du Cros, père et fils : convertis, « collabo » dans la lutte contre les assemblées clandestines qui ont semble-t-il renoncés à l’exil.
Résistances
La Pâque 1686 est un test pour les nouveaux convertis : vont-ils se confesser ? Communier ? Sont-ils assidus à la messe ? La communion était un point de discorde majeur entre catholiques et protestants. Les rapports des curés montrent des conversions en demi-teinte, surtout chez les cadets de famille. Ils évoquent des « personnes qui roulent » dans le pays, qui se cachent. On parle bientôt de « désert ». La châtaigneraie entre peu à peu en dissidence. D’après Isabelle MaurinThèse de l’école des chartes 1984 : Les fugitifs huguenots du diocèse de Mende (1685-1689), les exilés représentent 5 % des protestants967 dans le diocèse de Mende
. Il existe aussi une résistance secrète, les assemblées sont organisées par des laïques, les « prédicants » comme François Vivens, Pierre Fraisses. On voit apparaître les « chants de psaumes dans les airs », des gens pensent avoir entendu chanter des psaumes, autosuggestion due aux remords des convertis ? Des textes que l’on retrouve dans le « Théâtre sacré des Cévennes », publié à Londres vers 1720.
L’assemblée du Clauzelet, en avril 1686, surprise, après dénonciation montre la situation des protestants dans ce secteur des Cévennes. L’auteur rapporte les faitsC’est un des épisodes du roman d’André Chamson, Les taillons ou la terreur blanche, Plon, 1974 en détail.
Malgré la répression, les assemblées se poursuivent, des pasteurs de retour d’exil, les organisent dans la clandestinité. L’auteur analyse la trace de ces événements dans la mémoire collective, dans les paysages.
Une centrale missionnaire : autour de l’abbé du Chaila
L’auteur décrit un trio très efficace dans la lutte contre les huguenots : La Marquise de Portes, l’intendant du Languedoc Nicolas Lamoignon de Basville et François de Langlade du Chaila, l’abbé du Chaila qui entre à Saint Germain de Calberte à l’automne 1686. C’est à ce personnage, inspecteur général des missions du diocèse de Mende, qu’est consacré ce chapitre.
Les protestants ne sont pas les seuls à dénoncer les tortures dont il s’est rendu coupable. Il met en place un contrôle étroit de la population à travers des écoles, des bureaux de charité, un séminaire à St Germain jusqu’en 1694 et un hôpital complète le dispositif au début du XVIIIe siècle.
Les filles des familles converties sont envoyées au couvent des Unies de Mende parfois plus en loin en Haute-Loire.
Hobereaux : des destins contrastés
On suit quelques familles de petite noblesse ou bonne bourgeoisie comme les Giberne, en exil à Londres et à Genève pour les uns, cherchant à limiter les spoliations pour les autres, ce qui ne les empêcha pas d’être la cible des Camisards.
Jean Deleuze parvint à fuir, installé en Allemagne, comme François Noguier, on voit comment ils cherchent à établir leur descendance, à les placer dans la société locale tout en gardant des liens avec le pays.
D’autres familles ont adopté le catholicisme, participant à la lutte contre leurs anciens coreligionnaires et embrassant des carrières militaires ou religieuses, comme les Privat de calberte ou les Verdelhan des Molles.
Conclusion : Au début du XVIIIe siècle, la situation reste incertaine. La Révocation a coûté cher en morts, déportations, destructions.
L’auteur, hélas, s’arrête, en juillet 1702, au moment où commence l’explosion, la révolte des Camisards.