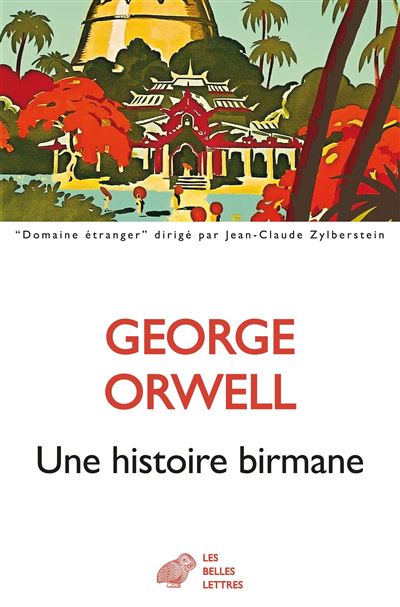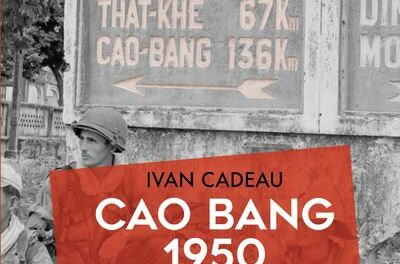Il y a quelque chose de pourri dans l’empire britannique, et cette pourriture, c’est l’empire lui-même.
La petite ville birmane de Kyautkada constitue un parfait microcosme de la société impériale en déliquescence que George Orwell méprise tout au long de son Histoire birmane. On y trouve un club européen qui regroupe ce qu’il y a de plus effroyable dans la gestion coloniale britannique : un racisme débridé, des individus violents regrettant « le bon temps » où les lois n’empêchaient pas d’appliquer des châtiments atroces aux birmans et des européens tuant le temps à grandes rasades de gin ou de whisky. Dans cette galerie peu avenante de « gestionnaires » de la petite cité, on trouve le protagoniste de ce sombre récit, J.Flory, qui est à la tête d’une exploitation de bois. Affublé d’une vilaine tâche de naissance qui lui a valu mille tourments et qui le complexe au plus haut point, l’homme passe pour un « bolchevique » auprès de ses condisciples anglais, tout simplement parce qu’il professe un intérêt pour la culture birmane et cultive une amitié sincère avec le docteur indien Veraswami, soutien indéfectible de l’administration coloniale en place.
Mais Flory est aussi un individu veule qui, lorsque son ami médecin lui suggère son soutien en vue d’intégrer le très fermé club européen de Kyautkada, se sent près tout bonnement à ne pas le soutenir. Son comportement avec une jeune birmane n’est guère plus reluisant et Flory, bien qu’un peu plus supportable que les autres européens présents dans la petite ville, regarde plus volontiers sa vie défiler qu’il n’entend agir par conviction ou s’engager à porter des idées généreuses. Tout cela jusqu’à ce qu’une jeune anglaise, Elizabeth, ne débarque à Kyautkada et que J.Flory ne caresse le dessein de l’épouser…
Une histoire birmane est largement inspirée des souvenirs de George Orwell lorsqu’il était officier dans les forces de l’ordre en Birmanie, entre 1922 et 1927. L’auteur y professe un profond dégoût du colonialisme, à l’instar de la tirade qu’il fait prononcer à Flory, page quarante-neuf, lorsqu’il évoque le mensonge de la promesse d’un développement lié à la présence britannique et où il déclare qu’il est faux de « prétendre que nous sommes ici pour le plus grand bien de nos pauvres frères de couleur alors que nous sommes ici pour les dépouiller, un point c’est tout. Je suppose que ce mensonge est on ne peut plus naturel. Mais il nous corrompt, il nous corrompt de diverses manières que nous n’imaginons même pas. Nous avons constamment le sentiment d’être des spoliateurs, des menteurs ; ce qui nous rend coupables et nous amène à nous justifier sans trêve ni répit. C’est là le fondement d’une bonne partie de notre conduite infecte à l’égard es indigènes. Nous pourrions être à peu près supportables, pour peu que nous voulions bien admettre que nous sommes des voleurs et que nous continuions à voler sans complexes ».
George Orwell, avec le formidable style alerte qui le caractérise, donne à voir un monde où tout n’est que calcul, mesquineries et chausse-trappes pour exister, et ce quelle que soit sa place dans cet univers d’où ne parvient aucune lumière. La beauté est éclipsée par la médiocrité ; la sincérité et le courage par la violence et la haine généralisées. Un vibrant plaidoyer anti-impérialiste !