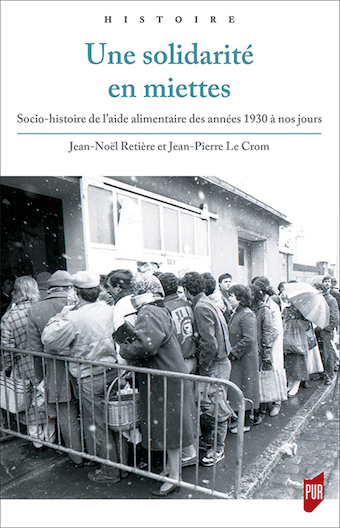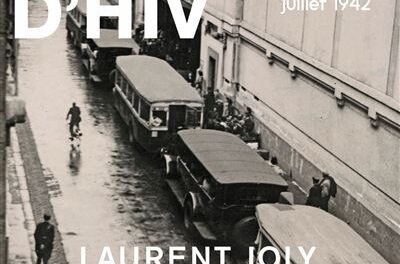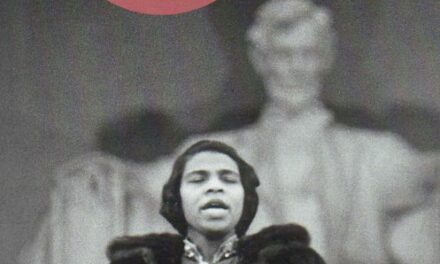L’association de l’historien Jean-Pierre Le Cromm, spécialiste des questions de protection sociale, et du sociologue Jean-Noël Retière dans le cadre de cet ouvrage est donc doublement heureux. Il permet en effet de concilier les deux traditions d’étude de la solidarité dans une approche socio-historique, à la fois comme trajectoire historique d’une idée dans la société française en même temps que mesure de la place que la solidarité occupe dans les questions socialesi. La solidarité acquiert ainsi une plus grande épaisseur historique, éclairant en même la croissance de cet enjeu – et ses limites – dans la société française contemporaine.
La réflexion sur les replis de l’État providence, lancée dans les années 1990 par quelques grands jalons, poursuivies par des monographies publiées dans les années 2000, engage depuis une dizaine d’années un tournant vers l’analyse des réseaux de politiques sociales, informée par l’analyse des politiques publiquesii. Cette histoire articule le passage d’une action « privée » des philanthropes et des organisations charitable à la coordination et la prise en charge d’une politique concertée de solidarité « souvent para-publique » et de « sécurisation de l’existence ».
Les auteurs proposent une chronologie large et « raisonnée », dont les segments sont les années 1930, l’occupation, les Trente Glorieuses et les recompositions ouvertes depuis les années 1980 (le « moment contemporain » signalé se justifie davantage par un changement de matériaux au profit des entretiens plus que des archives). Ce livre prolonge une étude réalisée sur le traitement de deux « actions ciblées » (nourrir et vêtir – à l’exclusion donc des questions de soin ou d’emploi) dans l’agglomération nantaise. Mais les axes qui retiennent leur attention sont plus stimulants pour la réflexion et insistent sur les éléments structurants.
Dans un premier chapitres, les auteurs posent le « cadre » évolutif d’application des politiques de l’aide d’urgence. Ils rendent ainsi compte des inflexions chronologiques de ces politiques. Dans un premier temps, les restaurants municipaux sont l’instrument d’une politique de secours qui fluctue en fonction du contexte et des aidant. Les restaurants incarnent cette « aide publique consolidée » [28] en face des entreprises charitables ou philanthropiques le plus souvent confessionnelles. de l’évolution des acteurs engagés (locaux, nationaux et européens). L’occupation constitue une sorte de tournant car Vichy met en place une politique active d’aide aux victimes de la guerre et des privations : le Secours national mobilise « ses 12 000 salariés environ, ses 43 000 bénévoles, des ressources qui dépasseront les 20 milliards de francs entre 1939 et 1945 » [37] pour nourrir, mais également pour vêtir une population importante de réfugiés. Certes l’objectif est de conforter une popularité fragile, mais le volontarisme engagé en fait une politique importante du régime ; le lecteur en trouvera dans l’ouvrage et dans celui qu’à écrit par ailleurs J.-P. Le Crom le compte rendu chiffré dans le détailiii. L’épuration désorganise cette mécanique avant que le Secours populaireiv et le Secours catholiques, entre autres, viennent recomposer le secteur associatif du secours dans le contexte des Trente Glorieuses. A la pauvreté des catégories populaires se substituent des figures de la marginalité définie comme un quart monde de vieillards et de veuves. Enfin, dans les années 1980, les pouvoirs publics développent et coordonnent une action en direction des plus démunis à toutes les échelles. Il serait assez vain de résumer tous les acronymes et tous les acteurs engagés tant il y a en a – signalons toutefois au passage la Banque alimentaire et les Restos du Coeur –, dessinant le maillage serré et multiple d’une aide sociale en plein développement dans un contexte de crise. L’histoire proposée dans l’ouvrage traite à part égale les initiatives très localisées et les grandes tendances, par exemple dans l’explication du rôle des CCAS, documentant le tout avec une grande précision. Cette épaisseur se révèle à la fois passionnante et instructive.
Elle permet ainsi d’autant de mieux de comprendre les profils de bénévoles et de secourus (chap. 2 et 3). L’évolution du bénévolat commence a être connue, mais la transformation, appliqué au territoire nantais est impressionnante. A côté des réseaux denses de notables – très – conservateurs de la société Saint-Vincent-de-Paul se développe dans les années 1930 une aide associative soutenue par les municipalités de droite comme de gauche qui recycle les anciennes élites et en ajoute de nouvelles issues des classes moyennes et de la petite bourgeoisie. Ce jeu se complète d’une nouvelle strate avec le développement du Secours populaire et du Secours catholiques qui diversifient la sociologie des bénévoles en direction des catégories populaires et des professions intermédiaires (enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de santé). On assiste en même temps qu’à celle de l’origine des bénévoles à une diversification des motivations du secours, depuis la charité chrétienne ancienne vers la « justice sociale » [134] en passant par l’impératif de solidarité, le plus souvent en clamant un apolitisme qui permet d’échapper aux critiques. Symétriquement, l’indigent dans sa marginalité fait progressivement place aux nécessiteux, associés au contexte défavorable des crises et des sorties de crise, avant l’émergence des « exclus » pendant les Trente glorieuses, catégorie plus adaptable et moins morale qui se prolonge jusqu’à maintenant.
Parlant de morale, la question de la forme prise par le secours donne lieu à des développement sur la micro-économie morale qui se joue dans le don (chap. 4). Le choix du don en nature ou en argent révèle le rapport ancien mais toujours d’actualité entre le « bon » et le « mauvais » pauvre, le don en nature dans un « colis » permettant d’aider dans une mauvaise passe dans une posture « paternaliste » qui se méfie des détournements du don par le pauvre [190]. Le don en argent pose en effet de manière récurrente la question de la « bonne dépense » et constitue la marge plus que la norme dans la relation entre donneur et receveur ; tout au plus une médiation s’organise dans les années 20 et 30 par les bons remis aux commerçants. Ces bons proscrivent l’alcool, signe là encore de ce que le don est affecté d’un sens moral : « du pain, pas de vin » [191] et des rations dont le contenu et la quantité sont hygiéniquement pensés. A l’inverse, la pratique de la visite sociale s’est effondrée tant elle apparaissait comme une intrusion et l’expression d’un paternalisme odieux au receveur, remplacée par des logiques de comptoirs qui ne sont pas sans rappeler la « vie au guichet », modèle d’organisation administrative dans le champ de l’aide social.
Car la rationalisation n’est pas absente de l’univers de l’aide sociale. En effet, les œuvres dépendant des dons – un tiers seulement du budget de la Banque alimentaire en 2008 par exemple – et des subventions – qu’il faut minorer pour ne pas désespérer les donneurs –, la question de la « bonne dépense » s’est retournée pour mettre en lumière l’usage des fonds par les associations d’aide. La professionnalisation progressive du secours fait des bénévoles la première ligne de lutte contre la précarité par la gestion des dossiers [167 sq. et chap. 6]. Mais les auteurs rappellent toutefois que l’analyse par la professionnalité ne doit pas être conduite contre les « valeurs de désintéressement et de justice sociale » qui guident l’action des salariés. Ils y trouvent des rétributions matérielles, mais également des rétributions symboliques en termes de savoir faire dans le traitement des populations ciblées, ainsi qu’une forme de reconnaissance des compétences dans le cadre de la hiérarchisation interne aux associations des missions et des tâches. Mais si le discours de l’efficience s’impose, nous restons cependant en dehors des logiques entrepreneuriales de recherche du profit [237], frontière qui n’a pas été brouillée qu’en apparence par le développement de politiques d’achats des denrées par les associations. La rationalité globale sert davantage une politique humanitaire fondée sur la notoriété, aussi utile aux associations qu’aux pouvoirs publics qui les subventionnent aux différentes échelles.
Les auteurs en concluent à une spécialisation croissante des acteurs associatifs para-public, en lien avec la professionnalisation d’une partie de leur personnel et la normalisation de leur action sanctionnée par des financement public, souvent municipaux. Ce changement affecte la signification de leur action : la question sociale et la justice sociale qu’elle promeut se transforme en question humanitaire ; la dignité et la vulnérabilité des populations qui passent à travers le filet des assurances sociales mises en place depuis les années 1930 devient centrale. Il apparaît également que les dispositifs, depuis les restaurants municipaux des années 1930 aux distributions effectuées par les associations humanitaires contemporaines partagent à travers le temps leur modestie de fait. Les auteurs insistent toutefois sur l’impact global de ces politiques locales qui engagent des citoyens et des pouvoirs publics au point de « faire champ » et de construire des questions en problèmes d’action publique : politiques d’insertion, de socialisation et d’assistance, dans le cadre du plan précarité pauvreté de la fin des années 1980 par exemple [274], doivent une partie de leur existence à l’expertise du travail associatif qui s’est également nourri des savoir faire de l’encadrement d’État pour bâtir sa propre professionnalité, et les auteurs développe le cas intéressant des épiceries solidaires qui tendent à introduire une nouvelle dynamique par la demande d’une contrepartie aux bénéficiaires. Ou comment par le service social produit de la réaffiliation et de l’insertion…
L’ouvrage rend ainsi compte des questions humanitaire « par le bas » et le local. Les auteurs ont l’intelligence d’éviter la plupart du temps les approches surplombantes fondées sur de grands discours sur l’humanitaire pour examiner comment l’humanitaire est saisi par et sur le terrain. Sans nécessairement chercher à mettre en doute les bonnes intentions contenues dans les discours, ils rendent lisibles les mécanismes de construction d’une question comme enjeu humanitaire inséré dans une organisation plus large du social. Certes cette posture peut limiter la possibilité d’en généraliser les résultats – les auteurs l’assument mais on est fondé à penser que c’est une honnête précaution plus qu’une évidence. On en veut pour preuve la dimension souvent fine et anthropologique qui est faite des logiques concrètes du don.
i Bec Colette, L’assistance en démocratie. Les politiques assistantielles dans la France des XIXe et XXe siècles, Paris, Belin, 1998, 254 p.
ii Nous renvoyons aux nombreuses références bibliographiques citées en notes dans l’ouvrage.
iii Hesse Philippe-Jean et Le Crom Jean-Pierre (eds.), La protection sociale sous le régime de Vichy, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2001, 377 p. ; Le Crom Jean-Pierre, Au secours, Maréchal ! L’instrumentalisation de l’humanitaire (1940-1944), Paris, France, Presses universitaires de France, 2013, 343 p.
iv Brodiez Axelle, Le secours populaire français (1945-2000) : du communisme à l’humanitaire, Paris, Presses de Sciences Po (coll. « Histoire »), 2006, 365 p.