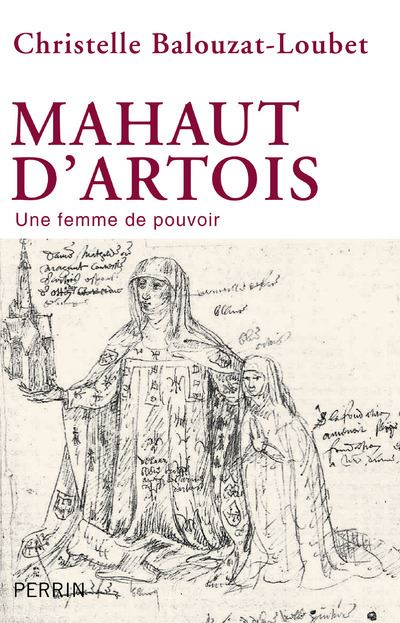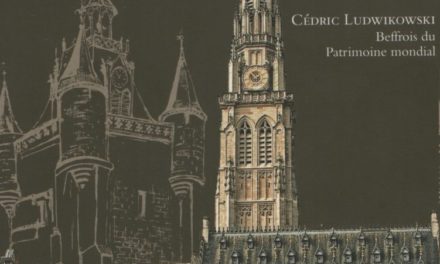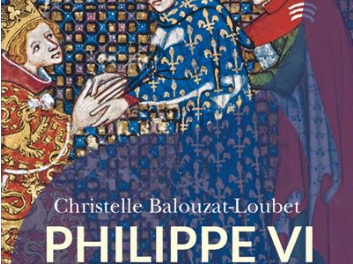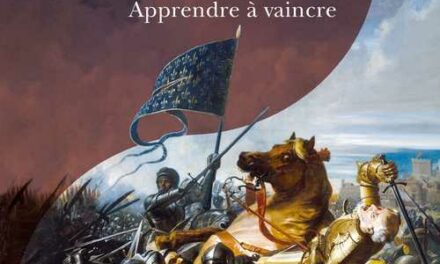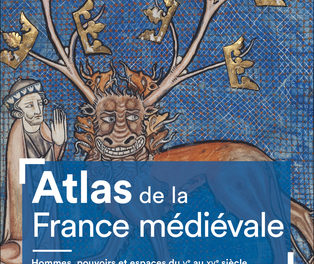Compte rendu est écrit par Esther Frisch, étudiante en hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet à Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Christelle Balouzat-Loubet est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l’université de Lorraine à Nancy. Agrégée d’histoire en 2000, elle a soutenu en 2014 une thèse de doctorat intitulée Le gouvernement de la comtesse Mahaut en Artois (1302-1329) en 2014. Elle a publié des articles et ouvrages qui se concentrent essentiellement sur le XIVe siècle, notamment Louis X Philippe V Charles IV : Les derniers Capétiens en 2019. Sa dernière parution en date a pour titre Philippe VI : Le premier des Valois en 2023.
Sa biographie de Mahaut d’Artois, personnage peu connu autrement qu’au travers de la figure qu’elle incarne dans Les Rois Maudits, parait en 2015 aux éditions Perrin. Ecrit à l’imparfait, cet ouvrage s’organise autour de huit chapitres thématiques et chronologiques, divisés chacun en trois sous-parties et précédés d’un avant-propos et d’une introduction, suivis d’un épilogue. L’autrice essaie de reconstituer l’histoire de Mahaut, comtesse d’Artois – ancienne province du nord du royaume de France avec pour villes principales Arras, Saint-Omer et Béthune – et de Bourgogne palatine, dame de Salins. Elle analyse l’histoire de la puissante comtesse, de son organisation administrative à ses stratégies de pouvoir en passant par les épreuves qu’elle rencontre tout au long de sa vie. Pour cela, elle retrace le parcours de la comtesse, de la naissance jusqu’à la mort, passant par ses histoires de familles, l’organisation de son pouvoir, ses tactiques pour afficher sa puissance et les évènements qu’elle a traversés. A la lecture de cette biographie, Mahaut compte indéniablement parmi les personnalités les plus influentes de la cour et du royaume de France dans le premier quart du XIVe siècle.
Résumé
Christelle Balouzat-Loubet amorce son ouvrage par la présentation de la place de Mahaut et de sa famille sur l’échiquier politique. Mahaut appartient à un lignage prestigieux : née vers 1270, elle est la fille de Robert II (comte d’Artois) et d’Amicie de Courtenay (dame de Conches et de Mehun). Petite-nièce de Louis IX, Mahaut est une princesse de sang royal. Elle se rattache à la dynastie capétienne par ses deux parents. La future comtesse d’Artois reçoit une formation conforme aux conceptions pédagogiques de son temps : bonne chrétienne éduquée aux bonnes manières, maîtrisant la lecture et l’écriture, pratiquant l’équitation et la chasse et connaissant les échecs. Le mariage de Mahaut avec Othon en 1285 est un acte éminemment politique qui doit servir les intérêts de chacune des deux familles. Instrument du rapprochement franco-bourguignon, cette union hypergamique avec la princesse capétienne doit permettre à Othon, seigneur de Salin et comte de Bourgogne, une alliance avec le roi de France. De ce mariage naissent cinq enfants dont Jeanne (future reine de France). Le mariage entre Jeanne et Philippe de Poitiers scelle le rapprochement entre les comtes de Bourgogne et la monarchie française. Le destin de Mahaut bascule quand meurent successivement son père et son mari.
Dans un deuxième chapitre, on découvre l’ascension au pouvoir de Mahaut. Elle reçoit l’héritage à la place de son neveu Robert à la mort de son frère Philippe. Mahaut et Othon se retrouvent à la tête de l’un des plus importants apanages du royaume et ils prêtent fidélité à Philippe le Bel en 1302. Ils intègrent le cercle restreint des pairs de France et acquièrent une assise territoriale, féodale et politique dans le royaume. Or Othon, blessé au combat, meurt à Melun en 1303. Désormais seule face à un enjeu de taille, elle doit gérer l’éducation de ses enfants, faire fructifier son patrimoine et commander l’apanage. Mahaut assoit sa légitimité en s’appuyant sur sa proximité avec la famille royale, visible dans les armes du comté d’Artois et son écu est semé de trois fleurs de lys. Marraine et belle-mère de Charles, troisième fils du roi, Mahaut se construit ainsi une relation privilégiée avec les rois. Elle se pare des qualités du bon prince, ce qui souligne l’importance de la dynastie artésienne. La célébration durable de la mémoire de son père d’une part, les funérailles somptueuses et minutieusement préparées des membres de sa famille d’autre part, sont autant de manifestations de grande envergure de sa richesse et d’opérations de légitimation de son pouvoir. Forte de son choix de ne pas se remarier, Mahaut s’épanouit dans son rôle de femme de pouvoir.
Le troisième chapitre s’intitule Gouverner un apanage. L’espace artésien est un carrefour géographique et économique dont bénéficient les villes de Saint-Omer et d’Arras. Les possessions de Mahaut regroupent des biens fonciers – châteaux et terres. Cette solide assise territoriale lui permet d’assumer financièrement sa position, et elle devient un élément d’unité dans un ensemble géographiquement, économiquement et culturellement disparate. Mahaut est bien entourée. Elle délègue une partie de son pouvoir aux institutions administratives mises en place par ses prédécesseurs. Dans un logique féodale, elle transmet des pouvoirs à des baillis qui la représentent fidèlement en tout point de la principauté et qui incarnent le pouvoir comtal au niveau local. Elle dirige un conseil comtal qu’elle réunit selon un rythme variable et qui forme l’organe décisionnel du comté. Son lieutenant Thierry de Hérisson gère le comté durant ses absences. Ces hommes sont un relais indispensable de son autorité dans un milieu exclusivement masculin, ce qui ne l’empêche pas de défendre elle-même ses intérêts auprès du roi.
Dans un quatrième chapitre, Mahaut mène un mode de vie princier. Son hôtel, qu’elle réorganise, est un monde composite mais hiérarchisé en fonction des cercles les plus intimes de Mahaut. L’essentiel de ses ressources lui vient des recettes du domaine artésien perçues par les baillis mais elle profite également du dynamisme urbain et des revenus de l’activité judiciaire. Elle finance ainsi son grand train de vie : réceptions à la cour, bijoux, étoffes, pièces d’orfèvrerie. Mahaut parcourt à un rythme soutenu des distances importantes, jusqu’à 3000 kilomètres en une année. Ces itinérances, nécessaires en raison du caractère éclaté du patrimoine comtal, ont aussi leur utilité : se déplacer, c’est se montrer et c’est faire une véritable démonstration de puissance. Lors des déplacements comtaux, c’est toute une micro-société qui se déplace, et la théâtralisation de son pouvoir fait de ses voyages des instruments de domination politique. Au total, son organisation lui permet de surveiller ses domaines et de rester au plus près de la politique du royaume. Lorsqu’elle n’est pas sur les routes, elle passe le plus clair de son temps dans ses résidences à Paris dans l’hôtel d’Artois, au manoir de Conflans et à Hesdin. Plus que de simple fonction résidentielle, ses demeures permettent à Mahaut d’afficher sa richesse. L’état de prospérité dans lequel elle se trouve est cependant difficile à maintenir : Mahaut doit livrer bataille pour protéger son patrimoine, sa légitimité et son honneur.
Le cinquième chapitre traite des premières difficultés rencontrées. Mahaut doit composer avec les villes artésiennes dans lesquelles elle intervient. Sa relation avec les Audomarois dégénère en 1305-1306 en une révolte populaire que la comtesse réussit à mater. Elle fait de Saint-Omer un exemple et impose une sanction financière exorbitante. De nombreux litiges jalonnent le règne de la comtesse qui, acharnée, défend son héritage. Les combats judiciaires de Mahaut montrent l’importance qu’elle accordait à l’assise territoriale de son pouvoir comme support de sa puissance politique et témoignent de la société médiévale dans laquelle la justice est garante de l’ordre social.
En 1302, le roi se prononce en faveur d’Othon et de Mahaut au détriment de Robert, encore jeune, pour administrer l’Artois. Robert s’oppose dès 1307 avec l’appui de sa mère, Blanche de Bretagne, mais il est débouté en 1309 par le parlement de Paris. Il devient le pire ennemi de Mahaut. Les filles de Mahaut sont mêlées au scandale dit « de la Tour de Nesle » en 1314. Marguerite de Bourgogne et Blanche, belles-filles du roi, entament une relation avec les frères d’Aunay, des nobles normands, avec l’aide de Jeanne. Le crime amène le doute sur la légitimité de la descendance royale : les frères sont exécutés et les trois brus sont renvoyées de la cour et enfermées. Mahaut, comme trahie par ses propres filles, traverse une rude épreuve car les liens entre dynastie capétienne et comtes d’Artois sont remis en cause.
Christelle Balouzat-Loubet montre dans ce sixième chapitre l’aspect stratégique, guerrier et obstiné de Mahaut. La révolte des nobles éclate à l’automne 1314 et dénonce l’ingérence royale. Mais la comtesse ayant toute souveraineté sur l’apanage d’Artois, les révoltés se tournent vers elle. La révolte est menée par de puissants personnages comme Jean de Fiennes. Ils contestent la réduction de leurs droits et pouvoirs. Mahaut reste obstinée dans son refus d’accéder aux demandes nobiliaires. Elle se voit ôter la légitimité de la direction de l’apanage et se réfugie à Paris. La situation de Mahaut est critique, dépossédée de son domaine et de l’essentiel de ses ressources financières. La mort de Louis X deux ans seulement après celle de son père, laisse le trône sans héritier mâle. Robert d’Artois dévoile alors ses ambitions de reprendre son héritage par les armes. Le régent, gendre de Mahaut intervient en mobilisant son armée contre Robert. Une trêve est conclue en 1317. Le fils posthume de Louis X meurt cinq jours après sa naissance et Philippe de Poitiers devient Philippe V le Long. Seule femme pair de France, Mahaut retrouve sa place dans les plus hautes sphères du pouvoir.
Le septième chapitre aborde nouvelles épreuves qui ébranlent Mahaut. Une rumeur, conforme à l’imaginaire médiéval, circule selon laquelle Mahaut aurait empoisonné Louis X le Hutin. La soudaineté de sa mort et l’accession au trône de son gendre semblent être un trop heureux hasard. Le roi a intérêt à ce que sa belle-mère soit innocentée et il prononce finalement une sentence d’absolution. Son honneur est cependant profondément et durablement sali.Parallèlement à cette affaire, elle perd en 1317 son seul fils survivant, l’héritier du comté, Robert. Elle organise des funérailles grandioses qui rappellent sont rang et ses origines prestigieuses, alors même que se joue au Parlement le second procès de dévolution de l’Artois. Malgré son deuil douloureux, elle en sort victorieuse et se voit confirmée pour la seconde fois à la tête du comté. Les derniers feux de la révolte nobiliaire perdurent : Philippe V donne gain de cause aux nobles en échange de leur obéissance à la comtesse. Lorsqu’elle revient en Artois, tout est à reconstruire, il faut reprendre en main le territoire et les institutions administratives et restaurer le lien de confiance avec ses vassaux, une bataille dans laquelle elle se lance avec détermination.
Dans ce dernier chapitre, Mahaut revient en Artois et prépare activement son salut. Elle renoue étroitement avec les valeurs chrétiennes par des actes de piété et de charité ostentatoires. Son second testament de 1318 témoigne de sa dévotion par des legs à des abbayes artésiennes et à des hôpitaux. Elle incarne ainsi un rôle de protectrice de l’Église. Elle commande son propre tombeau en 1323. L’arrivée au pouvoir de la dynastie des Valois joue en faveur de son neveu Robert, frère de la nouvelle reine, qui intente un troisième procès à sa tante en 1329. C’est en novembre de cette année que Mahaut, 59 ans, s’éteint à Paris dans des circonstances obscures. Elle est inhumée aux côtés de son père.
Appréciations
Christelle Balouzat-Loubet fait naître progressivement une proximité avec cette femme d’un autre siècle. Les différents aspects de la vie de Mahaut sont expliqués et analysés : épouse et mère, comtesse réformatrice et dirigeante obstinée, pair du royaume de France et proche de la famille royale, elle mène sa vie entre richesse, royauté, procès et contestations de son pouvoir. Les hasards de l’héritage la propulsent sur le devant de la scène médiévale et elle s’y maintient entre ses stratégies filiales, territoriales, relationnelles et judiciaires. Mahaut est érigée en exemple d’une femme qui a réussi à imposer son autorité et sa personne à la tête de plusieurs domaines, et ce malgré son temps défavorable au pouvoir féminin.
La lecture de l’œuvre est agréable et se fait facilement, on se retrouve bien dans la chronologie de la vie de la comtesse Mahaut grâce aux chapitres chronologiques et thématiques de structure semblable. L’avant-propos puis l’introduction permettent de faire le lien entre la fiction –Les Rois Maudits- par le biais de laquelle on connaît souvent Mahaut et la réalité du personnage historique, dont l’histoire est aussi celle du royaume de France. Autrice de l’une des rares biographies sur ce personnage médiéval, Christelle Balouzat-Loubet met en lumière et rend comme un hommage à une femme de pouvoir au Moyen-Âge qui a construit les ensembles sur lesquels elle a ensuite exercé sa souveraineté.
Mahaut d’Artois est un ouvrage pour tout public, abordable sans connaissance préalable sur le sujet : des cartes et une généalogie des personnages historiques sont présentes au début de l’œuvre, ce qui facilite la compréhension des jeux d’influence et de pouvoir, importants au Moyen-Âge. Christelle Balouzat-Loubet nous donne un nouveau regard sur ce que c’est que d’être une femme de pouvoir et d’influence au XIVe siècle.
Christelle Balouzat-Loubet montre bien comment, comme d’autres figures féminines de l’histoire souvent oubliées, Mahaut, par son œuvre politique, réussit à se forger une place à la cour du royaume de France au XIVe siècle et se fait aussi une place dans l’histoire de France.