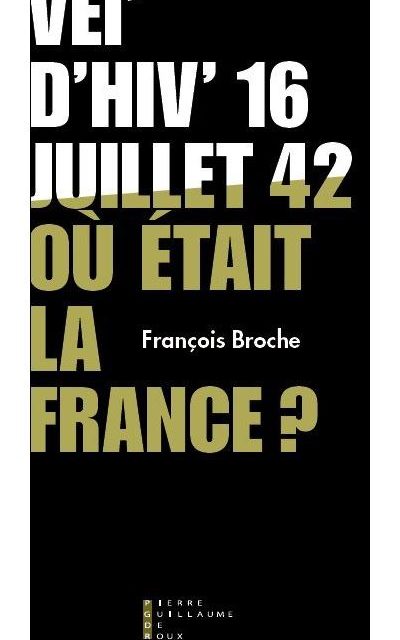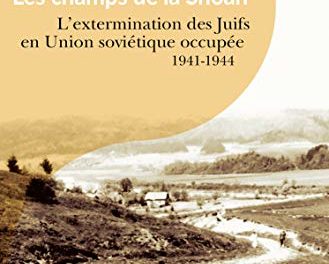Un ouvrage historique
L’ouvrage évoque d’abord la rafle et son contexte historique. Dans le cadre de la « solution finale « décidée par les nazis au début de 1942, le général Karl Oberg, nommé par Hitler « chef suprême de la SS et de la police « pour la France, et le préfet René Bousquet, nommé secrétaire général de la Police par Pierre Laval au lendemain de son retour au pouvoir le 18 avril 1942, signent le 2 juillet 1942 des accords qui prévoient que la police française procèdera à l’arrestation de 27000 Juifs étrangers ou apatrides à déporter en Allemagne. Présentés par Laval le lendemain, lors d’un conseil des ministres réuni à Vichy sous la présidence de Pétain, ces accords ne provoquent aucune critique. Vichy y voit la reconnaissance de la souveraineté du gouvernement français en zone occupée, en ce qui concerne l’action policière. Bien qu’il ait été recommandé que l’affaire ne soit pas ébruitée, beaucoup sont conscients qu’un événement se prépare. « Il semble que ce soient les SS qui aient pris le commandement en France et que la terreur doive s’ensuivre » note Hélène Berr. Si tous les Juifs sont victimes d’exclusion, les Juifs étrangers sont particulièrement menacés : dès le 4 octobre 1940, le maréchal Pétain autorisait leur internement dans des camps spéciaux, et en 1941, de nombreux juifs étrangers avaient été arrêtés et internés. Lors de la préparation de la rafle, les consignes données aux 9000 policiers (on apprend dans l’ouvrage que plusieurs centaines d’hommes du PPF de Jacques Doriot ont participé à la rafle) sont très strictes. Bien que des fuites aient permis à de nombreux juifs d’y échapper, 13 000 personnes sont arrêtées, 6 000 sont transférés à Drancy (les personnes n’ayant pas d’enfants de moins de 16 ans) et 7 000 enfermés au Vélodrome d’ hiver dans des conditions effroyables. L’inhumanité de la rafle, et en particulier la séparation des parents de leurs enfants, provoqua un grand trouble dans l’opinion et au sein de l’épiscopat. Les rafles de l’été et de l’automne 1942 (12 000 Juifs sont acheminés à Drancy), provoquent la protestation de nombreux évêques (parmi lesquels l’archevêque de Toulouse ou l’évêque de Montauban) et pasteurs. Laval feint d’ignorer le sort qui était réservé aux Juifs, et Pétain ne manifeste aucune réaction malgré de nombreuses protestations. Le sort des juifs de France était indifférent au régime de Vichy qui entendait privilégier ses bonnes relations avec l’occupant. Vichy porte la responsabilité des arrestations et la plaque commémorative apposée à l’emplacement de l’ancien Vel d’hiv évoque « les juifs… parqués dans des conditions inhumaines par la police du gouvernement de Vichy sur ordre des occupants nazis ». Pour l’auteur ce texte traduit exactement la vérité historique, justement parce qu’il ne parle pas de la police française, mais de la police de Vichy.
C’est là en effet que réside le coeur de l’argumentation de François Broche. Vichy n’était pas toute la France et n’était ni légal, ni légitime. Le 25 août 1944, De Gaulle avait refusé de proclamer la République et déclarait : « La République n’a jamais cessé d’être. La France Libre, la France combattante, le comité français de la Libération nationale l’ont, tour à tour, incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. » Vingt ans plus tard, il expliquera à Alain Peyrefitte : « L’ordre de Vichy était caduc, par le fait même que ce régime n’était pas libre. Ces gens ont commis l’erreur de croire qu’ils allaient pouvoir faire une révolution nationale tout en étant asservis.» La légalité et la légitimité du régime de Vichy sont contestables. Nommé Président du Conseil le 16 juin 1940, Pétain n’a pas été investi par l’Assemblée nationale. Les Parlementaires réunis à Vichy le 10 juillet 1940 ne pouvaient ni déléguer à Pétain leur pouvoir constituant, ni renoncer à la forme républicaine du régime. Quant à la popularité du régime elle doit être relativisée et Jean–Pierre Azéma a bien distingué le maréchalisme du pétainisme. La France Libre bénéficiait d’une reconnaissance internationale. Dès le 28 juin 1940, Churchill reconnaît De Gaulle comme « chef de tous les Français Libres » et progressivement, les États étrangers reconnurent la légitimité de la France Libre. De Gaulle s’attacha également à donner des bases légales à la France Libre. Le 27 octobre 1940, il institua un « Conseil de défense de l’Empire » et accompagne cette création d’un bref Manifeste : « Il n’existe plus de gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom, est inconstitutionnel et soumis à l’ennemi ». Il ne fait aucun doute que De Gaulle incarnait la légitimité. « Nous sommes la France » disait il à René Cassin, peut être en référence au vers célèbre de Corneille dans Sertorius : « Rome n’est plus dans Rome, elle est toute où je suis. »
Les Présidents de la République et les persécutions antisémites
François Broche analyse ensuite la manière dont les Présidents de la République ont considéré les persécutions antisémites. De Gaulle, marqué par Péguy, avait rapidement condamné les mesures antisémites de Vichy et dénoncé les « honteuses horreurs de la persécution juive ». Georges Pompidou, qui reconnaissait lui même avoir peu résisté, critiquait l’évocation de la Résistance, souhaitait « jeter le voile » sur le passé et gracia le milicien Touvier. Il fut « un président attentiste qui cachait à peine son hostilité à la Résistance ». Il ne condamna jamais Vichy et sa politique antisémite. Bien que certains membres de sa famille aient été proches de Vichy, Valéry Giscard d’Estaing s’engagea dans la Première Armée du général de Lattre de Tassigny. Lors d’une visite à Auschwitz le 18 juin 1974, il évoqua avec émotion la rafle et l’arrestation des enfants juifs, mais ne parla pas de la responsabilité des autorités françaises. Il nomma également Maurice Papon ministre du Budget. Le cas de François Mitterrand est plus complexe. Fonctionnaire du régime de Vichy, il ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu’il a prétendu, les lois antisémites du régime et le climat d’antisémitisme qui régnait à Vichy. Il approuve le retour de Laval au pouvoir en avril 1942, et considère avec faveur le Service d’ordre légionnaire d’où sortira la Milice dont le programme était violemment antisémite. Il évolue ensuite progressivement vers la Résistance. Son passé vichyste était peu connu. En 1992, face au Comité Vel d’Hiv 42, qui demandait que le Président de la République reconnût la responsabilité de « l‘État français de Vichy dans la persécution et les crimes contre les juifs de France », une partie de l’administration française ayant mis en œuvre ces persécutions, Mitterrand opposa une fin de non-recevoir. On devait demander des comptes non à la République, mais à l’État français de Vichy. Cela n’empêcha pas en 1993 l‘instauration d’une journée commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait, dite « gouvernement de l’État français » 1940-1944.
Le « psychodrame national » comme le disait Henry Rousso semblait prendre fin. « De ce drame épouvantable, disait Edouard Balladur, la France demeure inconsolable ». Inconsolable, mais non responsable souligne François Broche. Il analyse ensuite minutieusement l’évolution de l’attitude de Jacques Chirac. Proche de Serge Klarsfeld, il reprend d’abord les conclusions de celui-ci : en 1988, il souligne que si Vichy s’est déshonoré, les trois quarts des juifs de France doivent leur survie à la sympathie de l’ensemble des Français. Mais Serge Klarsfeld a lui même évolué et estime que ce qui a été accompli par Vichy l’a été au nom de la France, conviction exprimée sans base historique. Chirac se rallie à cette thèse. Si l’on en croit la « plume » de Chirac, Christine Albanel, il semble que Chirac ait également voulu marquer le début de son septennat par une rupture avec la doxa gaullo–miterrandienne, et aller dans le sens de l’opinion. François Broche dénonce la contre-vérité historique qui consiste à affirmer que « la France accomplissait l’irréparable ». Tout en rendant hommage à la France Libre et aux Justes, Chirac évoquait une « faute collective », notion qu’ Henry Rousso jugeait discutable et sans fondement juridique. On juge des individus et non des peuples. Parler de la responsabilité de la France dans la déportation, c’était aussi réintégrer Vichy dans la continuité de l’histoire de France. Le discours de Chirac provoqua de vives réactions, allant de l’approbation à la critique, plusieurs hommes politiques comme Chevènement ou Philippe Seguin rappelant que la République n’était pas responsable de la politique de Vichy et que Chirac présentait une vision biaisée, voire mensongère de l’histoire. Plus tard, Robert Badinter soulignera la « confusion » des propos de Jacques Chirac.
Lionel Jospin, puis les successeurs de Jacques Chirac reprirent les thèmes développés en 1995. La déception de François Broche à l’égard d’Emmanuel Macron est à la mesure de ce qu’il en espérait, c’est à dire une rupture avec la doxa défendue par ses prédécesseurs immédiats. « Je récuse, déclarait Emmanuel Macron, les accommodements de ceux qui prétendent aujourd’hui que Vichy n’était pas la France, car Vichy, ce n’était certes pas tous les Français, mais c’était le gouvernement et l’administration de la France… Je vais vous dire pourquoi il faut toujours que nous ayons à l’esprit que l’État français de Pétain et Laval ne fut pas une aberration imprévisible née de circonstances exceptionnelles. C’est parce que Vichy dans sa doctrine fut le moment où purent enfin se libérer ces vices qui déjà entachaient la IIIème République : le racisme et l’antisémitisme ». Ce discours suscita peu de critique, si ce n’est celles du philosophe Paul Thibaud, de Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Noël Jeanneney qui regrettait la manière dont Emmanuel Macron « enveloppe le passé, en cette occurrence, de cette culpabilité à bon compte qui est étrangère à toutes les réalités historiques et à toutes les énergies symboliques qu’il souhaite si fort animer. »
Une réflexion sur le travail de l’historien
C’est cette analyse que récuse François Broche. Croyant dévoiler une histoire longtemps occultée, Jacques Chirac et ses successeurs ont développé une « doxa » que l’histoire et le travail des historiens contredisent. On ne peut attribuer à LA France la responsabilité de la rafle. Vichy n’était pas le gouvernement et l’administration de la France, c’était le gouvernement d’un territoire occupé d’un pays privé de souveraineté, qui se qualifiait d’État français mais était dépourvu des prérogatives de tout État digne de ce nom. Le racisme et l’antisémitism, présents sous la IIIème République étaient combattus, et ne seraient pas devenus une politique d’État sans la défaite et l’occupation qui ont représenté un traumatisme et une rupture majeurs. François Broche, à la suite de Pierre Nora et de Paul Ricoeur, en appelle au travail de l’historien qui n’est pas un juge et contribue à faire connaître la complexité du passé. Vichy n’était pas la France, la France se trouvait « partout où des hommes et des femmes se battaient pour la liberté ». Il ne convient pas d’occulter ceux qui se sont battus au nom de la haute conception qu’ils avaient de la France.