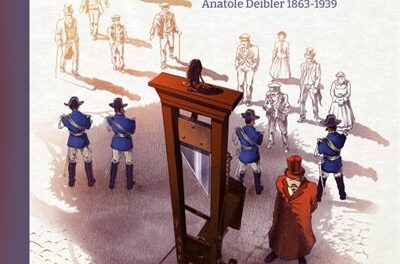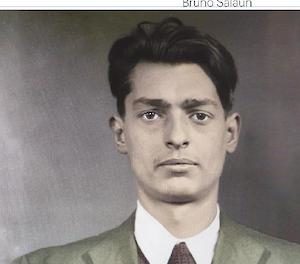Dans la masse des publications consacrées au centenaire du début de la première guerre mondiale, la synthèse de Margaret Macmillan devrait occuper une place à part. Pour son volume tout d’abord, 841 pages dont une centaine pour la bibliographie et les notes. Mais c’est surtout l’approche qui vise à traiter l’ensemble des aspects de la question qui retiendra l’intérêt. Dans cet ouvrage l’ensemble des thèmes possibles pour comprendre le mécanisme qui conduit à ce que l’on appelle le suicide de l’Europe est traité. Le fil conducteur de l’ouvrage permet de comprendre que si l’on a pu croire, notamment après l’annexion par l’Autriche-Hongrie de la Bosnie-Herzégovine en 1908 et après la seconde crise marocaine en 1911, au caractère inéluctable d’une guerre en Europe, les principaux acteurs, et ceux qui détenaient les clés de la paix de la guerre, ont pu disposer d’un certain choix.
Comment, alors que l’Europe termine le XIXe siècle avec l’exposition universelle de 1900, que la prospérité se répand, les forces profondes qui conduisent à la guerre ont pu finir par l’emporter ?
Au-delà de la guerre elle-même, Margaret Macmillan traite du suicide de l’Europe pendant ce que l’on a pu qualifier de guerre civile.
Historienne britannique, professeur à Oxford, Margaret Macmillan consacre une place particulière à la place de l’empire britannique dans l’Europe de l’avant-guerre. Le splendide isolement de la Grande-Bretagne est traité sous un angle particulier, celui d’un pays qui entend jouer un rôle spécifique dans ses relations avec le continent, en cherchant à se dégager de toute obligation contraignante. La défense de l’empire est la priorité des occupants du 10 Downing Street, la fonction étant essentiellement occupée pendant cette période par des conservateurs issus de l’aristocratie terrienne du pays, comme Salisbury. La suprématie navale est évidemment incontestée et le plus grand intérêt porté aux points d’appuis maritimes, ce qui d’ailleurs conduit la Grande-Bretagne rapprochement avec le Japon malgré l’affrontement de l’archipel contre la Russie en 1904 – 1905 en Extrême-Orient. L’Angleterre doit répondre au double défi lancé par l’Allemagne de Guillaume II. Celui de suprématie navale tout d’abord mais aussi celui d’une concurrence économique sur l’ensemble des marchés mondiaux.
L’Angleterre dominante
Pourtant, l’Angleterre occupe une position dominante dans cette deuxième mondialisation, celle qui associe les grandes métropoles des pays la révolution industrielle et leurs empires coloniaux respectifs.
L’Allemagne impériale a connu un développement extrêmement rapide, plus peut-être au niveau économique et social qu’au niveau politique. L’empire construit par Bismarck, « par le faire par le sang », apparaît comme une curieuse synthèse entre la modernité d’une grande nation industrielle et un empire autoritaire qui s’appuie encore sur une noblesse terrienne imprégnée de tradition militaire. À la tête de ce géant européen, le kaiser Guillaume II, un homme étrange et tourmenté, handicapé physique depuis sa naissance, velléitaire et dilettante. Le chapitre qui lui est consacré s’intitule : « Malheur au pays dans le prince est un enfant ! ». C’est que ce personnage joue un rôle très particulier dans son pays. Certes une représentation parlementaire existe, et au fur et à mesure l’opposition social-démocrate se développe jusqu’à devenir le premier parti politique d’Allemagne avant la guerre. Évidemment le Parlement vote le budget, et notamment le budget militaire, et particulièrement celui consacré au développement de la marine de guerre, mais le kaiser se considère toujours comme le chef suprême de l’armée, comme celui qui dicte la politique étrangère.
L’émotif hyperactif
Dans la pratique cela n’est pas faux. Des lors que l’on confie de telles responsabilités un à émotif hyperactif, que ses généraux laissent toujours gagner lors des manœuvres militaires de printemps, on n’est plus vraiment très loin de la catastrophe. Malgré tout, la place de l’Allemagne sur la scène mondiale n’a pas souffert du passage de témoin lors de la démission de Bismarck en 1890. Bien au contraire, les chanceliers successifs, moins enclins à s’opposer au kaiser, tout en essayant de le contrôler, ont su donner à l’Allemagne une impulsion nouvelle au-delà de la vieille Europe.
Cette montée en puissance de l’Allemagne est envisagée au départ avec une certaine sérénité par les britanniques. Après tout, et notamment dans les empires coloniaux, l’Allemagne peut être un facteur qui pourrait ramener la France à plus de modestie. Et jusqu’à l’affaire de Fachoda, la compétition existe entre le coq et le lion. Mais dès lors que la Grande-Bretagne assiste programmes d’armement naval impulsé par l’amiral Tirpitz, l’amirauté lance un programme de super-croiseurs, les dreadnought. Au Reichstag les budgets en faveur du développement de la marine augmentent et la rivalité navale anglo-allemande se développe.
C’est à ce titre que les amis improbables se rapprochent, avec l’entente cordiale. Pour la France il s’agit de se prémunir contre une menace allemande tandis que pour les britanniques il s’agit simplement d’un rééquilibrage face à une Allemagne que l’on soupçonne de vouloir exercer une hégémonie sur le continent. Mais pour les britanniques, et sans doute jusqu’au bout, on conserve le secret espoir de s’inscrire encore et toujours dans le « splendide isolement ». Il faudra la violation de la neutralité belge pour que la décision de s’engager sur le continent soit prise.
La guerre improbable
Paradoxalement, et c’est sans doute ici l’apport essentiel de cet ouvrage, bien que la guerre n’ait pas au final été souhaitée par les décideurs, ces derniers avaient tout de même envisagé cette hypothèse, comme le montre les conversations militaires franco-britanniques après l’entente cordiale, mais également les conventions militaires secrètes composantes du rapprochement entre la Russie impériale et la France républicaine en 1892.
Bien des préventions existent pour former cette triple entente entre la Russie, la France et le Royaume-Uni. L’ours et la baleine pour reprendre la formule de Margaret Macmillan à propos des conversations anglo-russes s’opposent pourtant en Asie centrale notamment à propos de la perse et de l’Afghanistan. Mais l’échec de la Russie impériale face au Japon en 1905 conduit tout de même la Russie à une prise de conscience de sa propre faiblesse.
La faiblesse de la Russie s’est aussi celle de son tsar, Nicolas II, celui qui s’effondre en larmes lorsqu’il apprend qu’il doit régner et succéder à son père. C’est celle aussi de ce prince héritier hémophile porté à bout de bras par un cosaque, et celle de cette famille royale qui vit à l’écart de Saint-Pétersbourg dans le palais d’été en croyant dur comme fer en l’amour de son peuple.
La constitution de la triple entente, même si elle peut être considérée à tort comme une riposte à la triple alliance qui lui est antérieure, La Triplice ou Triple Alliance est conclue le 20 mai 1882, conduit l’Allemagne à renforcer, comme l’anneau du Nibelung, le soutien à l’Autriche-Hongrie, une autre puissance qui lutte, tout comme l’empire ottoman, son éternel rival, contre le sentiment de son propre déclin.
Pourtant, dans cette Europe prospère qui se prépare la guerre, mais peut-être pour ne jamais avoir à la faire, il existe des rêves de paix. La guerre apparaît, si jamais elle éclate, comme une catastrophe irrationnelle, comme l’écrit le financier russe Ivan Bloch. Une guerre générale pourrait déboucher sur une impasse que les sociétés européennes ne pourraient supporter et qui entraînerait, particulièrement en Russie des révolutions. Et puis après tout, même si les états-majors bâtissent des schémas stratégiques et tactiques envisageant une guerre, les experts économiques ont bien noté l’interpénétration des économies européennes, et puis n’est-il pas vrai que des nations qui commercent ensemble ne se font pas la guerre ? Entre 1890 et 1913 les importations britanniques en provenance d’Allemagne sont multipliées par trois tandis que les exportations doubles. La France importe presque autant d’Allemagne que de Grande-Bretagne tandis que l’Allemagne dépend du minerai de fer français de Lorraine pour ses aciéries. Une guerre coûte de toute façon beaucoup trop cher et elle ne pourrait durer bien longtemps sans imposer un recours massif à l’impôt qui serait générateur de troubles sociaux.
Paroles de paix et plans de guerre
Parmi les personnages qui ont été les acteurs du mouvement pacifiste qui s’est développé au tournant du XIXe et du XXe siècle, on croise Bertha Von Suttner, qui devient secrétaire d’Alfred Nobel. C’est elle qui conduit l’industriel suédois, diffuseur de la dynamite qui lègue une partie de sa fortune pour que soit créé un prix pour la paix. Ce pacifisme européen trouve un écho aux États-Unis, mais aussi en Russie. Tandis que se développe la fondation Carnegie pour la paix, le jeune tsar Nicolas II s’engage dans l’organisation de la conférence La Haye, qui lance les bases des règles d’un arbitrage international et qui envisage, même si cela est un échec, un plan de désarmement.
Enfin parmi les forces qui s’expriment en faveur de la paix, la deuxième internationale socialiste, fondée en 1889, apparaît comme d’autant plus puissantes que dans les deux pays susceptibles d’entrer en guerre, la France et l’Allemagne, de fortes voix s’élèvent contre une guerre « capitaliste ». La voix puissante de Jaurès fait écho à celle d’August Bebel. Les congrès de l’internationale socialiste vote plusieurs résolutions visant, par la grève générale, empêcher la guerre. Mais dans le même temps, et notamment en Allemagne, le sentiment national prend le pas sur l’appartenance de classe.
Enfin, dans cet ouvrage, avant que ne commence la seconde partie est consacrée à l’examen des crises, les idées de guerre suivent le chapitre sur les idées de paix. Les conditions de la guerre ont profondément changé depuis le développement de la révolution industrielle. La taille des armées était nécessairement limitée par la nécessité d’approvisionner une masse de soldats. La vitesse de déplacement était au final celle des hommes à pied. À la fin du XIXe siècle les trains peuvent transporter rapidement désormais beaucoup plus nombreuses sur de plus grandes distances et les approvisionner grâce aux usines de l’arrière. La montée en puissance des effectifs apparaît tout à fait considérable. La Grande armée de Napoléon qui marche sur Moscou compte 600 000 hommes en 1812. En 1870, Hermuth Von Moltke, conduit à l’assaut de la France une armée de 1 200 000 hommes. En 1914, l’Allemagne envoie 3 millions d’hommes sur le front.
En Allemagne comme ailleurs la guerre devient une affaire de planificateurs et de services administratifs. Mais elle est aussi une affaire d’ingénieurs. Les armes nouvelles sont expérimentées à l’occasion de différents conflits, la guerre de sécession ou la guerre des Boers. Leur puissance est parfaitement connue et milite en faveur d’une guerre courte dans les moyens de destruction nouveau sont importants. Des lors qu’il faut développer des plans, en faveur d’une guerre qui impliquerait des victoires dans des batailles décisives, il faut que ces plans s’appliquent en suivant un timing extrêmement précis. Entre l’ordre de mobilisation et l’arrivée sur le front il faut que le délai soit le plus bref possible. Le plan Schlieffen est basé sur ce principe. Une avancée rapide, un mouvement tournant et un débordement de l’adversaire permettant de livrer au plus vite la bataille décisive et finalement de l’emporter. La particularité de tous ces plans, y compris le plan français d’attaque en Lorraine occupée, est qu’il reposent sur une autonomie de décision des militaires faces au pouvoir civil. La suite est connue, des offensives sont conduites entre août et septembre 1914 sans forcément tenir compte des véritables contraintes sur le terrain et la guerre s’installe dès lors que les armées épuisées s’enterrent, dans la durée, ce que personne n’avait vraiment prévu.
Les crises successives
Mais avant d’en arriver là, une succession de crises toutes étudiées par Margaret Macmillan, crée les conditions d’une guerre généralisée que l’on pouvait penser improbable. La plus notable, celle qui crée une situation de rupture dans les Balkans, est celle qui déclenché à propos de la Bosnie-Herzégovine, annexée par l’Autriche-Hongrie en 1908. Cette manifestation de la puissance austro-hongroise dans les Balkans, conduite au mépris des intérêts de la Russie, amène simultanément un renforcement de l’alliance entre l’Allemagne et l’Autriche et à un sursaut de la volonté d’expansion russe cherchant à laver cette humiliation. L’effondrement de l’empire ottoman face à la ligue balkanique coalisée contre lui en 1912, encourage cet interventionnisme russe et favorise l’aventurisme de dirigeants serbes enclins à penser qu’ils pourraient forcer le destin en recréant la Grande Serbie.
Dans cette vaste synthèse, le lecteur pourra découvrir bien des ressorts de l’histoire des relations internationales.
Les trajectoires des individus en charge des affaires, leurs motivations psychologiques, les intérêts économiques en jeu, la montée des nationalismes et du militarisme, tout cela converge vers cet enchaînement qui conduit à la catastrophe de l’été 14.