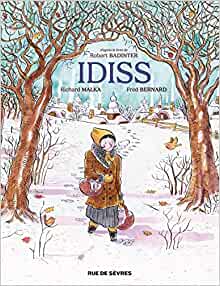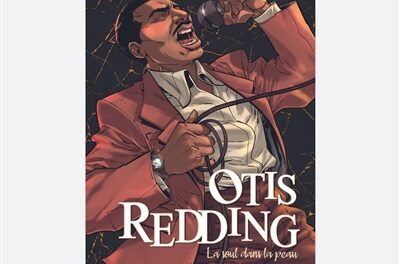En 2018, Robert Badinter a publié un récit relatant la vie de sa grand-mère, Idiss, née en Bessarabie en 1863 et morte à Paris en 1942. Ainsi qu’il le dit, ce livre « ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l’Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d’une destinée singulière à laquelle [il a] souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d’amour de son petit-fils ».
C’est sur ce socle que Richard Malka (avocat de Charlie hebdo et de Mila) au scénario et Fred Bernard au dessin ont retranscrit l’histoire d’Idiss en bande dessinée, en bénéficiant de la bénédiction de l’auteur et de ses conseils. Richard Malka est resté au plus près du livre, reprenant tous les événements et les transformant en dialogues qui font vivre les différents personnages, montrant les relations remplies d’amour entre eux tous, dans un langage très simple et accessible à tous, avec un grand souci de clarté.
Fred Bernard a choisi une ligne claire pour les personnages, des couleurs pastelles et des courbes qui font penser à Joan Sfar. Un dessin faussement enfantin, qui insiste sur la poésie et l’esthétique, mais édulcore quelque peu le propos du récit en réduisant les mouvements.
L’ouvrage commence par un arbre généalogique qui permet de connaître tous les personnages du récit et de se repérer facilement. Le choix de ne mettre que les dates de naissance de chacun préserve d’une part le suspense, mais aussi rappelle une devise importante du judaïsme, énoncée dans la dernière partie du livre : « Chois la vie ! Et la vie c’est tes enfants ! C’est aux SS de choisir la mort, pas aux Juifs ! ». La deuxième page est ensuite une carte afin de situer la Bessarabie. Lors de chaque voyage, une carte est proposée au lecteur, ce qui ajoute au récit initial.
En revanche, contrairement au livre, Malka et Bernard n’ont pas découpé l’ouvrage en chapitres. Néanmoins, on peut le diviser en trois parties :
Tout d’abord, le temps du shtetel. Pour cette partie, Fred Bernard s’est immergé sur la recommandation de Robert Badinter dans l’ambiance des shtetels d’Un violon sur le toit de Norman Jewison et du Bal des vampires de Roman Polanski. Cependant il s’est aussi laissé largement inspiré de Chagall, dont il reprend ouvertement les œuvres et les motifs : personnages volants dans les moments de bonheur, chèvre, violoniste, chien, coq et oiseau. Il s’agit d’une partie bien développée, qui traite des premières années d’Idiss, en oubliant son enfance et sa jeunesse : le récit débute en 1890 alors qu’elle est déjà mère de deux enfants. Son mari a été réquisitionné pour les armées du tzar, elle en est sans nouvelle et habite chez ses beaux-parents dans la pauvreté. Cette période semble un peu irréelle, issue des récits faits plus tard par Idiss, au même titre que les contes pour enfants sur les Dibbouks, les mauvais esprits des légendes juives d’Europe centrale. Tout le petit monde du shtetel est représenté, avec les musiciens, le rabbin plein d’humour et les savoureux proverbes yiddishs : « quand ça va mal, on pleure, quand ça va bien on a peur, et les enfants, c’est le bonheur ! » Même le retour de Shulim de l’armée et la découverte de sa passion du jeu ou la multiplication des pogroms semblent sans gravité, puisqu’au moment des récits, ces problèmes ont été résolus et appartiennent déjà à un passé transformé, voire fantasmé par les années.
Puis le temps du bonheur à Paris, dans une ambiance impressionniste, notamment avec une réinterprétation mélangée du Dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte de Seurat, et du Temps de l’Harmonie de Signac. Certes des dates jalonnent le texte et donnent les repères chronologiques, mais le dessin est plutôt anhistorique, avec peu d’évolution des costumes. L’objectif est véritablement de faire de cette période un tout nimbé de lumière, malgré un événement douloureux, la mort du mari d’Idiss. C’est la partie la plus longue, même s’il ne s’agit que de 28 ans de la vie d’Idiss, et en particulier de sa vieillesse. Un temps de bonheur pour elle certes, mais surtout pour Robert Badinter, qui y a mis ses souvenirs d’enfance, sa joie d’enfant qu’il transfère aux autres personnages. Celui d’une famille unie où s’épanouissent les petits-enfants dans la République française.
Enfin, le temps de la destruction, avec la Seconde guerre mondiale : Idiss meurt en 1942, séparée d’une grande partie de sa famille, mais sans savoir que beaucoup ne survivront pas. Le dessin y semble de plus en plus brouillé, rayé par la pluie, la tristesse, la maladie. Robert Badinter ne voulait pas donner trop d’importance à cette partie, qui n’est à son sens pas représentative de la vie d’Idiss, ce que les auteurs ont respecté.
Au-delà de l’histoire d’une vie et de celle de sa famille, le récit aborde finement, par petites touches disséminées au fil des pages, différentes thématiques, sans en faire de démonstrations pompeuses, là encore dans le respect du souhait de Robert Badinter de mettre l’amour de sa grand-mère au cœur du livre.
Ainsi le rapport à la loi est-il traité tout en nuances, puisque la première anecdote concerne l’expérience de contrebandière d’Idiss et ses arrangements avec la police russe représenté par un personnage positif et pragmatique. Viennent ensuite les références à l’Affaire Dreyfus, et au fait que la loi française protège les Juifs, puis aux conséquences du respect de cette loi sous Vichy qui conduit au fichage de la famille, l’aryanisation de l’entreprise et l’arrestation et la déportation de plusieurs membres, ou du non-respect de la loi en passant en zone libre, aucune solution n’étant définitive. Le récit se termine par deux pages rappelant l’une les lois antisémites promulguées par les Vichystes dans le droit français, et une des lois promulguées par les Nazis.
La montée du nazisme est d’ailleurs également évoquée de manière filée, d’abord sur des pages séparée au temps du bonheur, montrant un vendeur d’art en 1912 à Vienne qui tente d’aider le jeune peintre Hitler en présentant ses aquarelles. Puis à Munich, où un policier décide d’une surveillance légère d’un groupuscule sans intérêt qui a pour emblème la croix gammée. Puis sur la même page, d’un côté le bonheur, l’insouciance, les jeux de cartes et de l’autre les rassemblements nazis, ou d’un côté la célébration d’une barmitsva et de l’autre un discours de Hitler. Et bien entendu les deux mondes finissent par se fondre en un seul dans l’effondrement de la République.
L’école, l’intégration et la République chères à Robert Badinter ont une place à part. Tout d’abord, en montrant comment dans une famille pauvre de Bessarabie, seul un enfant peut être envoyé à l’école faire des études, sans aller jusqu’au lycée. Puis à l’arrivée en France, la première décision familiale est l’inscription à l’école de Chifra, dont on francise le nom en Charlotte, et qui doit travailler dur et sert d’interprète à la famille. Enfin, les petits-enfants, dont on exige l’excellence (« tu n’as été que 2e à ton contrôle. Tu sais, il n’y a jamais d’excuse à ne pas exceller… » en pleine guerre). Cette école de « laïcards », de Jaurès, de cérémonies aux anciens élèves morts pour la France, de prix et d’apprentissage de la démocratie façonne des Français aux prénoms français, Claude et Robert. L’amour de la République est celui transmis par le père, éduqué à l’étranger, qui emmène ses enfants écouter Léon Blum. C’est lui aussi qui explique « que la République tant aimée, la République d’Hugo et de Zola, celle de la déclaration des droits de l’homme, avait cessé de les protéger et les enfants juifs devraient se comporter prudemment pour ne pas être dévorés ».
La question du judaïsme, de l’antisémitisme et de l’immigration est omniprésente dans les trois parties du récit, avec ses doutes et ses hésitations, montrant les Juifs comme acteurs de leur vie, et non en victimes passives. Les Juifs de Bessarabie, présentés comme religieux et communautaires rêvent d’Amérique, de Palestine, ou de socialisme. A Paris, au temps du bonheur, les nouveaux arrivants reconstituent un ersatz de shtetel dans des quartiers, autour des commerces, de la langue yiddishe et de la synagogue, mais aussi des bals et des soirées pour les jeunes francisés. Les départs pour l’Amérique continuent cependant, tandis que des morts aux Juifs apparaissent sur les murs. Et dans la troisième partie, à nouveau les discussions sur les actions possibles, sans résignation ni passivité.
En conclusion, une vie avec ses joies et ses peines, rendue belle par le récit et le dessin, mais surtout par l’amour qui imprègne chaque page, dans une double fidélité de Robert Badinter à sa famille et des auteurs à Robert Badinter. Au niveau pédagogique, ce récit est adapté pour les CM2. L’appareil didactique le rend également utilisable au collège.