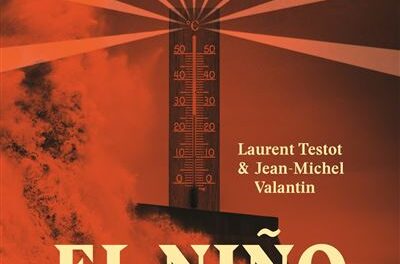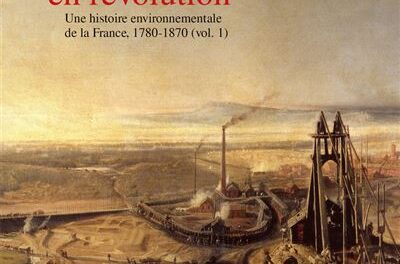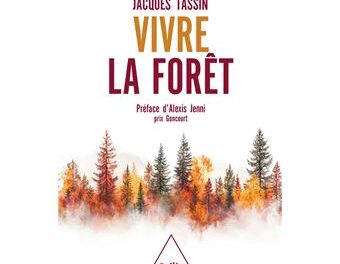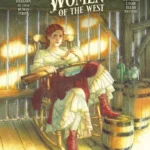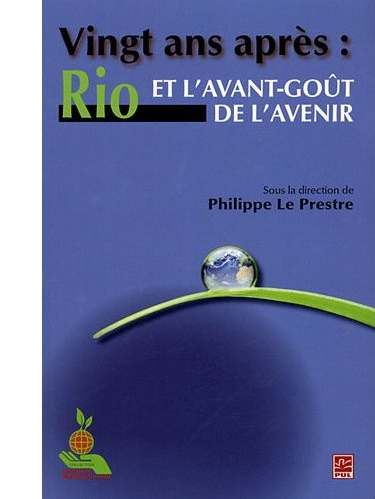
Depuis 1972 les « Sommets de la Terre » réunissent tous les dix ans les dirigeants mondiaux pour se pencher sur les questions relatives à la sauvegarde de notre environnement et pour stimuler le développement durable comme un rempart contre sa dégradation. En 2012 il aura lieu à Rio de Janeiro vingt ans après celui de 1922 qui s’était déjà déroulé dans la même ville.
Mais vingt ans qui ont connu de très nombreuses catastrophes dites naturelles et pour lesquelles les spécialistes s’accordent à dire qu’elles trouvent leur origine dans l’empreinte humaine. Et récemment la catastrophe de Fukushima a réellement réveillé la conscience populaire des risques encourus tout en démontrant l’incapacité des ingénieurs à éviter le pire. Le Sommet de la Terre de Rio en 2012 sera donc placé sous un double éclairage : celui des catastrophes récentes et celui du chemin parcouru par les Etats depuis vingt ans pour enrayer ce que d’aucuns appelle déjà « l’inévitable ».
C’est autour de ce deuxième point que Philippe Le Pestre organise l’ouvrage qu’il nous propose. L’auteur est un spécialiste, il est professeur titulaire au Département de Science Politique de l’Université Laval et directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société.
Ses intentions sont clairement affichées dès l’introduction puisqu’il précise : « dans la perspective de la tenue d’une nouvelle réunion bilan en 2012, vingt ans après Rio et cinquante ans après Stockholm, cet ouvrage vise en premier lieu à augmenter et à améliorer la perception de l’utilité de ces processus multilatéraux et de leur impact aussi bien au niveau local que national et international ».
C’est pourquoi Philippe Le Pestre nous invite à l’examen de six grands thèmes emblématiques de la conférence de Rio en 1992 et, nous dit-il, qui le resteront encore en 2012. Il s’agit de la gouvernance, la biodiversité, le climat, la désertification, la forêt et l’eau.
Le livre est ainsi divisé en six sections, une pour chaque thème. La structure de toutes les sections sont identiques. Elles débutent par une chronologie exhaustive, et se terminent par des exemples, parfois des entretiens. L’analyse proprement dite est assurée une série de chapitres allant de deux pour la gestion internationale de l’eau à six pour les changements climatiques, chacun ayant un auteur différent. Ainsi, ce recueil sous la direction de Philippe Le Pestre s’annonce comme « un avant-goût » du Sommet de la Terre version 2012.
Section 1 Gouvernance internationale de l’environnement.
La section s’ouvre avec une chronologie exhaustive des « négociations sur la gouvernance internationale de l’environnement » de 1972 (Sommet de Stockholm) à 2010. Ces données brutes sans aucun commentaire permettent de replacer dans le temps les travaux accomplis. Elles sont néanmoins suivies d’un « bref historique » accentuant sur les avancées tout en insistant sur les « tensions persistantes » avant de conclure par une note d’optimisme.
Dans le 2e chapitre intitulé « gérer la planète : gouvernance et sciences de l’environnement planétaire », l’auteur Clark A. Muller nous apprend que « depuis les années cinquante, on assiste à […] une vague de transformation des institutions encadrant la science et la gouvernance, touchant […] l’environnement à l’échelle planétaire ». En effet, nous dit cet auteur « ces dernières années, d’importantes nouvelles recherches ont relevé que la science et la technologie ont joué un rôle notable dans l’émergence de formes démocratiques de gouvernance nationale au 20e siècle ». Et il en va de même au niveau international comme par exemple les recherches scientifiques sur le climat qui « ont réussi à modifier fondamentalement le discours du milieu des affaires ».
Puis, sous la plume d’Emma Broughton, le lecteur découvre le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), véritable volet financier créé dès 1991 mais dont le fonctionnement reflète les difficultés et les hésitations de la gouvernance internationale.
Enfin, Yan Turgeon recueille dans un dernier chapitre les propos d’Achim Steiner (directeur exécutif pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement), de John W. Ashe (Ministre responsable du développement durable et de l’OMC, ambassadeur et représentant permanent d’Antigua-et-Barbuda aux Nations Unies) et de Félix Dodds (directeur général, Stakeholder for a Sustainable Future).
Section 2 : La convention sur la diversité biologique
Là aussi, la section s’ouvre sur une chronologie exhaustive allant de 1980 à 2010 suivie d’une fiche technique très complète sur ladite convention sur la diversité biologique. Véritable outil de travail, le lecteur est ainsi armé pour aborder la suite. Une suite qui est organisée en deux chapitres. Le premier « 1998 à 2008 : dix ans d’évolution de la CDB » insiste sur les différentes phases qui ont permis d’atteindre « la coordination et la coopération d’une large gamme d’acteurs, notamment à l’échelle internationale ». Le deuxième « La convention sur la diversité biologique à l’échéance de 2010 » prend acte de l’échec de la conférence de Copenhague en 2009 et souligne que « du point de vue politique, la biodiversité figure de façon croissante parmi les préoccupations des membres du G8 ».
Enfin, la section s’achève sur deux exemples de réalisations : « loi Gelose de Madagascar [et] plan d’action pour la biodiversité en équateur ».
La loi Gelose de Madagascar, nous disent Marie-Hélèbe Bérard et Ariane Gagnon-Légaré, consiste à « relier la gestion traditionnelle et formelle des ressources naturelles ». Il s’agit en fait de la gestion des forêts qui était devenue la prérogative de l’Etat. Avec cette nouvelle loi, le monopole de l’Etat a été écarté au profit d’une gestion partagée avec les communautés autochtones et leur droit.
Le cas en Equateur vise quant à lui des stratégies et des plans d’action pour la biodiversité. La nouveauté consiste ici, à appliquer les mesures de l’article 6a) de la Convention sur la diversité biologique non pas à un niveau national ou international mais provincial. Et l’étude de ces cas a permis de mettre en lumière « « l’influence du niveau d’action international sur le niveau local [amenant] à s’interroger sur la nature et l’importance relative des obstacles à la mise ne œuvre de la Convention ».
Section 3 : Convention sur les changements climatiques
La désormais traditionnelle chronologie débutant cette fois-ci en 1827 avec la première description de l’effet de serre par le mathématicien français Jean-Baptiste Fourier, est suivie par deux fiches techniques. La première traite de la « Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques » et la seconde du « Protocole de Kyoto ».
Dans un premier chapitre, Clémence Mallatrat retrace les négociations sur les changements climatiques en dégageant les principes, les acteurs et les enjeux sur la période allant de Rio 1992 à Copenhague 2009.
Puis, Urs Luterbacher s’intéresse plus particulièrement au changement climatique en général, au protocole de Kyoto et à l’avenir des négociations sur le climat. Cet auteur constate, comme bien d’autres, que le protocole de Kyoto a « atteint ses objectifs sur le plan juridique » mais qu’il n’a pas réussi « à faire diminuer de manière significative les émissions de GES au niveau mondial ». De plus, « dans des conditions de crise financière et industrielle » qui sont les nôtres, il sera de plus en plus difficile de les réaliser. La principale difficulté, nous dit Sandrine Maljean-Dubois dans le chapitre suivant, viendrait des « originalités et faiblesses de la procédure de contrôle du respect du protocole de Kyoto ». Tout d’abord, aucun Etat ne peut être contraint à entrer dans le protocole de Kyoto et, personne ne peut empêcher un Etat d‘en sortir. Ensuite, c’est un Comité qui a reçu la charge du contrôle dans le cadre de procédures assez complexes ce qui nuit indubitablement à une réalisation efficace et rapide.
Enfin, Ali Agoumi plaide pour « une économie à faible teneur en carbone et une adaptation appropriée ». Après avoir souligné « la nécessité et l’urgence de réduire de façon importante les émissions en GES », l’auteur interpelle par une série de question malheureusement sans réponse ni même de piste avant de conclure en disant qu’il « est important que le futur traité sur le climat tienne compte de la position des pays en voie de développement peu émetteur de GES, mais très vulnérables aux changements climatiques. […] Il s’agit là d’un enjeu humain majeur, au-delà de considération financières, technologiques ou politiques. L’Afrique a besoin de moyens et de soutiens pour garantir aux populations locales une vie décente. Faute de quoi, l’émigration vers le Nord se poursuivra mais à un rythme d’une autre nature que ce que nous connaissons aujourd’hui ».
Deux exemples viennent clôturer cette section. Le premier concerne « la place du déboisement dans l’accord mondial » et le deuxième décrit le « rôle croissant [du Brésil] dans la gouvernance du climat ». Concis, ces deux cas apportent des éléments concrets aux longs développements précédents.
Section 4 : La convention sur la lutte contre la désertification
La chronologie de 1977 à 2010 introduit toujours la section et elle est suivie d’une fiche technique sur la « convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD) ».
Dans un premier chapitre, Anaïz Parfait analyse les acteurs, la structure et les enjeux de la lutte contre la désertification. Elle note tout d’abord les difficultés liées au financement de la mise en œuvre. Elle souligne ensuite le caractère participatif de l’approche. En effet, nous dit-elle, contrairement aux autres accords multilatéraux environnementaux, ici, « le texte de la Convention prévoit expressément la participation des communautés locales ». D’où, la question des connaissances traditionnelles est au cœur même s’il est aussi fait appel à la recherche et au développement des technologies.
Dans le chapitre suivant, Bo Kjellén se penche sur les « promesses et défis » en précisant toutefois qu’il n’exprime que sa vision personnelle tant il est attaché à la Convention. Il en va de même de Youba Sokona qui dans un chapitre intitulé « Témoignages » insiste sur la nécessité d’un nouvel élan.
Enfin, le chapitre se referme sur un entretien et deux exemples de réalisations en Afrique.
Section 5 : Gestion internationale des forêts
De 1971 à 2009, la chronologie retrace les étapes de cette gestion internationale des forêts. Puis, Carl Patenaude-Levasseur nous présente une « synthèse des enjeux et de l’évolution de la gestion forestière internationale ». Une courte synthèse qui débouche sur le constat amer qu’il « n’existe toujours pas d’outil juridiquement contraignant au niveau international dans ce domaine ». C’est pourquoi, « la société civile se mobilise et cherche de nouveaux moyens de créer des mécanismes pour appliquer les nouvelles attentes envers les forêts ». Constat que vient nuancer Lucie Verreault dans son chapitre « la gouvernance forestière mondiale ». Elle souligne certes « le caractère éminemment timide des progrès réalisés » mais pense que « l’actuelle Gouvernance Internationale des Forêts atteste néanmoins des efforts investis par les pays afin d’améliorer la coordination de leur action ». Ce que confirment les deux exemples qui suivent et dont l’un traite de la « certification forestière » et l’autre de « la protection des bois tropicaux » par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Section 6 : Gestion internationale de l’eau
La chronologie débute en 1921 avec le statut de Barcelone sur le régime des voies navigables d’intérêt international pour s’achever en 2010 avec la 64e Assemblée Générale de l’ONU qui consacre l’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain.
Il s’en suit une longue liste des institutions internationales de l’eau avec pour chacune une petite synthèse et l’adresse internet.
Et, malgré l’actualité liée au problème de l’eau, nous ne découvrons qu’un seul chapitre intitulé « gestion internationale de l’eau et développement du droit international ».
Les auteurs Laurence Boisson de Chazournes et Mara Tignino après une brève introduction où elles soulignent que « l’eau est vitale à la fois pour les êtres humains et l’environnement » s’attèlent à « l’évolution du droit international de l’eau ». Puis elles concluent que la « gestion ne peut pas être appréhendée comme celle d’autres ressources naturelles ». Elles préconisent une « approche intégrée » qui « commande que les considérations économiques, environnementales et sociales soient prises en compte pour satisfaire aux besoins des générations présentes et futures ». Et elles plaident aussi pour un « renforcement des relations entre les Etats » afin « d’inclure un développement de régimes de coopération relatif à la gestion et à la protection des ressources en eau transfrontalières ».
Enfin la section s’achève sur trois très courts exemples, le fleuve Sénégal, le Mékong et l’Alliance Genre et Eau en Colombie.
En conclusion :
Très documenté, très technique, la lecture de ce livre n’en reste pas moins abordable. Sa division en six thèmes permet aux enseignants une exploitation partielle pour leurs élèves avec chaque fois une section complète.
Avec le développement durable inscrit aux programmes des collèges et des lycées, cet ouvrage s’avère être un outil indispensable tant au niveau scientifique de la question que des nombreux exemples qui illustrent chaque thème.
Jacques MUNIGA