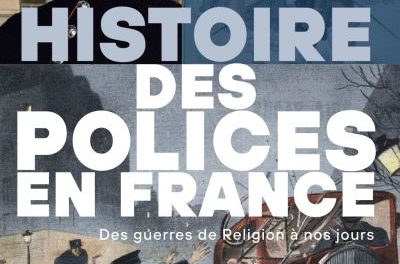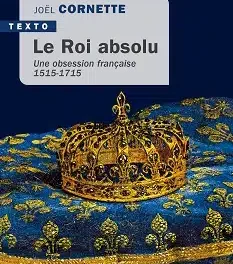L’histoire nord-américaine retient les dates de 1607 (fondation de Jamestown et de la première colonie anglaise d’Amérique du Nord en Virginie), 1620 (arrivée des « Pères pèlerins » par le Mayflower au Massachusetts) et 1630 (« grande migration puritaine » et installation en Nouvelle-Angleterre), alors pourquoi 1619 ?
Un évènement se produit cette année-là, et il est documenté : l’arrivée des premiers captifs Africains vendus comme esclaves en Virginie, alors une des toutes premières colonies anglaises. N’est-ce qu’un épiphénomène ?
C’est ce que cet ouvrage nous propose d’explorer. Il se compose de deux parties : la première replace l’arrivée des premiers captifs africains en Virginie en 1619 dans le contexte des circulations atlantiques et de la traite portugaise, la seconde partie montre comment cet évènement lors de sa commémoration aux Etats-Unis en 2019 s’est trouvé au coeur de débats politiques et sociaux vifs, car ce récit africain-américain au prisme de l’esclavage interroge sur les origines de la nation.
1619, enjeux d’une microhistoire atlantique
1619 s’inscrit dans un contexte de mondialisation, une histoire européenne de la colonisation, dans les connexions transatlantiques entre l’Afrique et la Caraïbe. L’autrice, dans la première partie, met en lumière la complexité du monde atlantique, les circulations et les rapports de force au XVIIe s.
Marchandisation des captifs africains
Après avoir mis en place le contexte des relations commerciales et de la traite entre le Portugal et le royaume du Congo (depuis le XVe s.), elle nous fait suivre les captifs africains du royaume Ndongo (vassal du Congo) jusqu’au port de Luanda, sur la côte d’Angole. Luanda est un véritable « entrepôt d’esclaves », mais une ville christianisée et métissée à la fois africaine et portugaise. C’est dans le plus grand port négrier de l’Atlantique Sud, en 1619, que 350 captifs quittent Luanda sur un navire négrier portugais, le São João Bautista, en contrat avec l’Empire espagnol (système de l’asiento de negros). Contrairement à ce qu’on a longtemps cru, ces esclaves ne venaient pas de la Caraïbe mais de cette côte d’Afrique.
Ce négrier se dirige vers Veracruz où il doit vendre son chargement, mais le voyage ne se passe pas comme prévu. Le capitaine du navire rapporte qu’il est attaqué en mer par deux bateaux corsaires anglais qui ne lui laissent que 147 esclaves sur les 350 chargés à bord. En réalité, d’après la base de données collaborative Trans-Atlantic and Intra-American Slave TradeDatabase, sur les 350 captifs près de la moitié meurt avant l’attaque des navires corsaires en raison des conditions sanitaires mortifères et d’une tempête.
C’est à la Jamaïque qu’il est contraint de s’arrêter pour les rafraîchir car beaucoup sont malades. Seuls 24 captifs sont vendus à la Jamaïque. Le reste est embarqué sur la frégate Santa Ana qui atteint Veracruz le 30 août 1619. La traversée, ce « passage du milieu », s’est faite dans la violence entre l’oppression, le manque de nourriture et d’hygiène, la brutalité, etc. Cette trajectoire révèle un système de traite bien rodé et les rapports de force entre les puissances esclavagistes, Portugal et Angleterre notamment. Ce voyage de deux mois transforme les captifs en esclaves, face à des matelots devenus des hommes blancs et libres. Entre 1501 et 1867, 12,5 millions d’Africains connaissent ce sort. Cette traite n’avait rien de particulier et cet itinéraire n’aurait pas dû faire date. Et pourtant, fin août 1619, lorsque le navire corsaire néerlandais, le White Lion, fait halte près de Jamestown, à Point Comfort, et vend une partie de son chargement aux colons anglais (« 20 et quelques nègres »), cet évènement devient le pivot d’une histoire, celle d’une société nouvelle, en Virginie.
Virginie, 1619 : l’année à marquer d’une pierre blanche
L’autrice nous relate alors l’histoire de la fondation tumultueuse de cette colonie anglaise (1607) où nous croisons Pocahontas et son mari John Rolfe, qui introduit une nouvelle variété de tabac, et surtout les multiples conflits entre Powhatans et Anglais. Progressivement, l’organisation territoriale, administrative et politique (première assemblée représentative d’Amérique anglaise) de la colonie permet l’ancrage d’une société coloniale. Le tabac est le facteur de prospérité de la colonie et tend à devenir une véritable industrie. Dans cette colonie qui peine à s’installer, des milliers d’engagés venus d’Europe accomplissent toutes sortes de travaux.
Un statut ambigu
Toute la question est alors de savoir quel a été le statut de ces Africains dont le destin est désormais lié à la colonie de Virginie. On sait qu’une trentaine d’Africains étaient déjà présents en Virginie avec un statut incertain en 1619. Le recours à une main d’oeuvre africaine est resté limité dans la colonie, pour autant l’arrivée des esclaves du navire corsaire a longtemps été désignée comme le point de départ de l’esclavage états-unien. Ce récit des origines prévaut encore aujourd’hui. Ces captifs sont désignés comme First Africans. La plupart d’entre eux ont effectué toutes sortes de travaux dans des fermes et des plantations de tabac au service de personnalités importantes de la colonie. Si la documentation est rare à leur sujet, ils apparaissent toutefois dans certains documents en tant que « servants » ou « negro servants » qui permet de les identifier par leur couleur. Quelques mentions font état de leur statut de marchandise. Cependant leur statut d’esclave n’est pas explicite. Un certain flou demeure d’autant plus que la Virginie importe des milliers d’engagés européens férocement exploités et que les Africains sont affectés aux mêmes tâches. Qu’ils fussent asservis est cependant indéniable, mais le modèle de cet asservissement aurait-il pu être l’engagement ? Ne sont-ce que des cas exceptionnels ? En ces années, l’esclavage n’est pas codifié. C’est une période de transition en Virginie. Ce n’est qu’à partir des années 1660 qu’un appareil législatif permet de différencier le sort des esclaves de celui des engagés. A la fin du XVIIe siècle, la présence d’une population d’origine africaine, venue en grands partie de la Caraïbe, s’accroît en Amérique du Nord. Le système de l’engagement disparaît et un système esclavagiste racialisé s’installe progressivement accompagnant l’économie de plantation dans les états du Sud.
Dater le début de l’esclavage racial
L’arrivée de ces « Premiers Africains » en 1619 pose la question de l’esclavage aux Etats-Unis mais aussi de la « race », de la nature raciale de l’esclavage. Cette arrivée peut-elle marquer le « début » de l’esclavage racial en Amérique du Nord ?
La notion de « race » est évidemment à historiciser et les débats sur son interprétation se poursuivent. Comme l’écrit l’autrice, il vaudrait mieux considérer 1619 comme une date ayant une certaine épaisseur formée d’un « jeu de basculements et de seuils », plutôt qu’une année zero.
2019, des mémoires concurrentes et contestées
Cette date de 1619 va être réinvestie dans les années 2010 car un besoin de connexion au passé, de construction d’une identité collective, de commémoration voit le jour.
C’est ce que la seconde partie de l’ouvrage met en lumière. 1619 est alors envisagé comme un « objet mémoriel » construit et débattu.
En 2019, la commémoration de cette date dans tout le pays, quatre siècles plus tard, comme fondatrice de l’histoire des Etats-Unis donne à voir toute la charge politique qui y est associée. Cette commémoration est une opportunité de combler ce besoin (ou ce manque) et de révéler les inégalités profondes qui persistent encore aujourd’hui dans la société américaine. Il devient possible de faire exister les Africains-Américains dans un passé lointain, de reconstituer une mémoire collective, de leur permettre de se réapproprier leur histoire et de l’intégrer au roman national très eurocentré. Promouvoir l’arrivée des captifs en 1619, soit un an avant l’arrivée du Mayflower, permet d’inscrire les Africains-Américains dans la longue durée de la construction nationale et donc mettre en évidence « leurs contributions » à l’histoire des Etats-Unis. Ce nouveau récit des origines met en évidence la complexité des origines états-uniennes. Ce récit est loin d’être univoque.
Repenser l’histoire des Etats-Unis : « The 1619 Project »
En 2019, la parution d’un numéro spécial du New York Times , « The 1619 Project », a donné à 1619 une ampleur inédite, faisant un bilan critique de la société contemporaine, de son passé esclavagiste et ségrégationniste mais aussi des discriminations raciales toujours présentes, en les inscrivant dans le temps long, depuis 1619.
« The 1619 Project » a eu une audience spectaculaire aux Etats-Unis et s’est décliné sur un site internet, des livres pour enfants, des ressources pédagogiques pour les enseignants, des documentaires, etc. La volonté du magazine a été d’ouvrir les yeux sur l’esclavage aux Etats-Unis, de permettre aux américains de porter leur regard avant le XIXe s. et la guerre de Sécession. Il a recréé un récit des origines prenant en compte 1619 comme année de naissance de la nation, en restituant l’ambivalence de cette terre où certains y ont trouvé la liberté (puritains du Mayflower) et d’autres l’asservissement (Africains). Un tumulte mémoriel éclate avec ce numéro du New York Times, au ton polémique : 1619 est mis en concurrence avec d’autres récits fondateurs (arrivée du Mayflower en 1620, Déclaration d’indépendance en 1776), relevant leurs contradictions.
Récupération politique
Sans surprise, en plein premier mandat Trump, ce récit alternatif des origines fait l’effet d’une bombe dans les milieux politiques conservateurs et néoconservateurs.
S’affirmant face au tumulte, Trump dénonce une incitation à la haine, un « endoctrinement gauchiste » des élèves et met en place une éducation « patriotique ». Le contenu des enseignements est interrogé ainsi que la liberté d’enseigner et le sens de l’enseignement de l’histoire.
Quant aux historiens, s’ils ont critiqué certains faits, la valeur citoyenne du projet a été largement soutenue. L’autrice rend compte des controverses sur les enjeux publics de l’histoire et des critiques parfois virulentes qui témoignent de la prise au sérieux des débats suscités par le magazine et les commémorations de 2019.
Loin d’apaiser le rapport des Etats-Unis avec leur passé, l’écho du « 1619 Project » contre le racisme systémique se fait encore entendre, dans un climat où l’actualité est toujours marquée par les inégalités et les violences raciales endémiques, dont témoignent les manifestations en 2014, Black Lives Matter.
« Une guerre culturelle »
Un des objets de lutte pour l’égalité est l’espace public et les politiques de mémoire qui lui sont associées.
En Virginie, un des premiers Etats américains, comment raconter une autre histoire que celle de Pocahontas et des colons anglais et promouvoir des lieux de mémoire, alors que l’espace public est largement investi par les traces des confédérés, le passé esclavagiste et les lieux des plus importantes batailles de la guerre de Sécession ? De nombreux activistes et associations jouent un rôle de premier plan pour occuper l’espace public dans l’ensemble du pays pour continuer à faire vivre les valeurs de la Confédération.
Ainsi on découvre qu’a lieu une « guerre » mémorielle par l’entremise de panneaux commémoratifs, plaques mémorielles et statues des héros. Certains retraits et donc dé-commémorations sont demandés depuis les années 1970 mais des hommes politiques influents rendent cela difficile.
Ainsi, dès les années 1994,quand des recherches archéologiques sur le site de Jamestown sont entreprises par une association privée et qu’un premier panneau commémoratif est installé, cela prend rapidement une tournure politique. Après plusieurs déplacements et réécritures, ce panneau trouve finalement une place en front de mer à Fort Monroe où le président Obama a, en 2011, le projet d’un monument national, dénotant une volonté politique qui va prendre de l’importance jusqu’à ce que 2019 devienne « l’année du souvenir ». Cependant, le travail mené dans l’espace public, et les commémorations, sont contestées en Virginie où de graves affrontements avec l’extrême-droite suprémaciste éclatent en 2017.
Cet espace public est alors présenté comme partie prenante d’un système d’oppression. Comment vivre ces espaces qui héroïsent l’esclavage ? Quelle appartenance à la vie citoyenne peuvent avoir les Africains-Américains dans ce contexte ?
Un passé qui ne passe pas
Les tensions raciales ont empiré pendant le premier mandat de Trump. En 2020, les contestations prennent une ampleur importante avec le mouvement Black Lives Matter, et la mort de G. Floyd. 1619 apparaît sur les pancartes des manifestants et devient l’année zéro de l’oppression raciale. La violence de leur expression dans l’espace public ne se limite alors plus au Sud confédéré mais gagne toutes les formes de glorification du passé colonial, impérial ou esclavagiste, et dépasse le seul cadre états-unien avec fracas.
L’année 1619 est érigée en symbole des inégalités subies par les Africains-Américains, qui obtiennent une reconnaissance avec une date nationale de commémoration, le 19 juin, pour commémorer la fin de l’esclavage aux Etats-Unis (en 2021, J. Biden).
Si la mobilisation a permis de sortir d’un récit univoque de la naissance des Etats-Unis, les Africains-Américains font toujours l’expérience d’inégalités et de violences raciales, d’une ghettoïsation comme à Chicago, et de l’exclusion du récit national comme de l’espace public.
Pour beaucoup, le combat est inachevé. L’activisme africain-américain est encore bien présent, les plus radicaux demandant réparation pour l’esclavage et la ségrégation. Aujourd’hui pour beaucoup, la causalité de ces inégalités endémiques sont à chercher dans le legs de l’esclavage comme l’avait affirmé le président Obama en 2008.
Ainsi 1619 devient une date utile pour dénoncer ces discriminations en les inscrivant dans la longue durée. 1619 permet de produire un autre récit des origines, intégrant les Africains-Américains, dans la naissance des Etats-Unis.
A la migration européenne des « pèlerins » en 1620 répond, un an plutôt, celle forcée, des captifs d’Angola et leur asservissement.
Au-delà des frontières ?
1619 est une date perçue comme états-unienne. En Europe, elle a peu d’impact comme en France qui s’est mobilisée pour mettre en place son propre travail mémoriel sur l’esclavage à partir des années 2000. Sur le continent africain, en 2019, seuls le Bénin et le Ghana se sont associés à la commémoration. Au Ghana, des circuits de tourisme mémoriel à destination de la diaspora africaine des Etats-Unis ont ainsi été proposés.
Une mémoire commune, mondialisée, se tisse autour de l’esclavage et de la mémoire de la traite transatlantique.
L’attention portée au passé esclavagiste des Etats-Unis dans cet ouvrage peut inviter à nous interroger sur les politiques de la mémoire dans l’espace public, la formation complexe d’une mémoire collective, et l’importance de la parole historienne.