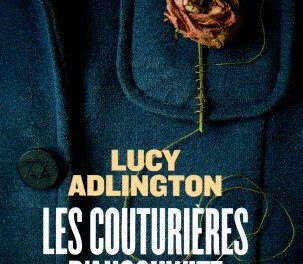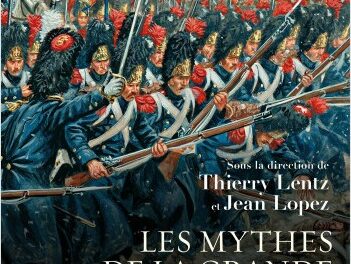Après huit ans de guerre, et plus d’un siècle de présence coloniale française, lorsque le million de « pieds-noirs » quitte le pays, que devient l’Algérie ? Que devient l’espoir soulevé chez tous les opposants au colonialisme ? Comment les militants français de métropole les plus actifs dans le soutien à l’Indépendance ont-ils continué leur engagement ?
Par ailleurs, peut-on, en 2009, traiter de cette période et de l’engagement de ceux, français, qui ont soutenu le combat des nationalistes algériens, puis le nouvel Etat indépendant, sans risquer l’anachronisme d’un constat désenchanté des échecs successifs des tentatives révolutionnaires, dans le Tiers-monde ou au Nord ? Face aux puissantes vagues des pensées dominantes actuelles, qui jettent le discrédit sur les engagements politiques antérieurs, ou oscillent entre réhabilitation et repentance, et mémoire plutôt qu’histoire, comment comprendre les motivations profondes de cette génération qui voulut prolonger son anticolonialisme par une volonté de transformation du monde ?
Dans l’euphorie agitée de l’été 62, entre les violences des résistants FLN de la vingt-cinquième heure, les règlements de compte divers et les attentats « terre brûlée » de l’OAS, il y a place pour ceux qui choisissent de participer à l’édification du socialisme dans un pays neuf aux ambitions les plus hautes. On ne sait combien font le trajet inverse de celui des « rapatriés » et viennent à Alger pour apporter leur contribution à l’Algérie nouvelle en occupant les postes laissés vacants par l’exode forcé d’au moins 80% des européens qui vivaient au moment des Accords d’Evian. Ils sont enseignants, médecins, journalistes, fonctionnaires, cinéastes ou comédiens, ingénieurs ou architectes.
Combler le déficit en cadres
Ils viennent combler le brutal déficit en cadres dont souffre le pays. Mais ils sont surtout militants, engagés, convaincus et attirés par une expérience révolutionnaire dans laquelle ils pensent avoir un rôle à jouer. Avec une grande diversité : socialistes non encartés, « nouvelle gauche » et chrétiens de gauche, communistes en délicatesse avec le Parti en France, trotskistes. Leurs modèles implicites sont Cuba, l’Espagne républicaine ou la Résistance. C’est cette « brigade internationale » qui se met au service du jeune Etat qui est surnommée avec dérision « pieds-rouges ». Les « pieds-rouges », ce sont ceux qui, après le départ massif des « pieds-noirs », sont arrivés pleins d’espoir de transformation du monde, militants anticolonialistes, de gauche et d’extrême gauche, parfois anciens « porteurs de valise », pour soutenir (participer à ?) la jeune Algérie indépendante, « révolutionnaire ». Si leur existence est connue depuis longtemps, rares sont les allusions précises à leur nombre (quelques milliers ?), à leur rôle, et à leur sort dans les premières années de la République algérienne. Catherine Simon a mené une enquête de journaliste très approfondie : elle a interrogé en deux années près de 80 acteurs de cette période, et donne ainsi la parole à une génération de militants jusque là plutôt silencieux. Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui connus pour d’autres raisons, et ont pu adopter, le temps aidant, un recul suffisant pour aller au-delà du simple récit-témoignage.
L’engagement a pris des formes très variées, selon les compétences mais aussi les objectifs politiques de chacun.
On retrouve par exemple des conseillers politiques au plus haut niveau (celui du président Ben Bella) : non seulement les trotskystes de la mouvance « pabliste » (on attribue à Michel Raptis, alias « Pablo », la paternité des décrets benbellistes de 1963 sur l’autogestion socialiste), mais aussi d’autres personnalités comme Hervé Bourges (qui plus tard, de retour en France accèdera à des fonctions politiques ou médiatiques de premier plan). Certains viennent avec la volonté d’artistes engagés : Jean-Marie Boëglin pense prolonger son expérience au TNP ou avec Roger Planchon en créant le Théâtre national algérien, ou encore « la bande de la Cinémathèque », pianiste inclus, vont faire d’Alger une ville qui accueille régulièrement des artistes du monde entier, où on joue Molière et Brecht en arabe.
Trajectoires diverses
Le journaliste et géopoliticien Gérard Chaliand, le spécialiste en cinéma Guy Hennebelle, les journalistes ou écrivains Maurice Maschino, Jean-Louis Hurst, Basile Karlinsky, Juliette Minces, les universitaires Jeanne Favret-Saada et Elizabeth Roudinesco, l’écrivain Ania Francos, l’avocat Tiennot Grumbach, le photographe Elie Kagan, les cinéastes Marceline Loridan et René Vautier, les électrons libres venus d’Egypte Henri Curiel, Didar Fawzy ou Lotfallah Soliman, le parolier Pierre Grosz
D’autres, moins connus, médecins, journalistes et enseignants, se heurtent rapidement à un certain nombre de contraintes, grandissantes, et qui annoncent la suite : l’obligation des journalistes à signer d’un nom de plume à consonance arabo-musulmane ; le machisme affirmé ; la référence toujours plus insistante aux « valeurs nationales algériennes », confondues avec les principes d’un islam de plus en plus étroit ; l’arabité imposée à tous, et nourrie de façon toujours plus ostensible d’un rejet de l’ « occident impérialiste corrupteur », et donc la mise à distance des « gaouris » (épithète péjorative pour « chrétiens ») de tous les débats politiques qui comptent, où ils sont tenus à la plus grande réserve. Pour certains, cela tournera au cauchemar. Pour tous au « désenchantement », comme le suggère le sous-titre du livre.
Si l’expérience (l’illusion ?) des « pieds-rouges » s’achève, elle ne se conclue pas par une autocritique généralisée, ni par une confession politique de ceux qui ont fait ce choix-là, à ce moment historique-là. Sans doute parce que le degré de culpabilité collective des anciens colonisateurs est trop profond et pousse à l’autocensure. Sans doute aussi parce que l’opinion publique en France n’est pas du tout prête à entendre parler des « torturés d’El Harrach » (c’est à dire du renversement des rôles qui fait passer des victimes les nouveaux bourreaux). Peut-être aussi parce que ceux qui se sont engagés, même devant ce qui apparaît un échec, refusent de jouer les renégats comme tant d’anciens « révolutionnaires » devenant les plus farouches des réactionnaires.
C’était au temps des militants, avant le désir d’humanitaire, et ce livre pourrait bien être utile en particulier aux plus jeunes des professeurs d’histoire –géographie, qui n’ont pas connu la période charnière entre la fin de la guerre d’Algérie et les derniers feux du tiers-mondisme militant. Ce livre nous parle d’un temps où « Alger, c’était La Havane », puisqu’on pouvait y croiser Castro et le Che, les activistes noirs américains, ou les dirigeants des organisations révolutionnaires de tout le Tiers-Monde. Le voyage en Algérie, c’était la rencontre avec les « frères » algériens, qui accueillaient à bras ouverts la « vraie France », par opposition avec celle des colons, des paras et de l’OAS.
Le fait que ce livre soit publié dans la collection « Cahiers libres » fondée par François Maspero y contribue encore. C’est une sorte de chaînon manquant qui est reconstitué ici, entre les travaux récents de jeunes historiens renouvelant le regard porté sur la Guerre d’Algérie et les quelques ouvrages retraçant l’arrivée des rapatriés d’Algérie en métropole
Le camp des vaincus
Cependant ce regard, plutôt de journaliste que d’historien, laisse de côté plusieurs aspects qui auraient mérité une attention. Si on évalue à 4 sur 5 la proportion de « pieds-noirs » ayant gagné la métropole, c’est bien qu’une partie non négligeable d’entre eux ne sont pas partis, au moins dans un premier temps. Certains d’entre eux sont à peine évoqués (je pense par exemple, autour d’Henri Alleg, qui est cité ici avec le journal Alger Républicain, aux membres d’origine européenne du PCA ; ou encore aux « petits blancs » demeurés en Algérie dans les premières années de l’Indépendance, avec les illusoires garanties que leur donnaient les Accords d’Evian). Comment ont-ils cohabité avec ces « pieds-rouges » ? « L’histoire de ceux qui sont restés n’a pas été écrite », mais les départs ont continué ensuite de façon diffuse, sous forme d’un flux continu et non plus d’un exode brutal, selon Bruno Etienne. Selon Hélène Bracco, dans « L’autre face. Européens en Algérie indépendante», paru en 1997, ils étaient encore 30.000 en 1993. Ensuite la décennie de guerre civile, ainsi que le vieillissement, ont fait fuir un grand nombre de ceux qui étaient devenus des « Algériens d’origine européenne », particulièrement visés par les menaces des islamistes.
Si l’arrivée progressive de « coopérants techniques », détachés par la France, et avec un statut, des revenus, des objectifs idéologiques et un mode de vie totalement différents des « pieds-rouges » est évoquée, elle aurait mérité aussi d’être développée. Ceux-là ont de tout autres moteurs, ils viennent pour une durée limitée, et ont un rapport radicalement différent avec le pays et la population.
Comme l’a écrit Benjamin Stora, les « pieds-rouges » appartiennent au camp des vaincus, et ce sont les vainqueurs qui écrivent l’Histoire. Le renversement brutal de Ben Bella en juillet 1965 va interrompre l’expérience, parfois tragiquement. Le récit de la journée des femmes du 8 mars 1965 donne la mesure des tensions surgies à ce moment (voir aussi dans la revue Clio, en 1997, l’article de Catherine Lévy, consultable en ligne http://clio.revues.org/index415.html ) . L’armée au pouvoir avec Boumediene, plus le FLN parti unique aux mains des nationalistes les plus conservateurs, vont rapidement les éliminer, parfois en revenant aux pires pratiques de l’armée coloniale française : arrêtés, parfois torturés, et renvoyés en France, les « pieds-rouges » ont le plus grand mal à se réinsérer en France. Dans l’ancienne métropole, on ne les attend pas, et on ne peut entendre le message qu’ils portent : dans les milieux de gauche, l’image de l’Algérie, chef de file des non-alignés, ne peut être écornée. A droite, on ne veut plus entendre parler de l’Algérie.
A posteriori, il est facile de voir que l’erreur des « pieds-rouges » est de n’avoir pas repéré la nature véritable du nationalisme algérien. Dans le contexte idéologique des années soixante (anticolonialisme et Guerre froide, influence du marxisme dans les sciences humaines, etc.), les dirigeants algériens apparaissent comme leaders du Tiers Monde et du non-alignement : révolutionnaires, marxisants et laïcs. En réalité les courants dominants sont déjà là, qui progressivement mèneront l’Algérie vers le drame de la guerre civile : un nationalisme intransigeant, fondé sur l’arabité et l’islam religion d’Etat. Et comme corollaire, l’exclusion des autres identités : berbères, juifs et européens d’origine.
Le sous-titre « Des rêves de l’Indépendance au désenchantement » résume bien les choses. Catherine Simon, qui fut plusieurs années correspondante du journal Le Monde à Alger, a choisi l’année 1969 comme césure : le Festival panafricain d’Alger, cette année-là lui semble clore cette période : les « pieds-rouges » ont à ce moment-là perdu toute influence. S’ils n’ont pas étés poussés hors du pays, ils sont isolés et marginalisés, y compris ceux qui avaient opté pour la nationalité algérienne. Ils ont réalisé combien l’Algérie nouvelle échappe à l’idéal qu’ils y cherchaient.