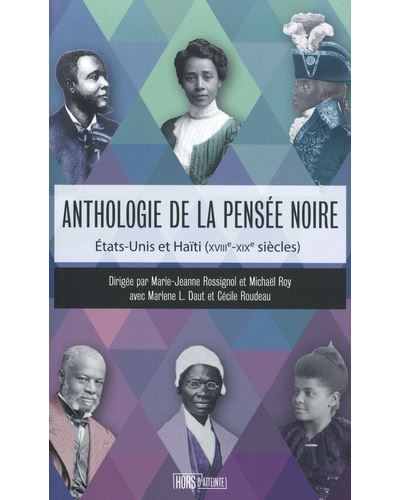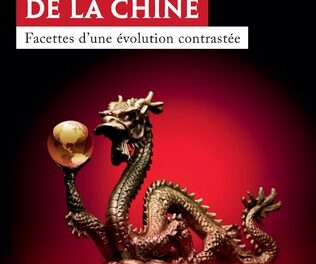« États-Unis, votre bannière arbore
Deux emblèmes – dont l’un dit votre renommée,
Et l’autre, hélas, vous déshonore,
Et nous rappelle votre indignité !
La liberté de l’homme blanc
S’orne d’étoiles à votre gloire,
Mais vos rayures rouge sang ?
Ce sont les cicatrices des Noirs. »
C’est en 1836 que le poète écossais Thomas Campbell rédigea cet épigramme. Il fut inséré par l’esclave fugitif William Craft dans le récit de ses aventures publié à Londres en 1860. Celui-ci avait fui le Sud états-unien avec son épouse Ellen, grâce au teint clair et au déguisement de cette dernière qui put passer, durant leur voyage en train et en bateau, pour un propriétaire d’esclaves à moitié sourd et perclus de rhumatismes.
Ainsi, la pensée noire publiée en langue anglaise ou française au XVIIIe et XIXe siècles s’appuya sur une pensée blanche alliée. Il s’agissait de réfuter les penseurs blancs animés plus ou moins ouvertement de motivations contraires aux valeurs issues des Lumières, celles formulées dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776) ou la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Révolution française (1789). La pensée noire a en effet révélé précocement l’hypocrisie et le déni présents au sein des espaces anglophone et francophone quand il s’agissait d’inclure les personnes dites de couleur dans la mise en œuvre de ces valeurs. En 1776, Lemuel Haynes, né d’un père noir et d’une mère blanche, confia : « il ne me semble pas excessif d’affirmer que même un Africain a droit à cette Liberté dont se réclament les Anglais. » (p. 275). Par ailleurs, analysant la tentative de restauration de l’esclavage par la France napoléonienne à Saint-Domingue, les Haïtiens Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Juste Chanlatte dénoncèrent respectivement la trahison et la duplicité des généraux Brunet et Leclerc (p. 343), la « pipeuse éloquence » des agents français (p. 288-289) et l’abus de la « confiante crédulité » du « peuple naissant » d’Haïti « par des proclamations signées du chef de la République française » (p. 298). Toutefois la diffusion de cette pensée noire se cantonna à des cercles restreints, si bien qu’aujourd’hui encore des pionnières et pionniers comme Maria W. Stewart, Sojourner Truth, John Brown Russwurm, Julien Raimond ou le baron de Vastey sont très mal connus. Cette anthologie réunit un corpus de textes largement invisibilisés.
Le premier intérêt de l’ouvrage est ainsi de combler un vide de l’édition francophone s’agissant de la littérature antiraciste des siècles passés. Dès son origine, la pensée noire couchée sur le papier a en effet mis en lumière les discriminations les plus subtiles ou grossières, apportant sa pierre à la construction de l’édifice humain. Elle n’est bien entendu pas née avec le Mouvement des droits civiques, durant la Renaissance de Harlem ou avec le courant de la négritude dans l’entre-deux-guerres, ni même à l’aube du XXe siècle avec W.E.B. Du Bois. ll y a deux cent quinze ans, Henri dit l’Abbé Grégoire publiait déjà son fameux De la Littérature des nègres.
Cette anthologie a également le mérite de sortir du cadre national et de favoriser les études comparatives entre littératures africaine-américaine et haïtienne. Les États-Unis et Haïti furent les deux premières nations indépendantes de l’ère des révolutions. À partir de l’indépendance d’Haïti en 1804 se forgea une solide fraternité transnationale entre les deux communautés. Les contextes furent toutefois bien différents car les Haïtiens n’eurent pas à vivre au sein d’une majorité blanche tourmentée par le risque des révoltes noires. Les États-Unis ne reconnurent officiellement l’indépendance d’Haïti qu’en 1862 et occupèrent militairement l’île entre 1915 et 1934.
Cinquante deux textes originaux sont rassemblés par un collectif de chercheurs issus majoritairement d’universités parisiennes, sous la direction de Marie-Jeanne Rossignol et Michaël Roy. Les textes africains-américains sont traduits en français, un bon nombre probablement pour la première fois dans un cadre éditorial. Le tout est augmenté de paratextes fort utiles, d’une vingtaine d’illustrations en noir et blanc, d’une chronologie, d’une bibliographie et d’un index des noms. L’ouvrage est publié avec le soutien de l’Institut universitaire de France par l’éditeur Hors d’Atteinte basé à Marseille. Les textes originaux sont variés : poèmes, extraits de pamphlets, lettres, allocutions ou encore récits de vie. Le tout est organisé en cinq parties :
I. Traite, esclavage et colonisation
II. Race, genre et préjugés
III. Vie des communautés noires
IV. Révoltes, révolutions et indépendances
V. Post-esclavage, histoire et mémoire
Les permanences frappent à la lecture des textes. La présence sur environ trois siècles de discours militants noirs aux contenus en partie similaires, quels que soient les lieux et époques, répond à la persistance sur la longue durée du racisme anti-Noirs. En dépit de discours majoritaires édulcorés de nos jours dans les démocraties d’Europe et d’Amérique du Nord, les discriminations concrètes demeurent pour les communautés noires, souvent vivement ressenties au sein des diasporas comme des populations subsahariennes.
Sincèrement séduits par l’idéologie et les principes républicains, les autrices et auteurs noirs défendaient un universalisme tenant compte des discriminations raciales pour mieux revendiquer l’égalité et l’indépendance réelles. Il s’agissait assez rarement de défendre une quelconque supériorité noire ou d’échafauder des discours déconnectés du réel, polygénistes ou afrocentristes par exemple. La doctrine monogéniste, ou croyance en l’unité de l’humanité « dans le temps comme dans l’espace » (p. 200), était défendue par les pasteurs comme Richard Allen – fondateur de la première Église noire états-unienne – ou les savants comme Anténor Firmin – ministre en Haïti puis ambassadeur à Paris.
Les militantes et militants noirs des XVIIIe et XIXe siècles furent confrontés au profond dilemme quant à la forme, violente ou pacifique, que devait prendre la lutte, comme plus tard les activistes du Mouvement des droits civiques. Fondée sur une foi chrétienne ardente, la doctrine du black uplift (élévation des Noirs) imprégna fortement une population vouée au labeur dans le cadre d’une moralité irréprochable (p. 211). Plusieurs textes (p. 186-189, 198) révèlent une réelle conscience des risques d’inversion inspirés par la colère, elle-même surgie des espoirs déçus de 1776 et 1789. Ainsi, il ne s’agissait pas de répondre aux discriminations et à la cruauté par la violence. Rares furent les Africains-Américains qui osèrent comme David Walker ou Henry Highland Garnet appeler ouvertement à l’insurrection (p. 272). Et pourtant l’État fédéral prit souvent le parti du Sud avant la guerre de Sécession. Et pourtant la ségrégation dans le Nord comme dans le Sud déboucha sur les premières lois raciales dès le début du XIXe siècle, bien avant de culminer avec l’arrêt Plessy vs. Ferguson en 1896 (p. 221, 233). Et pourtant les lynchages se multiplièrent à la fin du siècle, dénoncés avec force par Ida B. Wells – esclave puis institutrice, journaliste à Memphis (Tennessee), puis activiste à New York et Chicago :
« Les articles qu’ils [les hommes blancs] publient donnent des Noirs une image détestable afin de justifier les lynchages. […] Il est effrayant de constater à quel point les épisodes de violence populaire [aboutissant aux lynchages] ont gagné en fréquence et en intensité. […] Ce dont nous avons réellement besoin, c’est que l’opinion publique réclame que la loi soit respectée et que tout homme, blanc comme noir, puisse plaider sa cause devant un tribunal légitime » (p. 390, 394).
Ce très beau travail collectif de recherche, de traduction et d’édition a nécessairement ses limites. Tout d’abord, l’importante question de la colonisation dans le sens d’« expatriation plus ou moins contrainte des Africains-Américains libres en Afrique, dans une « colonie » achetée par le gouvernement états-unien, le Libéria » (p. 155) est évoquée à plusieurs reprises sans faire l’objet d’un seul des cinquante deux textes (1). Par ailleurs, aucune femme haïtienne n’est représentée contre neuf états-uniennes. Est-ce à dire que la société haïtienne était davantage patriarcale ? Enfin, les paratextes osent l’emploi d’un vocabulaire que certains jugeront anachronique. Les éditeurs en ont bien conscience qui intitulent leur introduction : « Des sources anciennes pour un débat actuel » (p. 13). La présentation des textes contient en effet des termes actuels absents des sources, parfois sujets à controverse, comme intersectionnalité (p. 100, 152, 371), afrocentrisme (p. 130), afroféminisme (p. 353) ou créolité (p. 365). L’objectif est évidemment de mettre en lumière à la fois l’intemporalité et l’actualité brûlante de textes dont la force réside tout particulièrement dans leur anticipation des problèmes du XXe siècle, dont nous ne sommes pas complètement sortis, loin s’en faut.
(1)
D’importantes personnalités africaines-américaines ont pourtant écrit au sujet de la colonisation sur la côte ouest-africaine (Paul Cuffe, James Forten, John Brown Russwurm, Samuel Ennals & Philip Bell…). La colonie du Libéria basée à Monrovia n’a pas été « achetée par le gouvernement des États-Unis » mais fut acquise sur initiative privée, par la Société américaine de colonisation (ACS). Il est vrai que l’ACS fut très proche du gouvernement des États-Unis. Les réunions annuelles du Conseil de l’ACS siégeaient au Capitole à Washington. Le secrétaire de l’ACS était également aumônier de la Chambre des représentants. Enfin, plusieurs membres de l’ACS furent présidents des États-Unis. Voir notamment Liana M. Ursa, Liberia : la difficile construction nationale, Paris, l’Harmattan, 2016, p. 32-35.