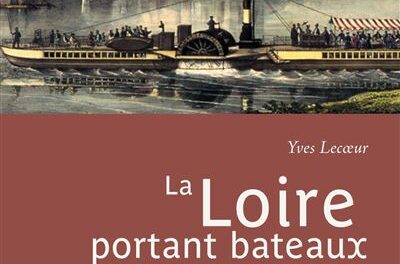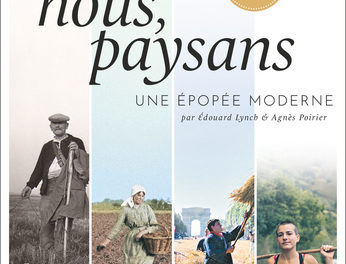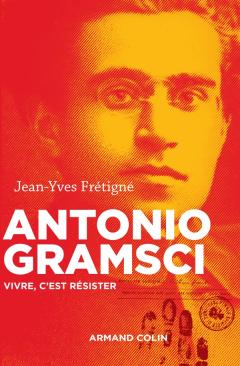 Depuis plusieurs décennies les études sur Antonio Gramsci et son œuvre s’accumulent, dans l’aire italienne et dans le monde anglo-saxon notamment, où il est devenu un « classique » des sciences sociales. La bibliographie consacrée à Gramsci compterait plus de 18000 titres dans plus de 40 langues. La France est restée pendant longtemps beaucoup moins réceptive à la pensée de Gramsci, malgré l’existence d’une tradition gramscienne remarquable (traduction et publication chez Gallimard des Cahiers de prison en cinq volumes, travaux de Louis Althusser dans les années 70, d’André Tosel…). Depuis quelques années Gramsci, fait cependant l’objet d’un véritable engouement dans le paysage intellectuel français : études, anthologies, colloques… Redevenue à la mode, la pensée de Gramsci est hélas souvent réduite à quelques formules ou concepts célèbres : « hégémonie culturelle », « intellectuels organiques », « guerre de position, guerre de mouvement », « révolution passive », « Etat élargi »… Caricaturée, déformée, la pensée du marxiste italien a même été récupérée et instrumentalisée par la droite et l’extrême-droite !
Depuis plusieurs décennies les études sur Antonio Gramsci et son œuvre s’accumulent, dans l’aire italienne et dans le monde anglo-saxon notamment, où il est devenu un « classique » des sciences sociales. La bibliographie consacrée à Gramsci compterait plus de 18000 titres dans plus de 40 langues. La France est restée pendant longtemps beaucoup moins réceptive à la pensée de Gramsci, malgré l’existence d’une tradition gramscienne remarquable (traduction et publication chez Gallimard des Cahiers de prison en cinq volumes, travaux de Louis Althusser dans les années 70, d’André Tosel…). Depuis quelques années Gramsci, fait cependant l’objet d’un véritable engouement dans le paysage intellectuel français : études, anthologies, colloques… Redevenue à la mode, la pensée de Gramsci est hélas souvent réduite à quelques formules ou concepts célèbres : « hégémonie culturelle », « intellectuels organiques », « guerre de position, guerre de mouvement », « révolution passive », « Etat élargi »… Caricaturée, déformée, la pensée du marxiste italien a même été récupérée et instrumentalisée par la droite et l’extrême-droite !Malgré ce renouveau de l’intérêt pour le penseur italien, Gramsci reste selon les mots d’André Tosel, « ce célèbre inconnu ». La dernière biographie de Gramsci en langue française était celle de Giuseppe Fiore, parue en Italie en 1966 et publiée en France en 1970, rééditée 5 fois et depuis longtemps indisponible. A ce titre l’ouvrage de Jean-Yves Frétigné vient donc combler un vide historiographique important. Pour l’auteur, la connaissance de la vie de Gramsci a trop souvent été perçue comme le préalable à l’étude des textes de Gramsci. Or, le choix de l’exercice biographique permet de prendre véritablement en compte le contexte de l’élaboration de la pensée de Gramsci, indissociable de celle-ci, afin de mieux comprendre la richesse et la profondeur de sa démarche intellectuelle. Ce détour par le genre biographique est aussi revendiqué comme un antidote à un Gramsci trop souvent réduit à être « dépôt d’armes et boîte à outils ». La connaissance de la vie de Gramsci permet donc de mieux comprendre l’incroyable postérité de son œuvre.
Né à Ales en Sardaigne en 1891 dans une famille de petits fonctionnaires pauvres, Antonio Gramsci connaît une enfance difficile. Victime de représailles politiques, son père est emprisonné pendant 5 ans. Sa mère se retrouve seule pour élever sept enfants, sans aucun revenu. La famille connaît alors la misère. De santé fragile, Antonio devient bossu, il souffre en effet d’une forme rare de tuberculose de la colonne vertébrale, la maladie de Pott (le bon diagnostique ne lui sera d’ailleurs donné qu’en 1933). Entré tardivement à l’école, et malgré les interruptions de sa scolarité causées par la pauvreté de sa famille, Antonio est un excellent élève. Il s’oriente au lycée vers des études de philosophie et de littérature et obtient en 1911 une bourse pour aller étudier à Turin. En quittant sa terre natale, Gramsci s’éloigne de la terre de son enfance qu’il aime mais qu’il considère en même temps comme une prison. Sensibilisé aux idées socialistes, Gramsci se reconnaît alors dans l’idéologie sardiste et populaire, d’autant qu’après les grandes grèves de 1904, le Parti Socialiste Italien (PSI) commence à faire le lien entre la question sarde et la question sociale.
A Turin, Gramsci est un étudiant passionné et brillant mais sa misère sociale et physique ne lui permettent pas de suivre correctement ses études ni de les achever. Il étudie notamment la linguistique et il est marqué dans sa formation intellectuelle par plusieurs de ses professeurs proches du libéralisme et par des figures comme Benedetto Croce ou Giovanni Gentile. Gramsci se reconnaît alors dans la lecture de gauche d’un Hegel porteur d’un libéralisme moderne, celui de la tradition italienne. Ses premiers engagements politiques reflètent d’ailleurs cette formation intellectuelle turinoise. Il soutient ainsi en 1913 une pétition pour l’abolition du protectionnisme.
A Turin, première ville moderne du capitalisme italien, Gramsci commence à fréquenter les jeunes socialistes grâce à Angelo Tasca. Avec d’autres de leurs jeunes camarades étudiants, ils prônent un sursaut intellectuel des socialistes italiens par leur renforcement culturel et sont surnommés « cultiristi ».
C’est dans ce contexte idéologique et dans celui des débats en Italie entre neutralistes et interventionnistes que se situe la première intervention publique de Gramsci. Suite à la déclaration de guerre, le PSI reste fidèle au neutralisme. En octobre 1914 éclate la « bombe » Mussolini. Le chef de file de l’aile intransigeante du PSI, très populaire parmi les militants, écrit plusieurs articles dans l’Aventi, le journal du PSI, dans lesquels il appelle les socialistes à prendre parti pour l’interventionnisme. En novembre il fait paraître Il Popolo d’Italia, il est exclu du PSI . Fin octobre Gramsci publie dans le Grido del Popolo (« Le cri du peuple« ) son premier article dans lequel il s’oppose aux partisans de la neutralité absolue, et défend au contraire une neutralité active et opérante, il faut que les socialistes passent de l’idée « de la guerre à la guerre à celle de la guerre dans la guerre ». Il apprécie alors le « sens du concret réaliste » de Mussolini sans toutefois lui donner de blanc-seing. Accusé d’interventionnisme et de Mussolinisme, Gramsci va devoir s’effacer pendant un an et ne reprend la plume qu’en octobre 1915, en tant que journaliste à l’Avanti. Il devient un révolutionnaire professionnel, un intellectuel pour lequel le savoir est « un acte de libération ».
Journaliste encore peu connu, sans aucun rôle au sein du PSI mais proche des intransigeants, Gramsci écrit beaucoup. Marqué par les émeutes à Turin en août 1917, son combat reste essentiellement de nature culturelle. Il sort cependant de l’anonymat en publiant le 24 décembre 1917 son article « La Révolution contre le capital », dans lequel il prend position pour la révolution bolchévique, même s’il n’a que très peu lu Karl Marx et ne sait presque rien sur Lénine. Gramsci fixe son attention sur les Soviets et va s’efforcer de traduire en Italie la révolution bolchévique, comme expression de l’Etat des Soviets, comme Ordre nouveau.
Il fonde en mai 1919 la revue L’Ordine nuovo (L’Ordre nouveau) dans laquelle écrivent ses camarades Tasca, Terracini et Togliatti . Gramsci y fait notamment l’éloge des conseils ouvriers, mais les idées conseilléristes rencontrent peu d’écho en Italie alors qu’elle sont largement débattues dans la IIIème internationale. La majorité réformiste du PSI condamne les expériences de ce type en cours en 1919 à Turin. Bordiga, chef de file des intransigeants, voit au contraire dans le Parti communiste l’instrument le plus adéquat contre le capitalisme. Isolé, Gramsci écrit en mai 1920 l’article « Pour une rénovation du parti socialiste », texte non signé mais salué par Lénine. Il exprime déjà clairement l’alternative devant laquelle l’Italie est placée : prise du pouvoir par la classe ouvrière ou réaction violente imposée par la bourgeoisie. Lors des occupations d’usines à Turin en août et septembre 1920, le PSI ne soutient pas l’action des ouvriers qui s’organisent pour redémarrer la production. Le Président su Conseil Giolitti arrive à mettre un terme à la grève sans que le sang ne soit versé. Gramsci entend bien tirer les leçons de cet échec.
En janvier 1921 le Parti communiste d’Italie (PCD’I) est fondé à Livourne. Gramsci n’y joue qu’un rôle secondaire mais l‘Ordine nuvo devient le quotidien des communistes. Le Comité central (CC) du PCD’I le nomme représentant auprès de l’Internationale communiste (IC) et l’envoie à Moscou le 22 mai 1922. En Russie son état de santé se dégrade brutalement et il est hospitalisé pendant près de 6 mois dans une clinique où il rencontre Giulia Schucht, jeune musicienne russe, qui deviendra sa femme et avec qui il aura un fils. Mais leur relation amoureuse est morcelée et compliquée, Antonio ne voit que très peu son fils. Il ne connaîtra d’ailleurs jamais son deuxième fils, né en août 1926.
Au IVème Congrès de l’IC en 1922, Bordiga, leader du PCD’I, continue de refuser la stratégie du front uni avec le PSI préconisée par l’IC ; par loyauté et fidélité, Gramsci soutient Bordiga. La répression fasciste s’accroît et le PCD’I est contraint à la clandestinité, Bordiga est arrêté en février 1923. L’IC souhaite confier les rênes du PCD’I à Grasmsci et envoie ce dernier à Vienne en 1923. Bordiga, de sa prison, écrit un Manifeste aux camarades du PCD’I dans lequel il critique la position de l’IC. Gramsci choisit alors de s’éloigner de ce dernier. Il propose la création d’un journal de toutes les gauches, l’Unità, et entend former un « centre » dans le parti, entre la gauche de Bordiga et la droite de Tasca, sur une ligne de fidélité à l’IC . L’Unità tire alors à 40000 exemplaires, le PCD’I est la principale force de gauche. Gramsci est élu député de Vénétie aux élections législatives d’avril 1924. Il rentre alors en Italie et se lance à la conquête du PCD’I.
Avec l’enlèvement de Matteotti le 10 juin 1924, dont le corps sera retrouvé le 16 août, s’ouvre la crise la plus sérieuse du fascisme. Gramsci pense alors que la tactique du front uni peut se réaliser pour porter un coup décisif au régime fasciste. Les communistes appellent à la grève générale mais la direction du syndicat CGL renonce. Les députés du PSI et du PSU (né d’une scission du PSI) se joignent à ceux du PPI (Parti Populaire Italienne) pour refuser de participer aux travaux de la Chambre (« Sécession de l’Aventin »). Cette opération est une impasse et le régime fasciste reprend rapidement la main et passe à la phase de « légalisation de la dictature » (Pierre Milza) avec notamment l’adoption, en1926, des « lois fascistissimes ». Les communistes appellent à lutter sur tous les fronts, Gramsci sillonne la péninsule dans la clandestinité, ce qui lui permet de revenir en Sardaigne en octobre 1924. Le PCD’I fait le choix d’être présent à la rentrée parlementaire. Gramsci prononce le 16 mai 1925 son premier et unique discours à la Chambre des députés dans lequel il livre une fine analyse du fascisme mais reste persuadé de la victoire prochaine de l’alliance entre les ouvriers et les masses paysannes. Il commet surtout l’erreur politique, comme tous les dirigeants du PCD’I, de nier la dimension démocratique de la culture antifasciste, en considérant Giovanni Amendola, leader de le sécession de l’Aventin, comme un allié objectif de Mussolini. Face à la répression, le PCD’I s’enfonce alors dans la clandestinité.
Le IIIème congrès du PCD’I se tient à Lyon en janvier 1926. Gramsci choisit alors la confrontation avec Bordiga et rédige les Thèses de Lyon. Contre Bordiga, il estime que l’acte fondateur du PCD’I est la Révolution d’octobre et l’apport du léninisme au marxisme. Il soutient la nécessaire bolchévisation du PCD’I et refuse par exemple toute forme de faction au sein du parti. Enfin, le penseur sarde voit dans le fascisme l’alliance de la petite bourgeoisie et de la réaction des agrariens, qui fait du fascisme le remplacement d’une élite par une autre. La motion de Gramsci remporte 90,8 % des suffrages. Il devient le leader incontesté du PCD’I mais sur les 70 délégués présents à Lyon, 60 sont arrêtés dans les mois suivants par le régime fasciste. La répression redouble contre le PCD’I dont les effectifs chutent, le rapport de force est désormais totalement favorable au fascisme.
Cette même année 1926, Gramsci publie 2 textes dont Quelques réflexions sur la question méridionale, essai inachevé,considéré depuis comme un classique de la réflexion sur la question du Mezzogiorno italien. Gramsci considère que le PCD’I doit donner de la terre aux paysans et les organiser de manière autonome pour « désagréger le bloc intellectuel qui est l’armature, souple mais très résistante, du bloc agraire » constitué de la grande masse des paysans, des intellectuels de la petite et moyenne bourgeoisie rurale et des grands propriétaires fonciers. Gramsci continue de croire à la perspective d’une révolution dans un avenir assez proche. Cet optimisme surprenant au regard du contexte est nourri, selon J-Y Frétigné, par la faiblesse de l’analyse gramscienne du fascisme qui n’a pas pris la mesure de l’importance des lois fascistissimes et de la forte capacité du fascisme à encadrer la société. En définitive, il surestime la capacité révolutionnaire des communistes italiens et sous-estime le fascisme, dont il n’a pas encore perçu les tendances totalitaires.
Le dernier acte politique majeur de Gramsci s’inscrit dans le contexte des débats qui 1926 déchirent le PCR (Parti communiste russe) et qui voient la récente alliance entre Trotsky et Zinoniev être mise en minorité par Staline-Boukharine. Ces deux derniers l’emportent largement et imposent leur ligne : Zinoniev est exclu du Bureau politique, Trotsky est à son tour exclu du CC du PCR. Dans les colonnes de l’Unità, Gramsci soutient la ligne majoritaire définie par le XIVème congrès du PCR sans s’appesantir sur les débats qui divisent les bolcheviks. Dans un second temps, Gramsci, à la demande de la direction du PCD’I, écrit au CC du PCR, sans doute le 14 octobre 1926. La lettre est reçue par Togliatti, nouveau représentant du PCD’I auprès de l’IC, qui répond à son tour à Gramsci. Ces lettres n’ont été publiées qu’après la guerre, la difficulté de Togliatti à en reconnaître l’existence pose la question d’une forte divergence idéologique entre les deux leaders du PCD’I qui n’auront plus de contacts par la suite. Dans la 1ère lettre, Gramsci défend l’existence de discussions pour forger l’indispensable unité du PCR mais il juge nécessaire l’intervention des « partis frères » afin d’éviter une scission du PCR. Il fait l’éloge de la bolchévisation mais rappelle que l’unité et la discipline du parti ne peuvent s’obtenir par la contrainte, mais par la loyauté et la conviction. Il termine sa lettre en réaffirmant la nécessaire unité du PCR afin d’éviter la scission « du noyau central léniniste qui a toujours été le noyau dirigeant du parti et de l’Internationale ».
Cette lettre marque le début de la méfiance de Staline vis-à-vis du PCD’I et de Gramsci en particulier. Dans sa réponse, Togliatti réaffirme la justesse de la ligne suivie par la majorité du CC. Selon lui, le CC n’a pas le moindre tort et toutes les fautes incombent à l’opposition. Dans la 3ème lettre, Gramsci dénonce le « caractère vicié de bureaucratisme » du raisonnement de Togliatti. La rupture avec ce dernier est consommée et selon J-Y Frétigné cet échange de lettres dessine « deux conceptions du communisme, l’une qui sera celle de l’orthodoxie soviétique,l’autre, plus libre, qui trouvera sa pleine mesure dans les Cahiers de prison ». La lettre de Gramsci provoque une réunion clandestine du PCD’I en novembre 1926. Les dirigeants du BP et du CC italien finissent par s‘aligner sur la ligne de la majorité Stalinienne du PCR.
L’auteur estime que cette polémique avec Togliatti laisse à penser que, même sans son emprisonnement qui le coupe du militantisme, Gramsci n’aurait sans doute pas sombré dans le stalinisme.
Antonio Gramsci est arrêté le 8 novembre 1926 malgré son immunité parlementaire théorique. Son arrestation est totalement illégale. D’abord condamné 5 ans au « confino », Gramsci est envoyé sur l’île d’Ustica. Il est ensuite transféré dans des conditions très éprouvantes pour sa santé à la prison de Milan. Le procès de Gramsci débute le 28 mai 1928. Il est condamné à vingt ans de prison après que le procureur a déclaré qu’il fallait « empêcher ce cerveau de fonctionner pendant vingt ans ». Il est incarcéré à Turi dans les Pouilles dans des conditions extrêmement difficiles. J-Y Frétigné consacre ici plusieurs pages à la « fameuse lettre de Grieco », envoyée par un militant communiste italien en exil à Bâle, depuis Moscou. La lettre est lue par l’OVRA. Elle provoque la colère de Gramsci car il considère qu’elle le désigne clairement comme un dirigeant majeur du PCD’I clandestin et qu’elle lui nuit très gravement, compromettant notamment les tentatives de libération en cours. Gramsci soupçonne alors son parti de chercher à lui nuire et critique l’attitude de Togliatti dans sa correspondance privée. L’hypothèse de la responsabilité de Togliatti est partagée aujourd’hui par de nombreux historiens. L’auteur revient d’ailleurs sur l’attitude du PCD’I qui ne fait pas grand-chose pour aider matériellement Gramsci, ni pour hâter sa libération. L’attitude de Togliatti est-elle un abandon tactique de Gramsci pour protéger le PCD’I des foudres de Staline ? Pour l’auteur, il est difficile de trancher.
Gramsci reste à Turi jusqu’en 1932. Sa santé se dégrade rapidement mais il refuse de demander sa grâce auprès de Mussolini. Il est ensuite transféré à Civitavecchia puis à Formia, avant d’être conduit, en raison de son état de santé inquiétant, sous le régime de la liberté conditionnelle, à la clinique « Quisisana » (« ici on soigne ») de Rome en juin 1935. Epuisé, Gramsci consacre ses dernières forces à obtenir sa libération, pour pouvoir rentrer en Sardaigne. Elle est obtenue le 25 avril 1937. Il meurt au matin du 27 avril 1937. Incinéré après des funérailles privées, ses cendres sont transférées en 1938 au cimetière des non-catholiques à Rome.
En prison, Gramsci avait obtenu à partir de 1929 la permission d’écrire en cellule. Il reçoit des livres et consacre la presque totalité de son temps à lire et écrire bien qu’il soit gravement malade et souvent à bout de forces. L’administration pénitentiaire lui fournit des cahiers, numérotés et marqués, qui sont tous relus par les services fascistes. C’est sur ce support qu’il rédige son oeuvre la plus célèbre et la plus importante, Les Cahiers de prison. Il ne s’agit pas d’un livre à proprement parler, mais de notes, matériau brut ou réflexions approfondies, sur lesquelles Gramsci revenait constamment. Le caractère fragmentaire de ce travail et le choix de Gramsci de contourner la censure en utilisant l’écriture ésopique, c’est à dire le recours à un langage codé ou métaphorique, ne facilitent pas sa lecture et son interprétation. Il existe 33 cahiers, (un 34ème a peut-être été perdu). Certains contiennent des traductions, les autres sont des notes ou de longs développements . Gramsci livre une réflexion historique sur la société italienne, et il peut enfin faire une analyse très fine du fascisme italien. Il définit le marxisme comme « philosophie de la praxis ». Il souligne qu’en occident la société civile joue un rôle décisif par rapport à la société politique. L’hégémonie idéologique et sociale l’emporte donc en temps normal sur la domination politique et militaire. Il préconise donc une « guerre de position » pour conquérir la société civile, plutôt qu’une guerre de mouvement comme en Russie.
Avec cette biographie très plaisante à lire, J-Y Frétigné atteint le but qu’il s’est fixé en avant-propos, celui de réinscrire la pensée de Gramsci dans le contexte historique de son élaboration. Cette vie de Gramsci donne envie au lecteur d’approfondir sa connaissance de l’oeuvre de ce géant de la pensée. On peut d’ailleurs regretter le choix de l’auteur d’accorder une place peut être un peu trop réduite aux Cahiers de prison. Le lecteur intéressé par cette oeuvre pourra lire avec profit les travaux d’André Tosel, récemment disparu, et notamment son livre Etudier Gramsci, éditions Kimé, Paris, 2016. Il n’en demeure pas moins qu’à l’issue de cette lecture, Gramsci est effectivement, comme l’espérait l’auteur, « un peu moins un inconnu ».