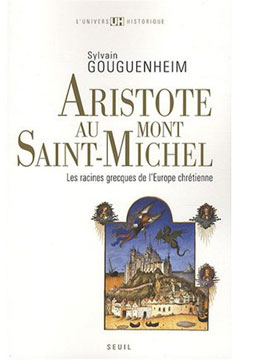
« Aristote au Mont Saint Michel » a soulevé ce printemps une polémique d’une rare virulence dans le champ des études médiévales, mais lorsqu’on termine l‘ouvrage, on s’étonne moins : Sylvain Gouguenheim, professeur d’histoire médiévale à l’ENS de Lyon, y soulève de nombreuses et brûlantes questions qui ne concernent pas qu’une petite corporation érudite, mais aussi tous ceux qui s’intéressent aux rapports, sur la longue durée, entre monde islamique et monde occidental, ou à l’identité de l’Europe, et à ce qu’elle a hérité (ou pas..) de la Grèce et du monde de l’Islam.
Il s’agit avant tout, précise d’emblée Gouguenheim, d’un ouvrage de vulgarisation, qui entend porter au devant du grand public les résultats de la recherche -déjà diffusée parmi les spécialistes, mais jusqu’ici peu médiatisée- sur la transmission et les traductions du grec entre les VIe et XII e siècles. Il s’appuie pour cela sur une abondante bibliographie, en grande partie renouvelée au cours de la dernière décennie, que l’on songe aux ouvrages de Dominique d’Urvoy, ou d’Albert Louis de Prémare.
Dans un premier chapitre, Sylvain Gouguenheim rappelle d’abord des faits bien connus des universitaires : le Moyen Age occidental ne fut pas une période sombre, des « dark ages » suivis par la révélation des auteurs grecs via les traductions faites dans le monde arabo-musulman à l’époque d’un « islam des Lumières », lesquelles traductions auraient ensuite permis l’éclosion de la Renaissance européenne. Non, affirme-t-il : si à ce moment là, « le savoir antique n’est plus disponible que sous forme de compilations », l’Occident médiéval n’a jamais totalement perdu la Grèce de vue : d’abord parce que l’Europe latine fut une terre de présence grecque (notamment en Sicile , en Italie du Sud, à Rome , et même en Catalogne à partir du IXe siècle), puis parce que les élites circulaient (réfugiés de régions conquises par les Arabes en particulier) ; d’autre part, dès l’époque carolingienne, l’intérêt pour la culture grecque se manifeste par la demande de manuscrits : Charles le Chauve, ou les empereurs ottoniens, se piquent d’être à la hauteur de l’empire byzantin, et les multiples « renaissances » intellectuelles auxquelles on assiste alors (carolingienne, ottonienne, ou mouvement culturel de la fin du Xe siècle, renovatio du XIIe siècle préfigurant l’humanisme) manifestent un véritable « philhellénisme », une « quête du savoir et de la science », un « appétit » longtemps sous-estimés dans l’historiographie, estime Gouguenheim, qui insiste à plusieurs reprises sur le caractère « endogène » de ces renaissances.
Pas de dark ages
Parallèlement, un grand mouvement de traduction est lancé, dès le VI e siècle, en Calabre, plus tard au Mont Saint Michel, à Pise, dans l’empire. « La marche en avant de la culture européenne se fit donc les yeux tournés vers le passé antique ».
Sylvain Gouguenheim se penche ensuite sur la survie et la diffusion du savoir grec à Byzance et chez les chrétientés d’Orient. Non seulement Byzance n’a « jamais perdu le fil qui la reliait aux auteurs et aux savants classiques », mais « elle a conservé leur curiosité intellectuelle et leur attitude devant le savoir », à travers par exemple Aréthas de Césarée (Xe), Jean l’Italien (XIe) ou les lettrés entourant l’impératrice Irène (XIIe) ; d’autre part, les chrétiens de langue syriaque (une des branches de l’araméen, parlée sur un très vaste territoire du nord de l’Arabie au sud de la Turquie, et proche à la fois de l’hébreu et de l’arabe), qui utilisaient le grec comme langue de culture et de l’administration, furent un maillon essentiel de la transmission en arabe des textes savants de l’Antiquité grecque. Parmi eux, Hunayn ibn Ishaq (IXe siècle) , le « prince des traducteurs », traducteur de la plupart des œuvres d’Aristote, mais aussi de la médecine grecque, Galien et Hippocrate, fournissant au passage la base du vocabulaire scientifique de la langue arabe : ainsi, la médecine que découvrent avec étonnement les croisés, est la médecine gréco-syriaque. « L’Orient musulman doit presque tout à l’Orient chrétien », conclut SG.
Mais un autre canal de transmission, oublié, ou méconnu du grand public, a existé en Occident, autour du Mont Saint Michel et en particulier du personnage de Jacques de Venise, surnommé « le Grec » et qualifié carrément par S. Gouguenheim de « chaînon manquant dans l’histoire du passage de la philosophie aristotélicienne du monde grec au monde latin » ; si on ne connaît pas grand chose de sa biographie (certains contestent même qu’il ait réellement passé du temps au Mont Saint-Michel), il est clair qu’il a traduit une grande partie des œuvres d’Aristote en latin, autant scientifiques, théologiques que philosophiques. Ces traductions, dont de très nombreuses copies se sont diffusées dans toute l’Europe, serviront de base aux travaux d’Albert le grand et Thomas d’Aquin au XIIIe siècle. Ainsi, au début du XIIe, c’est à dire avant les traductions venues d’Espagne, le Mont, mais aussi Coutances, Chartres, Paris ou Oxford, ont joué un rôle très important.
De son côté, l’islam, estime S Gouguenheim, a surtout opposé de l’indifférence au savoir venu de l’Antiquité gréco-romaine, d’abord préoccupé que celui-ci ne vienne pas contredire l’enseignement coranique, et la passant au « tamis » des autorités religieuses. Même la célèbre et emblématique « maison de la sagesse » de Bagdad, où les religions auraient ouvertement discuté, lui semble bien proche du « conte », et il serait hasardeux, souligne-t-il, de confondre les sciences coraniques (‘ilm), les seules réellement encouragées par les pouvoirs du monde arabo-musulman médiéval, avec les sciences au sens où nous les entendons aujourd’hui ; la médecine musulmane ? reprise aux Grecs, oui, mais par l’entremise des chrétiens du monde arabe ; l’astronomie ? inspirée de celle des grecs, mais avec une fâcheuse tendance à glisser vers l’astrologie divinatoire. Quant à la « falsafa », la philosophie inspirée des penseurs grecs, celle des Avicenne, Averroès ou Al-Farabi, elle reste marginale et n’a une influence qu’éphémère, avant d’être fortement suspectée à partir du IXe siècle. Le grand Averroes lui-même, par exemple, (XIIe siècle) raisonne toujours en plaçant la charia, loi religieuse, au dessus de la philosophie ; ainsi, l’Islam ne connaît qu’une « hellénisation manquée » , et le Coran reste la référence absolue, la mesure de la raison. Aussi, parler d’un « islam des lumières » apparaît comme un anachronisme.
L’Islam indifférent au savoir ?
Dans un dernier chapitre -le plus discutable et dont on espère qu’il sera discuté- Sylvain Gouguenheim défend le concept d’identité des civilisations contre ceux qui, à l’image de Marcel Détienne ( « Comment être autochtone », publié en 2003), pensent que cela n’a pas de sens. Si le concept de civilisation méditerranéenne paraît « peu convaincant », en revanche, parler de racines grecques de l’Occident n’est pas contestable, écrit l’auteur : cet héritage des Grecs se fait surtout à travers « l’élaboration d’une réflexion écrite, argumentée et logique sur la politique, la cité, l’organisation des pouvoirs au sein de la société », mais aussi à travers les mathématiques, « substantiel progrès vers l’abstraction », et « l’esprit critique et l’exercice de l’autocritique » .
Quant au dialogue islamo-chrétien médiéval régulièrement loué, (qu’on songe notamment aux manuels de classe de seconde sur la Méditerranée au XIIe siècle), il relève souvent de l’illusion : c’est la rivalité qui prédomine entre les deux systèmes, exclusifs l’un de l’autre.
Enfin, conclut Gouguenheim, les Européens, au sortir du Moyen-Age, progressent en se libérant d’Aristote, et fondent la science moderne, alors que les falasifa (philosophes) musulmans n’imaginaient pas de le dépasser. En Occident, le logos fut d’abord intégré à la foi, puis prit son indépendance, alors que l’islam, « porteur d’un autre système global », ne pouvait intégrer le savoir grec qu’en le limitant à certains secteurs.
En définitive, si l’image d’un monde islamique médiéval idéalisé, transmetteur généreux d’une culture héritée des Grecs à un Occident resté dans les « âges sombres »,
apparaît bien à remiser aux placards, Sylvain Gouguenheim fait sans doute pencher la balance trop loin dans la direction opposée : une fois le livre refermé, le lecteur risque de se demander avec accablement ce qu’il reste à l’islam. C’est en ce sens qu’il est en droit d’attendre avec grand intérêt un débat, argumenté mais serein, plutôt que des anathèmes amplifiés par les médias, ou d’un « lynchage universitaire » : une saine et passionnante « disputatio » universitaire, en quelque sorte, comme le Moyen-Age aimait les pratiquer.













