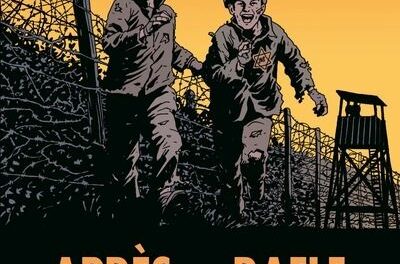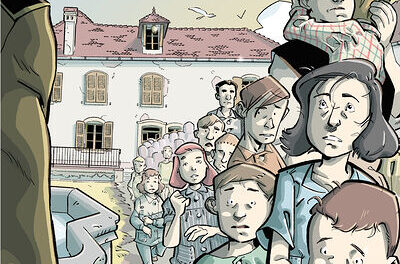Chercheur auprès de la commission d’enquête de la ville de Grenoble sur la spoliation des biens juifs, l’auteur entreprend ici de s’intéresser, non à la politique de Vichy proprement dite mais à son application par les exécutants chargés des services préfectoraux, du maintien de l’ordre ou de la justice.
Il s’agit de comprendre comment, loin des sphères de décision politiques, l’antisémitisme s’applique dans la vie de tous les jours chez ceux qui tamponnent, autorisent ou contrôlent les individus.
En vertu d’une approche relevant de la micro-histoire, l’essentiel du travail présenté est fondé sur l’étude méthodique des archives de l’Isère. L’une des spécificités de ce département est qu’il est d’abord situé en zone « libre » pour ensuite être occupé par les Italiens. Les Allemands se réservent quant à eux les cantons au Nord de Vienne avant d’occuper complètement le département à la suite de l’armistice de septembre 1943. Pour le seul département de l’Isère, les archives d’un service comme celui des Etrangers représentent plusieurs dizaines de milliers de documents pour lesquels l’auteur s’est intéressé aussi bien aux informations recueillies et aux commentaires des fonctionnaires qu’à la genèse des différentes rubriques des formulaires. A la préfecture de l’Isère, comme dans toute préfecture, nombreux sont les services concernés par la politique antisémite, de l’Administration générale, qui contrôle les changements de noms, aux Finances de l’Etat, chargées des « recherches dans l’intérêt du Trésor ». L’appareil administratif a beau avoir servi la République, on s’y accommode bien vite de la mention de la notion de race, vite banalisée par le vocabulaire du travail, même si l’antisémitisme y est noyé dans une foule d’autres instructions. Certes, les sources utilisées ne disent pas tout. Les archives judiciaires, par exemple, ne mentionnent pas la « race ». L’analyse de Tall Bruttman révèle pourtant le critère racial motivant les jugements et les arrestations qui les précèdent.
L’ouvrage se découpe en deux grandes parties. La première est consacrée à la relation qu’entretient l’administration avec le statut des Juifs. L’auteur y revient sur la période qui précède son établissement avant d’étudier sa mise en place. Il s’intéresse ensuite aux codes culturels et professionnels articulés avec le langage administratif. La question antisémite est ensuite vue sous l’angle des sources policières, à travers les formulaires, puis dans son application directe et dans l’organisation de l’information administrative, par exemple l’établissement de fichiers.
Dans la seconde partie, l’auteur s’attache à retracer une routine professionnelle qui passe par l’organisation de rafles (août 1942-février 1943) ou la « mise au travail » de Juifs français. Face à l’occupant, l’administration, doit à certains moments faire des choix qui conduisent certains à livrer plus d’hommes que les Allemands en exigent quand d’autres oublient systématiquement de tamponner les cartes d’identités de la mention « juif ».
L’une des informations les plus surprenantes de cet ouvrage est dans la facilité avec laquelle l’administration met peu à peu en œuvre la législation raciste de Vichy, alors même que l’Etat français s’attendait à des difficultés d’application. L’auteur revient sur le problème de la ligne de démarcation déjà évoqué dans d’autres ouvrages pour l’interdit qui y était signifié aux Juifs, parlementaires et indigènes des colonies. Balbutiante sur ce point précis, l’historiographie s’accordait à établir que les administrations françaises avaient tendance à aligner la composition des convois et trains pour la zone nord sur les exigences allemandes, refusant les indésirables afin d’éviter l’arrêt des trains par l’occupant. Tal Bruttmann reprend les différentes protestations des parlementaires coloniaux en y ajoutant une intéressante lettre de Marcel Peyrouton, ministre de l’Intérieur recommandant aux préfets d’éviter les « juifs », « romanichels » et « sang-mêlé » susceptibles de faire arrêter les convois par les Allemands.
Bien évidemment, l’enseignement n’échappe pas à la politique antisémite. Tel inspecteur de l’enseignement primaire déclare à sa hiérarchie qu’il se sent incapable d’identifier des juifs parmi ses enseignants. Tel autre croit bon de lui faire connaître le « type étranger marqué » d’une enseignante. A la Justice, une circulaire invite à scruter les patronymes en cas de détachement vis-à-vis des pratiques religieuses. Si besoin, elle préconise d’enquêter sur le choix des prénoms des enfants, voire le lieu d’inhumation des membres de la familles.
L’application de la politique antisémite codifie des pratiques administratives existantes. Ainsi, la formule « il m’a été signalé » employée par le sommet de la hiérarchie s’adressant à la base recouvre une pratique connue, laquelle consiste à reprendre dans une circulaire nationale une pratique initiée à l’échelon local et parvenue au sommet via le questionnement de la hiérarchie. La mise en place des fichiers illustre par ailleurs l’efficacité administrative, même si chaque préfecture organise comme elle l’entend la gestion des « Affaires juives ». A la préfecture de l’Isère, on décide ainsi de produire en trois exemplaires les fiches demandées par le ministère, afin de pouvoir conserver trace des individus recensés. 800 personnes y sont fichées en moins de 20 jours, probablement grâce à l’onomastique et à la rumeur publique.
La traque de l’antisémitisme éventuel des fonctionnaires passe par les détails des traces administratives, par exemple par le titre « Monsieur », que certains omettent systématiquement lorsqu’il s’agit de Juifs. De même, la mention de la judéité devient elle un indice d’antisémitisme lorsqu’elle apparaît dans une procédure où elle n’est pas requise, voire lorsqu’elle est répétée plusieurs fois et mise en avant par le rédacteur. Ici, la familiarité de l’auteur avec les séries dépouillées permet d’opérer des distinctions entre fonctionnaires appliquant les circulaires et individus particulièrement zélés à les devancer. L’un des exemples utilisés pour mettre en évidence le phénomène est justement la confrontation de deux rapports très différents concernant la même personne. A cela, il faut ajouter les policiers qui décrètent la judéité d’un individu sans pour autant que celle-ci soit établie par les critères de Vichy. Ailleurs, dans une affaire où deux policiers tentent d’extorquer de l’argent contre des papiers légaux, c’est la victime, pourtant soutenue par un commissaire, qui finit par être poursuivie pour corruption de fonctionnaires. Ostracisés et poursuivis, les Juifs sont par ailleurs victimes de délits et de crimes dont les auteurs sont rarement poursuivis.
En évitant tout anachronisme, le lecteur peut parfois trouver des analogies avec les phénomènes contemporains. Ainsi, une discrimination analogue au phénomène du plafond de verre étudié par les sociologues d’aujourd’hui apparaît à travers les dossiers de candidatures à des postes divers. Les Juifs n’y sont pas forcément estampillés comme tels mais les avis sont toujours moins favorables que pour d’autres candidats.
Les sources policières posent par ailleurs le problème des conditions dans lesquelles elles ont été recueillies. Si l’on admet que la judéité à la première personne ne se conçoit comme appartenance à une « race », on ne peut que relever le caractère improbable de rapports mentionnant des individus avouant qu’ils sont « de race juive ». Sur les conditions des interrogatoires, les témoignages sont rares mais Tal Bruttman cite au moins celui de Léon Poliakov (L’Auberge des Musiciens, 1981).
Autre question soulevée, celle de l’illégalité des Juifs arrêtés ou soumis à contravention. Pour une bonne partie d’entre eux, l’illégalité est le fait même de la politique antisémite qui conduit certains à ne pas se présenter devant les administrations ou à user de moyens illégaux pour survivre alors que leurs moyens de subsistance sont justement contrariés par les lois antisémites. Ainsi, le délit d’exercice illégal de la médecine concerne t-il des médecins empêchés d’exercer par la législation de Vichy. Ce passage de l’ouvrage n’est pas sans rappeler qu’aujourd’hui, l’essentiel des étrangers incarcérés en France le sont pour infraction à la législation sur les étrangers.
Comme on le retrouve dans l’essentiel des écrits sur Vichy, l’administration se montre particulièrement énergique dans son désir de faire respecter ses prérogatives, marques de la souveraineté française. C’est ainsi le cas lorsque les Allemands prétendent visiter des prisons d’où ils souhaitent emmener des détenus juifs. Ce n’est pas la livraison de Juifs mais bien l’absence d’autorisation donnée par la hiérarchie française qui explique les réticences de l’administration pénitentiaire. On ne verra là aucune manœuvre dilatoire puisque, une fois l’autorisation donnée, il arrive qu’on livre davantage d’hommes que ne l’exige l’occupant allemand. A cet égard,, c’est paradoxalement l’occupant italien qui bloque certaines actions, amenant le préfet de l’Isère à contourner le problème en arrêtant en zone allemande, près de Vienne, les Juifs qu’on lui refuse en zone italienne.
Alors que l’opinion publique a pu s’émouvoir du malheur des Juifs lors des rafles de l’été 1942, elle en fait de nouveau des boucs-émissaires au moment du STO. Comme les Alsaciens et les membres de la LVF, les Juifs sont en effet exemptés de recrutement en raison du refus du Reich de les admettre dans une structure travaillant sur le sol allemand. Il n’en faut pas davantage pour que l’opinion leur reproche leur oisiveté aux frais des bons Français.
Reste que l’administration française, si elle a appris à discriminer les Juifs, est confrontée à une nouveauté lorsqu’il s’agit d’aider les Allemands à les déporter. Des rapports révèlent au passage le peu d’illusion que se font certains fonctionnaires sur le sort qui attend les déportés. Il n’empêche que l’essentiel des réticences apparaissant dans les archives concerne avant tout les critiques du non-respect des règles administratives par les Allemands. Paradoxalement, l’administration préfectorale continue de bénéficier d’une image bienveillante, ses propres décisions étant imputées par l’opinion à Vichy ou aux occupants. Le phénomène continue après guerre avec la réputation de « protecteur des juifs » usurpée par le Préfet de l’Isère ou avec la carrière artistique mémorable de son chef de cabinet. Cette situation s’avère d’autant plus étonnante que, même après la libération, l’administration du Trésor et la Justice continuent de demander des comptes aux Juifs condamnés pour des infractions à la législation de Vichy. Ceux qui obtiennent la révision d’une condamnation le doivent à ce que l’administration désigne comme faits de résistance et non à leur statut de victime des persécutions raciales de Vichy.
Dans sa conclusion, l’auteur revient, entre autres, sur le fait que l’administration qui applique la politique de Vichy est celle qui avait jusque là servi la République, ce qui ne l’a pas empêché de sa propre initiative, sans instruction préalable, de faire apparaître la mention de la « race » dans les documents officiels. De toute évidence, faire de chaque fonctionnaire un antisémite déclaré ne serait pas faire œuvre d’histoire. Mais, comme le souligne l’auteur, c’est dans l’utilisation de la marge de manœuvre de chaque individu que s’apprécie l’adhésion des uns et des autres au projet de Vichy.