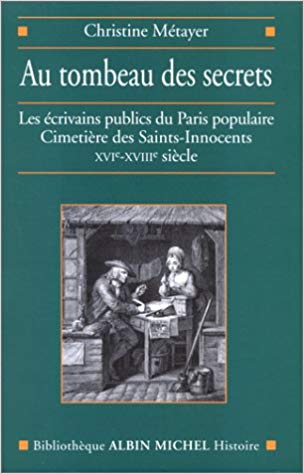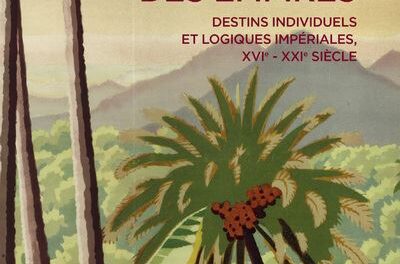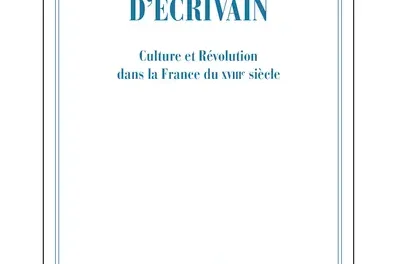Christine Métayer propose une histoire de l’écrivain public, cet intermédiaire qui comble l’écart « entre un besoin accru et diversifié de l’écrit et les capacités d’écriture […] entre une obligation d’écriture toujours plus pressante et l’incapacité technique d’y faire face » (10). Ce métier s’exerçait principalement dans les villes qui furent le lieu de développement de l’écrit, tant au niveau public qu’au niveau privé. L’auteure aborde ainsi les aspects sociaux de l’écriture car elle nous renseigne sur le rapport à l’écrit des plus humbles et donc également sur la culture de ces derniers.
Ces écrivains publics sont connus grâce à un de leurs lieux de travail, le cimetière des Saints-Innocents, au cœur des quartiers populaires de Paris (« à quelques foulées au nord du Palais, sur la rive droite, bornée à l’ouest par la rue Saint-Denis et à l’est par la rue de la Ferronnerie » 28) pour lequel les sources étaient abondantes. Tout l’intérêt de l’ouvrage de Chr. Métayer réside dans l’intégration de cette profession au sein de son contexte si particulier, celui d’un cimetière. Dans cette perspective, le pouvoir de l’écrit ne se dissocie plus de la société dans lequel il se développe. Le cimetière est donc étudié en tant que tel car « l’écrivain des charniers » y travaille. Dans un premier chapitre (23-131), l’auteure s’intéresse particulièrement aux « caractéristiques culturelles et sociales du métier » (20). On trouve des écrivains publics un peu partout, auprès des Grands comme auprès des humbles, logés ou avec des installations portatives. Deux lieux les attirèrent particulièrement, le Palais de Justice et l’enclos du cimetière des Saints-Innocents. Dans le premier, leurs fonctions étaient multiples, par exemple des « copie[s] des minutes de jugements ou d’actes authentiques » pour un avocat (27). Le second bénéficiait de la vie commerciale très active du marché central parisien proche. Il accueillait également des marchands dans « les galeries des charniers »(28).
On pourrait être tenté de qualifier l’écrivain public d’intermédiaire culturel mais pour Chr. Métayer une telle qualification s’applique plus volontiers au notaire. L’écrivain public ne dispose lui pas du même statut social. Il n’est pas un lettré, pas plus qu’un membre des couches populaires. De plus, son activité même requiert un effacement de l’identité de l’écrivain, au profit de celle du client. En cela, il se distingue des maîtres écrivains, les spécialistes de l’art calligraphique, « maître en l’art de l’écriture, & non en l’art d’écrire » selon la formule de Louis-Sébastien Mercier (32). « Alors que la finalité du maître était de reproduire chez son élève sa propre capacité manuscrite et de former des scripteurs autonomes, celle de l’écrivain public était de se substituer provisoirement au non-écrivant. En d’autres termes, les uns étaient chargés de transmettre un art, les autres suppléaient à l’insuffisance de cette transmission » (35). En outre, la tâche de l’écrivain public est anonyme alors que celle du maître doit être dûment identifiée par son nom. Au final, il n’est pas considéré comme un écrivain mais plutôt comme un scribe, un copiste, au mieux un secrétaire (43-44). Il est jugé en fonction de sa clientèle. Toutefois, si l’on analyse son rôle et non ses clients, c’est une autre image qui apparaît.
En effet, c’est la diversité de leurs aptitudes qui frappe : « Traductions, créations calligraphiques, pièces d’orthographe et de composition, placets, mémoires » (48). Les écrivains publics rédigeaient des lettres d’amour, ce qui fut l’objet de nombreuses railleries. Ils écrivaient au roi, aux grands officiers pour demander l’émission de lettres de cachet, une faveur… Cela supposait de la part du client une parfaite confiance à l’égard de l’écrivain public car ce dernier devenait dépositaire de secrets. Mais cela ne signifie pas que le client soit analphabète. Ce dernier recherche « la justesse de l’énoncé » (58). Dès lors, « le rôle du scribe dépassait largement la seule capacité technique, il était de formulation, de rédaction. Dans un monde soumis à l’impératif scripturaire, cette mise en situation démontre la conscience vive, même chez ceux qui ne participaient pas des cultures lettrées, de devoir produire un écrit qui pût jouer sur l’exactitude de son registre afin d’entraîner l’effet désiré » (59).
En bref, la meilleure façon de décrire les écrivains publics consiste à les classer parmi les figures du pavé parisien, comme « des professionnels de la rue » exerçant un « humble métier [, un] métier des humbles » (124 et 126).
Dans un deuxième chapitre, Chr. Métayer l’espace dans lequel les écrivains publics qu’elle étudie évolue, les charniers du cimetière des Saints-Innocents (133-196). Il s’agissait d’un lieu très animé, d’un lieu de vie comportant des habitations et des boutiques, ce qui n’a rien de surprenant pendant l’Ancien Régime. L’animation provenait également de la proximité avec les Halles, le grand marché parisien depuis le XIIe s. Des étals y étaient installés et des galeries couvertes favorisaient l’installation de commerces. Les boutiques, à l’équipement intérieur rudimentaire, étaient louées par le chapitre (148-149). Pour une somme modique, il était possible d’obtenir un simple emplacement. Certains bâtiments étaient spécifiquement réservés aux activités d’écriture si l’on en croit les baux. Outre cette fonction commerciale, il faut noter la fonction résidentielle de l’espace qui accueillait des familles (« chambres avec vue… sur les fosses communes » 155-164). « Les gens des charniers » constituaient une véritable communauté. On s’y saluait, on s’y interpellait, on y discutait, on s’y disputait, on s’y entraidait…
De façon générale, ce sont les activités profanes qui l’emportent ; parmi elles, celle des écrivains publics dont la présence est remarquée, ce qui constitue l’objet du troisième chapitre (197-257). Dans la continuité des dispositions tridentines, les chanoines du chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois ont cherché à rendre aux morts le cimetière des Saints-Innocents mais sans jamais y parvenir. L’exploitation commerciale de la nécropole ne cessa qu’à la fin du XVIIIe s. lorsque cette dernière fut transférée à Montrouge. Pour les autorités ecclésiastiques, « l’écrivain des charniers » représentait le désordre. « Le scribe s’impose ainsi à l’histoire comme l’acteur qui rend pleinement compte à la fois de la ténacité des occupants à jouir de la nécropole, de l’échec du projet ecclésiastique de les expulser, et de la configuration de cet espace disputé qui s’affirma à l’issue de l’affrontement » (200).
Mais les chanoines ne parvinrent jamais à leurs fins, expulser les activités profanes de la nécropole et au cours du XVIIIe s. ils préfèrent en tirer parti. Une fonction de gardien de nuit fut créée et elle était exercée par un commerçant ce qui permettait à ce dernier un logement gratuit et un revenu d’appoint non négligeable. L’installation des commerçants est désormais perçu par le chapitre comme un problème d’aménagement et de gestion, et non plus comme un trouble. L’écrivain public y trouve une certaine considération. Désormais, il est accepté dans la nécropole. La mémoire de cet espace, après sa destruction en 1780 suite à un arrêt du Parlement de Paris pris dans le contexte d’une prise de conscience des problèmes d’insalubrité (243-247), correspond à cette nouvelle image, « de pieuses arcades, une foule marchande et, se démarquant de celle-ci, des scribes repérés telle la figure emblématique de la nécropole au XVIIIe s. » (242), « le personnage phare » écrit-elle plus loin (254).
Il reste alors à réfléchir sur l’insertion sociale des écrivains des charniers, sujet du quatrième chapitre (259-311). Comme les autres membres de la communauté, l’écrivain public n’hésitait pas à prendre part aux faits divers qui se déroulaient dans la nécropole. De même, il était sous le regard des autres. Toutefois, il pensait avoir une position supérieure aux autres, bien que ce sentiment n’ait pas de réalité en dehors du cimetière, en dehors de la communauté et de l’intégration qu’elle offrait. À l’intérieur de cet espace, le groupe des scribes fonctionnait comme une corporation avec « d’implicites et tacites lignes de conduite » (268). L’insertion dans la communauté se faisait par l’intermédiaire du groupe familial ainsi que par la formation d’un réseau avec d’autres professions, comme celle des imagiers. L’auteure insiste sur l’importance du groupe d’écrivains publics, sur la dimension collective de l’activité. Pour autant, la concurrence les amenait parfois à des actes violents (une main mordue par exemple 300).
Dans sa conclusion, Chr. Métayer en appelle à une véritable l’histoire sociale des gestes d’écriture (313-318). L’identité du citadin doit être approchée par la généralisation de l’écrit. Au fond, il s’agit avant tout de faire une histoire des usages de l’écriture qui sont des usages sociaux (315). Cela est particulièrement vrai dans le cas des écrivain public. En effet, ce dernier offre un service à autrui. En outre, il dispose d’une place particulière dans la société, en lien avec sa clientèle, qu’il ne faut pas confondre avec celles des autres manieurs d’écrits que sont les fonctionnaires, les écrivains proprement dit… Cet ouvrage n’est donc encore qu' »un préambule à l’étude du geste d’écriture de l’écrivain public » (318). L’histoire du rapport à l’écrit du scribe et des milieux populaires reste à écrire, avec la connaissance désormais de la réalité sociale dans laquelle ils évoluaient.
En retraçant la figure de l’écrivain public des charniers, Chr. Métayer nous offre plus que la description d’une profession. Dans un style agréable, elle décrit avant tout un espace, le cimetière des Saints-Innocents. Micro-histoire donc mais aussi histoire totale puisque toutes les dimensions sont prises en considération et ce grâce à une connaissance approfondie des sources, abondamment citées par ailleurs, et des différents travaux sur l’histoire de l’écriture au premier rang desquels il faut placer ceux d’Arm. Petrucci et de R. Chartier. Cette lecture invite le lecteur à mener une réflexion plus globale sur le pouvoir de l’écriture dans une société alphabétisée pour partie. On ne saurait se contenter du seul taux d’alphabétisation. « La seule existence du scribe public dit avec quelle efficacité la valeur de la lettre pénétrait toutes les couches de la société, même celles où l’écriture n’était pas une réalité quotidienne. Si la pratique n’était pas assimilée, le poids de l’écrit l’était en revanche parfaitement » (55). Cette somme est donc une pierre importante d’un édifice qui reste encore à écrire, une anthropologie de l’écriture dans les sociétés préindustrielles.