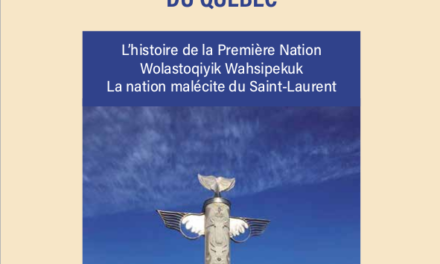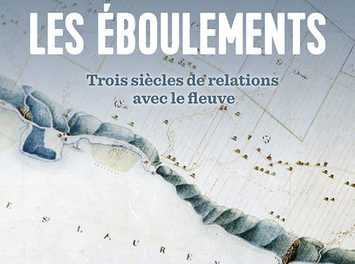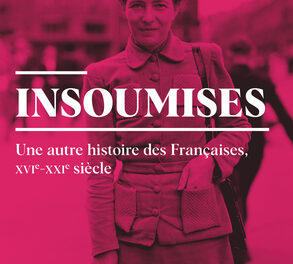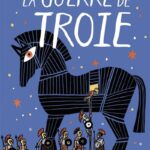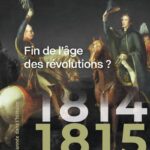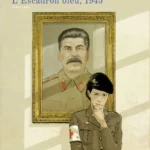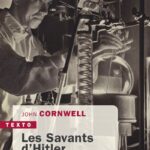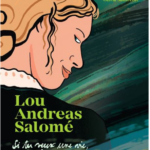Le dossier de ce nouveau numéro de la Revue d’histoire de la Nouvelle-FranceN° 1 : Partir en Nouvelle-France – N° 2 : Magie et sorcellerie en Nouvelle-France – N° 3 : A la conquête des âmes traite d’un sujet encore imparfaitement connu, car longtemps passé sous silence : le premier esclave noir Olivier Le JeuneIl s’agit d’un enfant de six ans au service de David Kirke , en 1629 représente en fait un groupe minoritaire jusqu’à la fin du XVIIe siècle. La majorité des esclaves sont des autochtones, les « Panis », le plus souvent capturés pendant les guerres et vendus entre nations autochtones ou à des marchands européens.
Le dossier, sans prétention à l’exhaustivité, met en lumière des travaux récents menés par Dominique Deslandres, historienne québécoise, professeure titulaire à l’Université de Montréal et ses étudiantes.
Briser les chaînes de l’oubli
Cet entretien avec Dominique Deslandres montre le cheminement de la chercheuse pour rappeler que l’esclavage est une réalité de la Nouvelle-France, comme l’avait déjà montré Marcel TrudelDeux siècles d’esclavage au Québec, Marcel Trudel, Biblothèque québécoise, 2021, Nouvelle édition dès les années 1960, puis Franck MackeyL’esclavage et les Noirs à Montréal 1760-1840, Frank Mackey, Montréal, Canada, Ed. Hurtubise, Cahier du Québec, 2013 et Brett Rushforth. L’historienne veut montrer que contrairement au mythe d’un esclavage doux, la réalité était plus violente. Si l’esclavage s’inscrit dans une chaîne de servitudes de type familial patriarcal dans la société d’ordre, les travaux confiés aux esclaves sont les plus durs, ils sont un élément du patrimoine économique. L’étude des familles des marchands montréalais montre que quand on achète des esclaves autochtones, on s’enrichit.
Dominique Deslandres décrit ses outils de travail : le logiciel Transkribus qui permet la numérisation, la transcription automatique des écritures manuscrites dans tous les documents originaux, dans les archives judiciaires, notariales et paroissiales du XVIIe siècle, ainsi qu’un outil de géolocalisation historique du bâti montréalais ADHEMAR. Il s’agit d’une histoire quantitative, visant à évaluer l’ampleur du phénomène et son évolution. Les travaux cherchent aussi à redonner une identité, une voix à ces esclavesVoix des esclaves et des esclavagistes, paru en 2019 dans Les Cahiers des Dix) – Intimes ennemis, paru en 2023 dans Les Cahiers des Dix qui traite des enfants esclaves à Montréal au XVIIe siècle.
Être asservi en Nouvelle-France
Sans doute pas de mouvements collectifs, mais des actions individuelles, de formes très différentes (bris d’équipement, rébellion armée ou fuite). Pour analyser ce phénomène, l’historienne Catherine Lampron, doctorante en histoire à l’Université de Sherbrooke, dispose des archives judiciaires et des archives notariales. Son travail porte sur Montréal et Québec et Trois-Rivières, pour la période 1700 – 1760.
Cinq études de cas : Marie-Josèphe-Angélique, Marie-Manon, Jean-Baptiste Thomas, Jacques et Marie mettent en lumière la capacité d’autonomie et de décision des personnes.
L’incendiaire Marie-Josèphe-Angélique, une esclave noire, a d’abord tenté de fuir craignant d’être envoyée aux Antilles avant d’être accusée d’avoir mis le feu dans le grenier de la maison de sa maîtresse.
Marie Manon, qui est autochtone, témoigne contre Marie-Josèphe-Angélique, en 1734. En 1750, elle est, à son tour, accusée de vol, son autonomie s’exerce dans la consommation d’alcool, pourtant prohibée.
On retrouve l’alcool et le vol dans les griefs contre Jean-Baptiste Thomas. Jacques, est le seul fuyard. Arrivé en esclavage à cinq ans, il en a 30 lors de sa fuite vers les zones de traite des fourrures, puis il tente de se réinsérer parmi les Micsmacs d’Acadie.
Enfin Marie, elle aussi autochtone, a agressé sa maîtresse avant de tenter de se suicider.
Les exemples présentés attestent d’une certaine autonomie dans une vie contrainte et de crainte de la violence des maîtres.
Des vies oubliées : un regard critique sur le Dictionnaire des esclaves
Dans sa contribution, Cathie-Anne Dupuis, doctorante en histoire de l’Université de Montréal, montre l’intérêt et les limites du Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires au Canada français de Marcel Trudel.
Elle présente la Base de données de la population esclave du Québec ancien (BDPEQA) qu’elle a mise au point entre 2018 et 2020. Une nouvelle base de données Registre de population servile en Amérique du Nord-Est (RPSANE) permet de corriger des inexactitudes sur l’âge, l’ethnie, le nom et le sexe et débusquer les doublons. Les compléments apportés permettent de reconstituer leurs parcours de vie.
L’ordonnance de Raudot (1709) a légitimé la mise en esclavage d’autochtones pour les besoins de la colonie.
L’exemple détaillé de Marie, une Panise montre le travail de révision du dictionnaire.
La carte des esclaves
Catherine Lampron évoque, dans un entretien avec Sylvain Lumbroso, l’apport des SIG dans la connaissance de la vie des esclaves. On peut y lire à la fois la résidence et la mobilité dans et hors de la ville. Les hommes, plus que les femmes, sont envoyés à la campagne pour les travaux des champs.
Au-delà des SIG, Catherine Lampron montre combien les archives numérisées et consultables à distance sont des outils précieux pour les chercheurs.
Enfant et esclave à Montréal
Dominique Deslandres s’intéresse à un champ de la recherche encore inexploré celui du sort des enfants. 735 autochtones, esclaves, âgés de 4 à 12 ans sont recensés dans les archives entre 1632 et 1760. Qui sont-ils ? Cadeaux d’esclaves entre alliés français et autochtones ?
Jacques Cartier, dès 1535, se voit offrir, par les Amérindiens, des enfants. En 1632, Olivier Le Jeune, africain âgé d’environ 6 ans, est vendu par l’un des frères Kirke au commis Le Baillif pour 50 écus. On a ainsi dans les archives la trace de ces enfants réduits en esclavage, donnés, vendus, nés d’une femme esclave. L’esclavage des enfants n’est pas marginal, « 734 esclaves sur les 1574 dont nous connaissons l’âge ont moins de 12 ans, à leur dernière mention dans les registres paroissiaux. La mise en esclavage des enfants révèle un véritable phénomène de société qui remet en question les fondements moraux, sociaux et économiques de la colonie. »citation p. 45.
L’autrice s’interroge sur les motifs : une pratique patriarcale pour façonner une main-d’œuvre docile puisque élevée dans la culture occidentale ; Un moyen de compenser la mortalité infantile de la famille ; S’assurer un moyen de cultiver sa terre dans la vieillesse ?
Ces enfants sont employés comme domestiques, dans la maison comme pour les travaux agricoles. L’autrice note également des cas d’adoption ou d’affranchissement.
Les citoyens au secours de la science
Dans ces entrevues croisées avec Webster et Émilie Monnet, il est question de littératurePropos recueillis par Félix Ouelle.
Webster explique comment son intérêt pour l’histoire de la diaspora africaine l’a amené à un roman : Le Grain de sable, Olivier Le Jeune, premier esclave au CanadaPublié en 2019, aux Éditions du septentrion. Émilie MonnetActrice, auteure et metteuse en scène aux origines anichinabée et française explique sa pièce Marguerite : le feuEd. Les herbes rouges, 2023, inspirée de l’histoire de Marguerite Duplessis, une esclave autochtone qui s’est battue en cour pour sa liberté. Émilie Monnet évoque les raisons de son combat pour la défense des femmes autochtones.
Mémoire et pouvoir des danses africaines au XVIIe siècle dans les Petites Antilles françaises
Astrid Giraul, chargée de cours et doctorante en histoire de l’Université de Montréal, nous entraîne dans un autre territoire d’esclavage. Elle montre combien les observateurs de l’époque, Jean-Baptiste LabatNouveau voyage aux îles de l’Amérique, 1722 et Jean-Baptiste Du TertreHistoire générale des Antilles habitées par les Français, 1667 n’ont pas perçu l’importance sociale et spirituelle des danses des esclaves. Bien qu’originaires de diverses régions, un fond commun s’exprime dans ces danses, comme le calenda. On les retrouve aujourd’hui, notamment en Haïti. Les mouvements, le contact des danseurs qui choquaient les autorités, ont vocation à entrer en relation avec les divinités. Les danses ont une dimension religieuse et permettent une expression qui échappe aux maîtres et aux missionnaires. L’autrice constate que malgré le mélange des origines, les spécificités de chaque peuple ont pu perdurer et résister à la christianisation.
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage (en France) présente son action pour parler d’esclavage, et notamment l’exposition récente Oser la liberté (9 nov. 2023-11 fev. 2024).
Le dossier se termine par un entretien avec Aïssata Seck, la nouvelle directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavagePropos recueillis par Laurent Veyssière.
Les autres articles de la revue
Un record pour Champlain, Éric Thierry présente la vente exceptionnelle, chez Christie’s à New York – le 17 janvier dernier, d’un exemplaire des Voyages de 1613 de Samuel de Champlain pour la somme de 1 320 500 $. Ce goût pour les traces de la Nouvelle-France apparaît également dans un court texte de SylvainLumbroso : Quand la Nouvelle-France fait monter les enchères (p. 11)
Les Autochtones de la Nouvelle-France ont-ils inspiré les Lumières ? Martin Lavallée se fait l’écho d’un débat initié par le livre de David Wengrow et David Graeber, Au commencement était… – Une nouvelle histoire de l’humanité, publié en 2021Aux Etats-Unis et en France, aux éditions Les Liens qui libèrent qui propose une nouvelle histoire du monde. Les auteurs revisitent les origines des inégalités et l’émergence de l’État. Ainsi, les idéaux de liberté, d’égalité et de démocratie défendus par les philosophes des Lumières auraient été inspirés par la critique de la civilisation européenne par les Autochtones de la Nouvelle-FranceCritiques rapportées par les missionnaires : les Relations des Jésuites, Le Grand Voyage du pays des Hurons du récollet Gabriel Sagard, Dialogues avec un Sauvage, du baron de Lahontan. Ces textes auraient influencé Voltaire, John Locke ou Jean-Jacques Rousseau..
Martin Lavallée présente les travaux récents d’Emma Anderson, historienne des religions et professeure à l’Université d’Ottawa, qui étudie la critique autochtone et son influence sur l’évolution des sociétés occidentales, notamment des éléments de la pensée autochtone comme une relative égalité entre les sexes, l’importance de la communauté ou la gouvernance par consensus. Stéphane Van Damme, professeur d’histoire moderne à l’ENS de Paris, est plus nuancé. Il replace les écrits de Lahontan, notamment, dans le conflit religieux français et l’influence des protestants dans la description de la civilisation autochtone.
Autre pièce à mettre au débat, un article de l’historien et sociologue Denys DelâgeSpécialiste de l’histoire des Autochtones, de l’Université Laval, daté de 1992, rappelait que Rousseau fut l’élève du père Charlevoix qui avait été professeur au collège des Jésuites de Québec. Selon Delâge, Rousseau se serait inspiré des récits sur les mœurs amérindiennes pour écrire le Discours sur l’origine de l’inégalité et L’Émile.
Le débat reste ouvert.
La Nouvelle-France de Dave Noël, interview par Martin Lavallée à propos de son dernier ouvrage consacré à Michel Chartier de Lotbinière.
Frances Brooke et la postérité littéraire de l’ermite Toussaint Cartier ; Claude La Charité, professeur à l’Université du Québec à Rimouski, évoque le succès de la fiction littéraire pour un personnage peu connu.
La main de Québec dans la fondation de New York en 1624. Eric Thierry évoque un document retrouvé dans les archives de l’Amirauté de France qui éclaire la fondation de New York. Guillaume de Caen et Samuel de Champlain sont les commanditaires, en 1623, d’une expédition vers le pays des Iroquois : La Garde de Dieu qui a quitté Dieppe au début du printemps 1624 aurait donc précédé de deux jours, dans la baie de la future New-York, le navire néerlandais le Nieu Nederlandt.
D’« orphelines en France » à « mères de la nation », la trajectoire commémorative des filles du roi.
L’historienne Marie-Eve Ouellet analyse le cycle de commémorations autour du 350e anniversaire des « contingents » de filles du roi arrivés dans la colonie entre 1663 et 1673. Durant cette période, environ 800 femmes qui ont été envoyées en Nouvelle-France pour résorber le déséquilibre des sexes et le déficit démographique de la colonie. La visibilité des « filles du Roy » est assez récentePremière plaque commémorative sur la place Royale à Québec en 1999. Le 350e anniversaire de l’arrivée des premières filles du roi, en 2013, a ouvert à des commémorations et à des études principalement par la Société d’histoire des Filles du RoyCinq ouvrages furent publiés au éditions Septentrion entre 2017 et 2022 : Les Filles du Roy pionnières de Montréal ( 2017), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de La Prairie (2019), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de Repentigny (2021), Les Filles du Roy – pionnières des seigneuries de Varennes et de Verchères (2022), Les Filles du Roy pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud (2022).. Leur commémoration en fait les « mères de la nation québécoise ». Elles ont sans doute contribué à faire du français la langue commune. Près de la moitié des filles du roi venait de la région parisienne alors que les migrants étaient issus de provinces où le français n’était pas la principale langue d’usage.
Un numéro riche de cette revue plutôt récente.