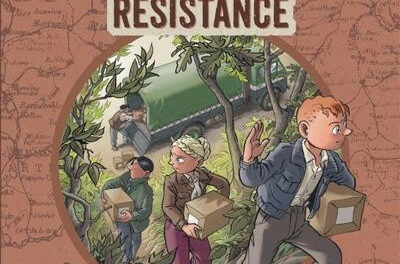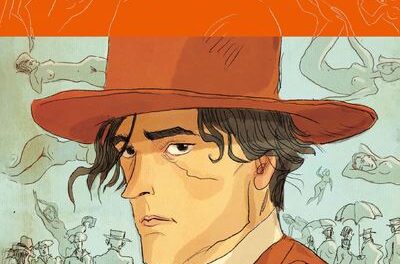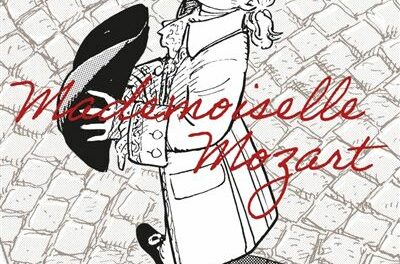Pour celles et ceux qui avaient apprécié le volume 1, Baru offre aujourd’hui le deuxième opus de « Bella Ciao ». Il propose une évocation des ouvriers italiens et de leur famille immigrés en Lorraine.
Un livre, un projet, une histoire
L’auteur a opté pour un mode narratif, non linéaire, un peu comme une mémoire qui chemine parfois d’une époque à une autre. Ce deuxième volume propose donc cinq nouvelles histoires comme autant de souvenirs réactivés à l’occasion d’une communion. Ces récits très différents entremêlent histoire intime, histoire de l’Italie et de la France.
Camicia Rossa
Téodorico Martini, le narrateur, continue donc son évocation du roman familial au gré de ses souvenirs. Il évoque d’abord la légion Garibaldi, ces Italiens qui en 1914 sont venus se battre aux côtés de la France. On les suit à leur arrivée à Paris où ils rencontrent Dante Baldoni, arrivé lui en France en 1870. La légion Garibaldi connut comme les autres troupes de nombreux morts lors d’attaques sur le front. On quitte ensuite cette époque pour découvrir celui qui est devenu un grand-père. Il reprend alors le récit de sa vie, à partir de 14 ans, lorsqu’il travaillait dans un moulin à papier. Même si sa guerre s’est terminée en 1915, c’est aux côtés de la France qu’il s’est battu.
Claudio Villa versus les chaussettes noires
Le récit bascule le jour de la communion de Téodorico. Les femmes sont à l’église et les hommes au café. En ce jour de fête, son père est appelé pour une urgence à la mine. Quant à son grand-père, Téo éprouve pour lui une grande tendresse, même si ce dernier se caractérisait par son caractère asocial. Baru intervient alors dans le récit en expliquant que, dès les années 80, l’histoire de son père apparaissait en filigrane dans un de ses albums. Il est frappé par le soin qu’a toujours eu cet homme à être toujours très propre, malgré un métier salissant. L’auteur évoque ses années de jeunesse. De façon classique, on voit combien la musique pouvait opposer les générations entre les tenants de Claudio Villa, les adultes, et ceux des Chaussettes Noires, les adolescents.
Mortadelle
On retrouve dans cette histoire l’époque du fascisme. Dans sa famille, Corvo Amedeo, résistant, a deux de ses frères qui s’affichent du côté du Duce. On voit l’attitude de l’un d’eux, Maurizio, qui dénonça certains résistants aux nazis. Au-delà du cas raconté, on oscille entre cette époque et celle de la communion. On mesure combien cette histoire douloureuse resurgit et peut enflammer les discussions familiales.
Saint lundi
Le récit se poursuit par l’évocation d’une tradition touchante : le saint lundi. Ne voyez nulle connotation religieuse dans cette expression. Elle désigne, en réalité, la fête qui continue le dimanche soir très tard dans la nuit. Téo confesse qu’il tombait parfois le lundi matin sur ses parents qui rentraient d’une fête alors que lui s’apprêtait à partir en classe. Il raconte surtout l’ambiance des fêtes qui réunissaient la famille.
Ritorno
Cette dernière histoire parle de deux trajectoires mais, à travers elles, c’est le destin de nombreux immigrés italiens que l’on lit. Installé en France, Pasquale Peci envoyait la moitié de sa paye dans son pays d’origine. Pour cela, il rognait sur la moindre de ses dépenses. Il était persuadé qu’il rentrerait un jour en Italie. On le voyait partir en vélo comme s’il rentrait définitivement avant de finalement revenir au petit matin. Mais, un jour, il ne rentra pas : on le retrouva mort à quelques mètres de son véhicule. Le récit se poursuit avec Antonio Girardi qui, en 1950, après la mort de sa femme, s’installa à proximité du village de Pont-de-Roide. C’est sa fille qui narre l’histoire de ce père qui incarne un autre exemple d’un Italien qui n’est jamais retourné au pays.
Comme dans le premier opus, tout se termine en cuisine avec cette fois la vraie recette du tiramisu. Ce deuxième volume d’une trilogie annoncée poursuit donc son exploration sensible du destin d’hommes et de femmes qui ont un jour quitté leur pays pour s’installer en France.