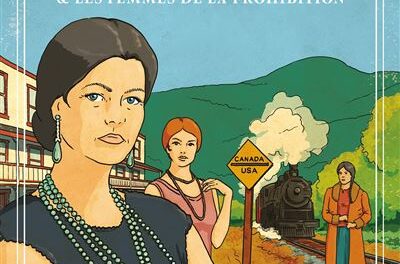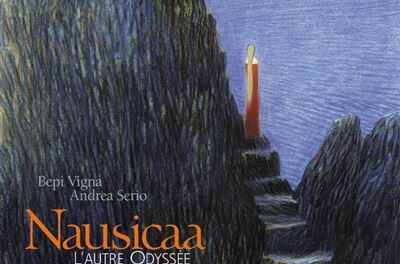Avec ce tome s’achève une série commencée en mars 2016, qui est une adaptation de l’ouvrage de Patrick Rambaud, Il neigeait (Grasset,2000)Les trois auteurs avaient déjà collaboré pour l’adaptation d’un autre roman de P. Rambaud, La Bataille, notamment couronné par le Goncourt 1997.

Le récit est celui de la campagne de Russie, puissamment évoquée dans les pages de Guerre et paix, de Léon Tolstoï, auxquelles on pense immanquablement. Les auteurs avaient restitué la marche sur Moscou (tome 1), à partir de juin 1812, mise à feu sitôt que les armées napoléoniennes s’y soient réfugiées (sept. 1812). La ville flambée, elles n’ont eu d’autre choix que de repartir sur les routes à la mi-octobre. Mais c’était pour affronter l’hiver qui s’installe et le harcèlement des groupes de cavaliers russes très mobiles (tome 2), entre autres fléaux.
Avec ce dernier volume s’exécute le dernier mouvement de la tragédie, en façon de piège qui se referme irrémédiablement, le point principal du récit étant, comme on pouvait s’y attendre, constitué par le passage de la Bérézina (25 novembre 1812). On retrouve l’histoire à partir de la mi-novembre, quelque part entre Smolensk et Krasnoïark.
Pour suivre les événements, le lecteur suit deux parcours parallèles : celui de Napoléon, et celui de certains de ses hommes. Les auteurs croisent ainsi deux échelles d’observation, et cette approche par en-haut et par en-bas permet d’avoir un regard nuancé sur les faits. Avec Napoléon et son entourage, on a des informations sur les mouvements de ses corps d’armée et ceux des Russes, ainsi que sur les contraintes qui pèsent sur les choix stratégiques qui sont faits (ou imposés par les événements). On a également un écho des répercussions politiques à Paris, avec le coup d’État du général Malet (22 au 23 oct.), élément qui amène Napoléon à revenir : on note au passage la lenteur des communications, puisque le conseil de guerre au cours duquel la décision est prise date du 5 décembreRien n’est dit de la désertion de Murat, qui se voit chargé de la conduite de la Grande Armée après le départ de Napoléon, pour aller protéger son royaume de Naples.. Au cours du voyage, les difficultés à obtenir le changement de chevaux dans un relais de poste allemand, entre Erfurt et Francfort (p. 56 et suiv.) permet de mesurer le sentiment anti-français qui se développe, mais sans qu’il puisse être généralisé.
En contrepoint, on suit plusieurs personnages. Il y a là un capitaine des dragons de la garde impériale, manchot, et son fidèle Paulin, un petit groupe de comédiens, etc. Un autre, M. Roques, fait un trait d’union entre ce groupe et l’entourage de Napoléon, puisqu’on le trouve entre les deux. Ceux-là permettent aux auteurs de rendre plus sensibles les vicissitudes que traverse les débris de la Grande Armée, « maintenant troupeau » (p. 4Extrait de «L’Expiation», de Victor Hugo (Les Châtiments).). Le froid intense (les températures sont indiquées très scrupuleusement), la faim (montrée notamment par une scène de cannibalisme, p. 26, ou les vols de victuailles entre Français), la perte des chevaux, la rupture des passages sur les cours d’eau, sans compter les attaques des cavaliers russes (rassemblés sous le terme générique de « cosaques»). Les dessins ne manquent pas de cadavres gelés, ou de demi-cadavres, vivants pas tout à fait morts, mais qu’on dépouille de leurs effets.
Les auteurs auront pu se contenter de raconter des faits, en les accumulant dans une chronologie savante : c’eut été prendre le risque de rendre le récit fastidieux. Au contraire, les va-et-vient très fréquents entre les deux échelles donnent un rythme qui entretient l’attention du lecteur. Cela suppose une certaine agilité, malgré les indications, pour bien comprendre que l’armée napoléonienne ne forme pas un tout compact, alors que différents corps d’armée sont détachés du groupe principal.
Pris par l’histoire, la tendance à perdre ses repères géographiques est grande : il faut avoir une carte pour suivre les péripéties. Mais elle nous est apporté en fin de volume (p. 68-69). Ce qui est étonnant est que dès la première page, avec l’indication de Smolensk et Krasnoïark et de la température (- 25° C) et de celles qui suivent, on se rappelle le graphique dressé par l’ingénieur des Ponts et Chaussées Minard, en 1869footnote]On l’avait évoqué à l’occasion d’un article dur le logiciel de traitement statistique R, en 2014, avec le travail réalisé par [Yves Agostinho->http://www.yvesago.net/pourquoi/2014/03/r-la-campagne-de-russie-par-minard.html.[/footnote]. À une carte géographique, on avait l’itinéraire de l’armée impériale, dont l’épaisseur du tracé était proportionnel aux effectifs disponibles ; en regard, un graphique chronologique rendait compte de l’évolution des températures. Un œil averti saura déceler la différence entre les mentions de températures données dans le corps de l’histoire et celles du graphique, données en degrés Réaumur.
Le récit et les dessins d’Ivan Gil s’appuient avec une parfaite coïncidence sur des références culturelles particulièrement pertinentes. À la scène d’anthropophagie répondent des passages terribles de la Bible (p. 27), plus précisément du « Livre de Jérémie » (19, 9) et du «Lévitique» (26, 23-24), qui, replacés dans le contexte de la retraite de Russie, les rendent ainsi prophétiques. Des extraits de «L’Expiation», tiré des Châtiments de Victor Hugo, sont disséminés au début de l’histoire comme une sorte de fil conducteur ; l’ensemble du poème est donné à la fin du volume (p. 70). Enfin, c’est avec une adaptation d’un autre texte du même auteur que se ferme le récit «Bêtise de la guerre» (L’Année terrible, 1872., qui achève de restituer l’absurdité de la campagne de Russie.
A-t-on besoin d’ajouter toute la satisfaction que l’on prend à lire Bérézina ?…
–