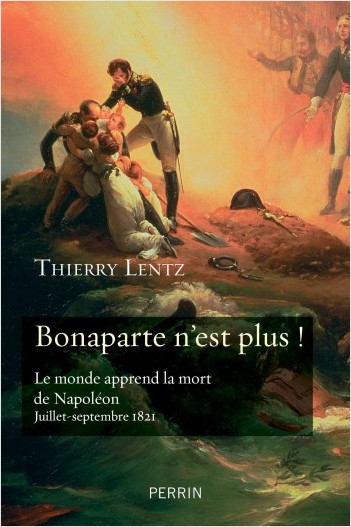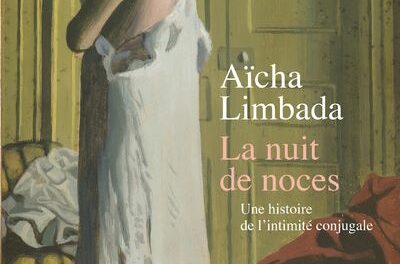On ne présente plus Thierry Lentz, directeur de la fondation Napoléon et auteur de nombreux ouvrages sur l’Empereur. L’auteur a publié 15 tomes sur la correspondance de Napoléon Bonaparte. Son étude sur Joseph Bonaparte a été récompensée par le prix Chateaubriand. Thierry Lentz est lauréat de l’Académie des sciences morales et politiques pour l’ensemble de son œuvre.
Aujourd’hui la mort de célébrités entraîne de multiples réactions, en général mémorielles. Fin 2018, la France a connu des manifestations de tristesse bien plus médiatisées pour un chanteur de rock que pour un académicien de renom. Les médias créent une proximité du spectateur avec le deuil de la famille. A l’époque napoléonienne, les informations ne circulent qu’au rythme de la marine à voile ou à la vitesse d’un coursier à cheval. Il faut ensuite compter sur le bouche à oreille ou sur l’action des crieurs publics à condition que l’administration les missionne. Dans ce livre, Thierry Lentz, s’est interrogé sur les réactions suscitées par la mort de Napoléon dans le monde qui se souciait de son sort. Il choisit les limites temporelles du 5 mai 1821 jusqu’en septembre de la même année, moment où tous ses compagnons reviennent d’exil et dissipent certaines incertitudes. Il s’agit de se placer au plus près des contemporains de l’événement en feignant de ne pas connaître la suite. L’auteur ajoute à la fin de l’ouvrage quelques documents sur lesquels il s’est appuyé.
Depuis des semaines, Napoléon sent que la fin est proche. Le 11 avril 1821, il dicte son testament au général Montholon avant de le recopier de sa main. Les jours suivants sont ajoutés des codicilles. Depuis six ans, celui que les Anglais refusent d’appeler Empereur mais le général Bonaparte, est retenu prisonnier à Longwood Old House (une bicoque secondaire posée à côté d’une confortable maison construite pour le captif mais qui a refusé d’y loger car entourée d’une grille qui équivalait à une prison) sur l’île de sainte-Hélène dans le Pacifique sud, sous la surveillance du gouverneur et lieutenant général anglais Sir Hudson Lowe.
L’empereur demande à être autopsié et à être enterré sur les bords de la Seine, sinon à l’endroit de l’île appelé « le val du géranium », baptisé ensuite « la vallée de la Tombe ». Par une belle journée ensoleillée, à 17h49, « le plus puissant souffle qui jamais anima l’argile humaine » selon Chateaubriand, s’éteint. Le gouverneur Lowe l’apprend à 18 heures et le note sur le billet reçu : « Napoléon Bonaparte » ainsi qu’on devait l’appeler a cessé de vivre. Les Français de Longwood ont maintenu une organisation calquée sur celle de l’ancienne Maison du souverain. Cette administration, tourne autour des deux officiers restants et de quelques serviteurs : le grand maréchal du palais Bertrand et l’intendant général Montholon, assistés par Louis Marchand premier valet de chambre. Cette organisation permet à Napoléon de « rester empereur », titre rejeté par les Britanniques. A la mort du maître, on s’emploie à rédiger des actes qui montreront à la postérité qu’un empereur est mort sur l’île. On attend minuit comme les médecins l’ont prescrit pour procéder à la toilette mortuaire. Le corps est gardé par le docteur Arnott et Pierron et l’abbé Vignali. Le matin du 6 mai, le commissaire envoyé par Louis XVIII, le marquis Montchenu et le gouverneur Lowe, accompagnés de représentants de l’île, affirment reconnaître le mort. Les obsèques sont fixées le 9 mai où la pompe la plus fastueuse pour un militaire a été déployée. Une difficulté a concerné l’inscription à graver sur le cercueil (et non sur le dalle comme on le dit toujours) Napoléon Bonaparte ou Napoléon ? Sans consensus, rien n’a été gravé et le cercueil restera anonyme d’où le vers de Lamartine : « Ici gît… Point de nom…! Demandez à la terre! »
Le 6 mai, médecins et généraux observent Antommarchi pratiquer l’autopsie et dicter un compte-rendu au major anglais Gorrequer. Le corps recousu, Napoléon est revêtu d’un uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la Garde et posé sur son lit de camp recouvert d’un manteau qu’il portait à la bataille de Marengo. Le gouverneur Lowe a demandé aux Français si les troupes et les habitants de l’île pouvaient voir le corps, dans l’intention de faire identifier l’homme par un grand nombre de personnes pour éviter l’apparition de faux Napoléon évadés de Sainte-Hélène. Une procession s’étire sur deux jours. Pendant ce temps, Gorrequer rédige sous la dictée de Lowe les lettres et les rapports annonçant le décès « du voisin » et les résultats de l’autopsie qui évoquent un »squirre », terme à l’époque équivalent à « tumeur » (évitant le mot hépatite ou des éléments pouvant incriminer de mauvaises conditions de détention).
Pour porter les dépêches, la flottille anglaise, le HMS Heron est dirigé par l’amiral Lambert assisté par le capitaine William Crokat qui remettra les plis à leurs destinataires car il est témoin de Napoléon vivant puis des quelques instants après sa mort. Le commissaire français, le marquis de Montchenu doit attendre le 19 mai pour pouvoir expédier son rapport par le sloop léger HMS Rosario du capitaine Hendry. Par un heureux hasard, les deux navires arrivent en même temps. Un courrier est envoyé à Paris avec le rapport du commissaire du roi.
Après une soixantaine de jours de mer, le 3 juillet 1821, Crokat débarque en Angleterre, court à Londres et le lendemain se rend chez le comte Henri Bathurst. Ennemi juré de la puissance française, il a été aux commandes de l’économie anglaise au moment du blocus continental. Libéré du joug des Français, ses bureaux ont fixé le cadre de détention du vaincu.
Le plus grand ennemi de l’Angleterre n’est plus. Pourtant le comte ne semble pas soulagé. Le durcissement des conditions de détention de Napoléon a été fortement critiqué par ses adversaires politiques et le comte vivra le reste de sa vie avec mauvaise conscience alors que le gouverneur Lowe se fera oublié à Ceylan. Finalement, la prédiction de Napoléon se réalisa. Ses geôliers se verront salis. Selon Adolphe Thiers : »Si la Justice dit qu’on avait le droit de garder Napoléon, … on n’avait ni le droit de le torturer, ni celui de l’humilier » Au moment où Crokat arrive à Londres, les préparatifs du couronnement du roi George IV à Westminster battent leur plein. Le souverain a la tête ailleurs, aspirant aux fastes d’un sacre, à l’image de celui de 1804. De fait, la mort du captif induit un soulagement financier pour le gouvernement anglais et l’île de Sainte-Hélène est restituée à la Compagnie des Indes orientales. Dans l’après-midi du 4 juillet, la mort de Napoléon est connue par des dizaines de personnes et les journaux relaient la nouvelle le lendemain, en insistant sur la douceur de sa mort et la beauté de son corps, dédouanant ainsi le gouvernement anglais. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, tous les Anglais n’étaient pas anti-napoléoniens. Wellington, vainqueur de Waterloo en parle avec une grande admiration tandis que Byron accuse son pays d’avoir « hâter la fin du grand homme ».
Et la France de Louis XVIII ? Une ambiance de fin de règne (le roi est infirme et malade) associée à l’assassinat du duc de Berry, fils du futur Charles X renforce le parti des ultras. Louis XVIII apprend la nouvelle de la mort de l’usurpateur dans la soirée du 5 juillet, entouré d’anciens combattants de l’Empereur comme le général Rapp, premier chambellan du roi. Louis XVIII ne manifeste aucun plaisir inclinant plutôt à la modération ce qui fut un signal clair pour les ultras qui auraient préféré plus d’ostentation. On pouvait pleurer Bonaparte dans le palais royal.
Et la presse française ? Lorsque les nouvelles de Sainte-Hélène sont connues, la presse se montre prudente quant au ton employé dans les articles et ne prolonge guère son intérêt au-delà de deux semaines. Le moniteur officiel publie le premier l’information le 6 juillet et se contente de traduire les journaux anglais. Les observateurs de l’époque semblent sidérés de l’indifférence dans laquelle la nation accueille la mort de celui qui a été tant applaudi contrairement à ce qui sera ensuite véhiculé par la tradition. La surprise passée, une salve de brochures est rédigée accréditant des mensonges sur le décès, la thèse de l’empoisonnement ou en mettant en cause la mort elle-même. Leur portée a été très restreinte.
Et les Français ? En marge de l’indifférence générale, l’annonce de la disparition de l’Aigle encore jeune, même pour l’époque, n’est pas possible pour certains et son retour est attendu, phénomène qui se prolonge jusqu’au milieu du XIXe siècle avec l’apparition de faux Napoléon. Même Lyon, ville réputée bonapartiste parce ce que l’empereur lui avait déclarée sa flamme au retour de l’île d’Elbe (Lyonnais, je vous aime), ne manifeste que de modestes intentions comme des bouquets de violettes à la veste. Rien qui puisse inquiéter le préfet pourtant sur le qui-vive.
Et la famille ? Après 1815, les Bonaparte se sont fixés en Europe, sauf Joseph, le chef de clan, qui vit à plus le deux mois de mer en Amérique. Le réseau s’est resserré autour de Mme Mère à Rome avec qui toute la famille correspond. Même si aujourd’hui on a bien du mal à le concevoir, Letizia a longtemps cru que son fils n’était plus à Sainte-Hélène, cette information lui venant d’une voyante. Son demi-frère, le cardinal Fesch ne fait rien pour l’en dissuader. La mauvaise nouvelle arrive à Rome le 16 juillet 1821. Fesch l’apprend par les journaux et en informe Mme mère que six jours plus tard. Elle est terrassée comme le sera Pauline qui ne s’en remettra pas. Après les cérémonies de deuil, les Bonaparte reprennent le chemin de leur vie, en raison de leurs dissensions. Côté Beauharnais, la peine est vite surmontée. En cure à Saratoga, Joseph apprend la mort de son frère à la mi-août. Il impute la fin de l’empereur aux mauvais traitements infligés par ses ennemis. Inquiet par l’hérédité possible d’un cancer de l’estomac, il se fait examiner. Il vivra encore 22 ans.
Et sa veuve ? Et son fils ? Nul doute que l’Europe entière scruterait les réactions du fils et de la mère, ce qui est très surveillé à Vienne. Comparé aux enjeux, le chagrin reste secondaire. Marie-Louise reste pour beaucoup une femme séquestrée par son père, l’empereur François Ier. Naturellement, la cour de Vienne ne prend pas le deuil. Le congrès de 1815 accorde à Marie-Louise le duché de Parme. Ce petit état est gouverné par le général Adam Adalbert de Neipperg aussi amant de l’impératrice et duchesse avec qui il a eu deux enfants. Informée du sort de son époux le 19 juillet par la presse, elle réagit face à une Europe où l’oubli de l’épisode napoléonien est une règle absolue. Elle tient à son petit trône, à son statut d’impératrice mais aussi à sa vie familiale auprès de l’homme qu’elle aime. Le 8 août 1821, le mariage légitime sa situation et celle de l’enfant qu’elle porte. Très surveillée, elle ne répond à aucun appel des Bonaparte. Élevé par son grand-père à Schönbrunn, l’Aiglon est un enfant de 10 ans qui n’a jamais connu son père. La correspondance qu’il entretient avec sa mère montre une grande réserve. Comment aurait-il pu faire autrement ? Il le dit lui-même: « Ma naissance et ma mort, voilà toute l’histoire ».
Nourri d’informations inédites et de lectures précises, ce récit très plaisant renouvelle l’image que l’on a aujourd’hui de Napoléon. Six ans après Waterloo, l’Europe a quasiment oublié celui qui l’a tant inquiétée. L’auteur résume en conclusion, « Bonaparte n’est plus et Napoléon ne revivait pas encore ». Soutenue par le mémorial, la vague romantique saura raviver la flamme d’un Napoléon de gloire et de liberté.