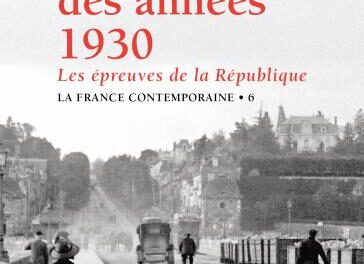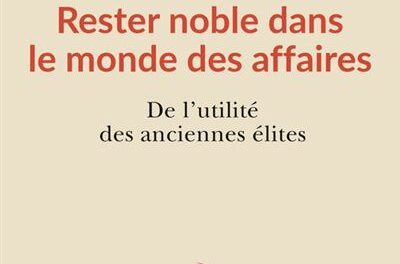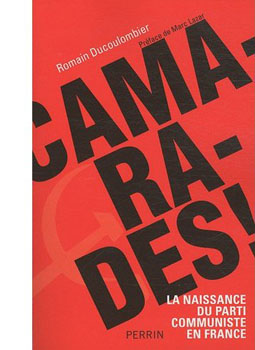
Lorsque l’on a été nourri dans les années soixante dix par les travaux de Annie Kriegel ou de Philippe Robrieux et quelques autres, tous anciens du Parti communiste français, on ne peux qu’être interpellé par cette floraison de travaux sur les conditions de la naissance de la section française de l’internationale communiste. L’ouvrage de Romain Ducoulombier s’inscrit dans la période 1914- 1921, la scission du congrès de Tours étant intervenue en décembre 1920.
Les études précédentes ont été publiées, dans les années soixante et soixante dix; le Parti communiste était alors un appareil puissant, regroupant un cinquième du corps électoral, exerçant une hégémonie politique de fait dans le mouvement ouvrier et sur certains territoires, comme les banlieues rouges. Les sources n’étaient pas facilement accessibles et les liens entre l’appareil du Parti communiste Français et l’URSS étaient connues mais sans que leur profondeur réelle ne soit attestée par des sources incontestables.
Le Parti communiste français d’aujourd’hui se bat pour sa survie, et il n’a plus électoralement qu’un poids négligeable, contesté par une extrême gauche extra parlementaire et une gauche radicale en période ascendante, si l’on se base sur les succès, pour l’instant médiatiques, d’Olivier Besancenot et Jean-Luc Mélanchon.
Un changement de contexte
Mais les succès médiatiques ne remplacent pas pour autant un ancrage électoral et territorial, avec un réseau d’élus locaux, des relais syndicaux et un certain rayonnement intellectuel. Mélanchon et Besancenot devaient y prendre garde.
Cet ancrage traditionnel, le Parti communiste français, sous la conduite de Robert Hue, de Marie-Georges Buffet et de Pierre Laurent est en passe de le voir disparaître, tout comme il l’avait perdu dans les années vingt, au moment de la « bolchévisation » du Parti communiste français.
Cela démontre sans doute que les morts dans ce domaine ne sont pas forcément définitives. Pourtant, privé de son ancrage social, le parti communiste français résiduel d’aujourd’hui devrait avoir du mal à renaître de ses cendres, d’autant plus que l’ex-trotskiste Jean-Luc Mélanchon dispute au PCF la possibilité de représenter la gauche non social démocrate aux élections présidentielles.
La particularité de cet ouvrage est qu’il envisage la naissance du PCF dans la continuité du traumatisme de l’assassinat de Jaurès et du ralliement du Parti socialiste à l’Union sacrée. La démonstration apparaît convaincante.
Le traumatisme initial, la mort de Jaurès
Pour l’historien, cette maturation de « l’antimilitarisme de guerre » commence très tôt, dans des milieux spécifiques de combattants et de non-combattants, qui ont le sentiment de voir bafouer leur idéal internationaliste.
Paradoxalement, Romain Ducoulombier insiste sur un antimilitarisme guerrier ambigu qui s’explique à la fois par le rejet du militarisme allemand, par l’influence post-mortem du jaurésisme et par une volonté de revanche sociale à l’encontre des « embusqués », de la bourgeoisie et du clergé.
Dans ce contexte se développe, dès 1914, une minorité agissante, autour de fortes individualités qui font « leur devoir » ou qui, déclarés inaptes au service actif, peuvent se consacrer au militantisme. On y retrouve aussi bien Pierre Monatte, le fondateur de la Vie ouvrière que Boris Souvarine et quelques autres.
Dès 1915, avec des hommes comme Jean Longuet ou Louis-Oscar Frossart une minorité s’organise, même si celle-ci est divisée entre ceux qui maintiennent l’idée de défense nationale et des radicaux.
La réunion de Zimmerwald en septembre 1915 associe des hommes issus du syndicalisme et du socialisme, mais également des russes comme Trotski qui ont compris l’intérêt de rompre avec la politique de défense nationale. Pour Lénine, la devise à défendre est : « Guerre civile et non Union sacrée ». À Kienthal en avril 1916, toujours en Suisse, ces socialistes défenseurs d’une « paix blanche », sans annexion ni indemnités et animateurs du Comité pour la reprise des relations internationales, défendent une ligne radicale exprimée par la suite dans un journal, « la Vague », lancé en 1917.
À partir de 1917, cette minorité agissante part à la conquête de l’appareil du Parti. Les acteurs ne sont pas des militants de premier plan mais des personnalités locales qui apporteront, lors du congrès de Tours, un soutien décisif aux partisans de la scission.
Une minorité agissante
Romain Ducoulombier insiste d’ailleurs sur la caractérisation sociale de cette base militante, notamment sur le poids des instituteurs, plus exposés à la mobilisation d’ailleurs que les ouvriers, susceptibles de se retrouver à l’arrière pour les besoins de l’industrie.
À partir de 1917, l’aura du bolchévisme s’étend même si ce n’est pas forcément le Léninisme qui a le vent en poupe. Peu à peu le développement de ce courant est lié directement à plusieurs mouvements contradictoires. La fondation de l’Internationale communiste à Moscou en Mars 1919, la génération de l’armistice qui entend prendre une revanche sur l’Union sacrée, la volonté aussi du parti bolchévik d’organiser des scissions va conduire à la décision de Tours et à la rupture, pour l’instant définitive, entre communistes et socialistes qui gardent la vieille maison.
La thèse de l’auteur, et ce qui en fait l’originalité, est bien celle d’une scission « accidentelle », qui a été provoquée par les circonstances. Mais les initiateurs de cette scission ne souhaitaient pas pour autant la bolchévisation du parti dans un sens léniniste, ils souhaitaient plutôt renouer avec le fil rompu de la tradition révolutionnaire d’avant guerre. La majorité de Tours associe les partisans de l’IC sur le modèle russe et les partisans de la reconstruction du Parti d’avant guerre comme Frossart et Cachin. Boris Souvarine et Fernand Loriot, les inspirateurs de ce comité pour la IIIeme internationale, sont favorables aussi à un parti de type nouveau, « léniniste » pourrait-on dire.
D’après l’auteur, les militants partisans de cette adhésion à l’IC ont accepté d’avaler toutes les couleuvres du régime bolchévik lors de leur voyage à Moscou, et, « au nom de la défense de la Révolution », accepté de taire les aspects peu reluisants du régime qui s’imposait par la terreur à Moscou.
Sacrifice pour la cause
Dans la troisième partie de l’ouvrage, « Un parti de type nouveau », Romain Ducoulombier revient sur cette évolution où le Parti dévore ses enfants, et où ceux qui ont contribué à la première « épuration » en sont victimes à leur tour.
Dans ces page sur « la formation d’un appareil inquisitorial », on retrouve les mécanismes de l’exclusion à la base, de cette mort sociale et politique de ceux qui, ayant consacré le meilleur d’eux même à cet idéal, se retrouvent brisés au nom d’une logique d’appareil imposée par un Centre lointain mais en même temps capable de peser sur les évolutions d’un parti considéré comme une annexe au service d’une politique d’État, l’État soviétique.
Les connaisseurs de l’évolution du mouvement ouvrier dans les années vingt ne seront pas étonnés ni spécialement surpris par ce qu’il apprendront ou plutôt retrouveront dans ce livre, si toutefois ils ont gardé le souvenir de ces débats sur les quatre premiers congrès du Komintern qui ont été les références du communisme révolutionnaire non stalinien.
En attendant, ce livre est utile par son contenu, mais on sera un peu réservé sur sa construction qui peut surprendre et sur les allers retours incessants entre périodes qui ne facilitent pas vraiment sa lecture. Le choix mi-thématique, ni-chronologique de l’auteur, ne nous est pas vraiment apparu très opportun. Il ne nous est pas non plus apparu, en dehors de quelques sources originales sur les débats au sein des fédérations locales de la SFIO, renouveler vraiment cette histoire des conditions de la naissance du Parti communiste, même si un rappel est toujours salutaire.