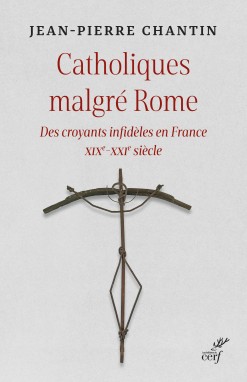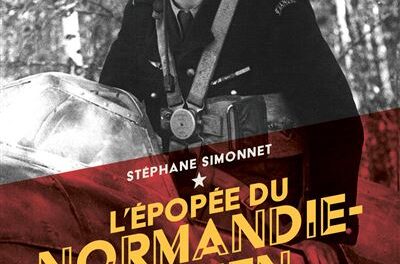Historien des religions et en particulier des courants radicaux du jansénisme dans l’Ain et le Lyonnais, Jean-Pierre Chantin livre ici une somme particulièrement bienvenue sur un pan de la religiosité catholique encore trop peu étudié pour l’époque contemporaine. Couvrant des mouvements aussi variés que la « Petite Eglise » opposée au Concordat, les « vieux catholiques » contestant l’infaillibilité pontificale ou les millénaristes jansénistes, la question initiale est posée sous forme d’aporie : peut-on être catholique sans Rome, en particulier durant ce siècle marqué par le triomphe de la suprématie romaine ? Plus largement, quelle place possible pour la « dissidence » dans une Eglise catholique fondamentalement centralisatrice ?
René Rémond écrivait dans les années 1970 que « les représentants de l’anticléricalisme chrétien ne pouvaient jadis se maintenir à l’intérieur de l’Eglise, soit qu’ils en sortissent d’eux-mêmes, soit que celle-ci les rejetât comme hétérodoxes » (L’anticléricalisme en France, de 1815 à nos jours, Fayard, 1976). L’auteur nous invite cependant ici à réévaluer les conditions de possibilité, au XIXe et au XXe siècle, d’un « anticléricalisme croyant » (comme le nommait T. Wanegffelen), c’est-à-dire de la contestation, au nom de la foi, de l’autorité et du monopole religieux de l’Eglise instituée. Certes, aussi réduits soient-ils, ces courants attirèrent les réactions et les sanctions des autorités ecclésiastiques. Leur situation fut particulièrement difficile à maintenir en France dans le cadre du l’Eglise concordataire : fruit d’un accord passé entre l’Etat et Rome, sa contestation fut réprimée par les gouvernements successifs jusqu’en 1905. Après la Séparation, la « liberté » retrouvée par l’Eglise livrait le clergé et les fidèles à l’absolue souveraineté romaine. Mais tout l’intérêt du livre de J.-P. Chantin est de traquer dans les sources les fines lignes de crêtes, afin de restituer une partie de ces marges intérieures du catholicisme qui n’aboutissent pas nécessairement à la rupture et sont souvent masquées par des schismes plus spectaculaires. Au-delà, c’est également la mutation fondamentale du fait religieux vers son individualisation, phénomène essentiel de la période contemporaine, qui est analysée par ce pas de côté.
Une histoire en miettes
J.-P. Chantin ne dresse pas ici un panorama complet des dissidences ou contestations religieuses catholiques depuis 1789 qui relèverait, comme M. Cottret l’écrivait à propos du jansénisme, d’une « histoire impossible » (Histoire du jansénisme, Perrin, 2016, p. 296). Il privilégie donc des approfondissements ciblés sur des moments dissidents ou contestataires. On relèvera cependant, à la suite de l’auteur, deux grandes tendances qui forment comme les pôles d’un balancier et recoupent le grand clivage ouvert pas la Révolution.
D’un côté une frange libérale et réformiste du catholicisme, dont l’opposition à Rome repose avant tout sur les positions intransigeantes et anti-modernes prises par les autorités ecclésiastiques, attend du catholicisme une adaptation plus grande au nouveau monde issu de la Révolution. J.-P. Chantin rappelle par exemple la brève aventure, un peu oubliée aujourd’hui, de l’Eglise catholique française de l’abbé Chatel. Dans les suites de la Révolution de 1830, François Chatel, « personnage symptôme » (p. 82) d’une volonté « d’ajustement » de l’Eglise catholique et de la renaissance religieuse de l’âge romantique, tente de poursuivre l’élan réformateur de Juillet : en rupture avec la hiérarchie ecclésiastique, il propose aux communes qui en feraient la demande de fournir des prêtres libéraux, tout en réorganisant le culte (messe en langue française, mariages calqués sur la loi civile, remise en cause du célibat des prêtres, etc.). L’entreprise sombre très vite avec le tournant conservateur du régime, tandis que Chatel s’enfonce dans la dissidence dogmatique. L’auteur identifie par la suite d’autres de ces courants critiques et réformistes dans le « vieux-catholicisme » qui s’opposera à la fin du siècle au dogme de l’infaillibilité pontificale, dans le Sillon de Marc Sangnier ou plus loin encore dans le mouvement des prêtres ouvriers.
De l’autre côté, il existe également une contestation conservatrice de l’autorité de Rome, attachée aux traditions et à la « religion de nos pères » jugée menacée par les nouveautés et les prises de position pontificales. C’est par exemple la « Petite Eglise » constituée en opposition au Concordat signé en 1801 entre Napoléon Ier et le pape Pie VII, et dont l’auteur tente de restituer les prolongements jusque sous la Restauration. Comme pour d’autres courants, faire la part entre raisons politiques et religieuses est délicat, tant les premières oppositions poursuivent les mobilisations commencées sous la Révolution (monarchisme, chouannerie, refus des serments constitutionnels…). Néanmoins, le maintien de la contestation malgré la restauration des Bourbons tend à donner dans les années 1820 un caractère plus spécifiquement religieux à l’opposition de la Petite Eglise. Marqués par le gallicanisme et l’attachement aux libertés anciennes de l’Eglise de France vis-à-vis du pape, ces courants anti-romains et conservateurs se poursuivent au XXe siècle.
Enfin, entre ces réactions symétriquement distribuées, l’auteur croit également dégager une tendance qu’il nomme « novatrice » (p. 359), qui cherche à contourner les autorités religieuses jugées incapables de faire face aux défis du temps. C’est le cas des survivances jansénistes, ou plutôt « port-royalistes » des XIXe et XXe siècles, et en particulier de ses courants les plus radicaux dits « convulsionnaires » que l’auteur connaît bien : pinélistes, bonjouristes, béguins, etc. Ces courants affirment prolonger et reconnaître la validité de l’« Œuvre », c’est-à-dire des miracles et convulsions opérées dans les années 1730 autour du tombeau du diacre François de Pâris, figure du martyr janséniste en lutte contre la tyrannie pontificale. Cette forme d’opposition à Rome s’atomise au siècle suivant en une myriade de petites « communautés émotionnelles », dans lesquelles le merveilleux et la certitude de l’élection occupent une place considérable. Pour parler en termes wébériens, l’autorité charismatique de leurs leaders laïcs ou cléricaux mettait nécessairement aux prises ces communautés avec l’autorité légale incarnée par l’Eglise instituée.
De la paroisse aux réseaux internationaux
Par-delà les tendances et les catégories dont l’identification stricte pose toujours question, quelques traits communs traversent la masse des fidèles et forment l’épine dorsale d’une opposition plus ou moins diffuse à l’autorité romaine et l’Eglise établie. C’est en particulier la préservation de la communauté locale et des biens religieux communs : J.-P. Chantin s’appuie sur de nombreux exemples locaux fournis par le beau fond F/19 des Archives nationales (Police des cultes) pour démontrer l’importance capitale ici de l’échelon paroissial dans les logiques dissidentes.
Loin des portraits contemporains décrivant des ouailles perdues par des leaders manipulateurs (le préfet des Deux-Sèvres, département particulièrement marqué par l’opposition au Concordat, n’envisage ainsi de poursuivre que les prêtres, et non les habitants des paroisses récalcitrantes), l’enjeu principal est de redonner toute leur marge de manœuvre aux fidèles. C’est ainsi le cas de cette « Petite Eglise » anti-concordataire, certes incarnée par d’éminentes figures épiscopales attachées aux libertés gallicanes ou monarchistes, mais relayée également par l’action d’un clergé local relativement autonome (300 à 400 prêtres selon le décompte de l’auteur) prolongeant des luttes et des pratiques clandestines remontant souvent aux années 1790 (fuite, messes nocturnes…). Ces prêtres peuvent être suivis par les communautés paroissiales, mais également subir eux-mêmes leur pression. La protestation des habitants est alors fondamentalement conservatrice : il s’agit de s’opposer aux « nouveautés », comme un nouveau catéchisme ou délimitation de paroisse, mais également au calendrier des fêtes religieuses fixé par Napoléon qui ôte à la Fête Dieu son importance ancienne. La géographie de la contestation recoupe ainsi des espaces marqués par des pratiques de résistance et des identités rétives aux interventions extérieures (comme certains villages du Morbihan). Les livres et dépôts textuels jouent ici des rôles de transmission essentiels, et il faut noter ici comme la réalité recoupe mal les considérations de l’époque sur des « infidèles » ignares et populaires : on trouve ainsi également des notables urbains et marchands, ou des gros propriétaires ruraux (à Vendôme, Fougères, La Rochelle, Gap, Lyon, dans le Rouergue…).
On retrouve la même dimension paroissiale dans l’Eglise de l’abbé Chatel, dont l’auteur tente de restituer toute l’épaisseur sociale en faisant déborder l’épisode de la figure pittoresque de son chef. De multiples logiques motivent les fidèles à suivre le nouveau culte, que ce soit par attachement à un prêtre en butte avec sa hiérarchie, par rejet d’un nouveau desservant, ou tout simplement par vacance de siège. En Haute-Marne, les habitants de deux bourgs industrieux soutiennent leur prêtre en entrant eux-mêmes en dissidence : ils occupent ainsi leur lieu de culte, chassent le nouveau curé nommé par l’évêque, et maintiennent le culte en toute illégalité. Certaines communautés d’artisans ou d’ouvriers, hostiles à la Restauration et à son clergé, se tournent également vers l’Eglise de Chatel : un vieil habitant de Montrouge se souvient ainsi en 1904 qu’il se rendait à ces messes « pour la simplicité du culte, les prières dites en français et le patriotisme qui y était affiché » (p. 136). Ainsi, peu importe l’échec et le provisoire de l’aventure, c’est bien l’importance de la création d’un espace d’autonomie pour les fidèles vis-à-vis du culte majoritaire qui est à retenir, dans ce cas comme dans d’autres relatés par l’ouvrage.
Au XXe s. néanmoins, cette dimension paroissiale de la dissidence cède face à l’individualisation du religieux qui tend de plus en plus à devenir une « opinion », tandis que se forment de plus larges réseaux articulés autour de quelques figures populaires qui catalysent les mécontentements individuels. Dans le cadre d’une chute de la pratique, à partir des années 1960 et bien décrite par G. Cuchet (Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil, 2018), les notions de dissidence, d’exclusion et de sanction au sein d’une Eglise dont l’autorité est déclinante, ne font plus grand sens.
Des contours flous et mouvants
En s’attachant à restituer les logiques d’opposition au ras des individualités, l’auteur éclaire également la grande variété des oppositions, attentif aux lignes de crête, des désobéissances ponctuelles aux ruptures complètes. Les raisons de la dissidence sont multiples (politiques et/ou religieuses), tout autant que les attitudes. Il faut ainsi mesurer la difficulté pour certains fidèles d’entrer en conflit ouvert avec une autorité comme l’Eglise : tenter le schisme, c’est aussi risquer la rupture sociale, familiale et communautaire. Le maintien dans le giron catholique contraint donc à des postures acrobatiques et à des stratégies sociales dont il faut relever l’inventivité : les habitants de Saint-Maximin (Var) par exemple, opposés au clergé concordataire, font malgré tout baptiser leurs enfants et leur font suivre l’instruction religieuse, avant de les en éloigner dans le courant de l’adolescence, faisant ainsi coexister des attaches multiples.
C’est bien la question de l’homogénéité de cette multitude disparate qui se pose au bout du compte et, partant, de la délimitation des groupes contestataires. Comme l’auteur l’écrit pour les fidèles de l’Eglise de l’abbé Chatel, un « portrait de groupe est difficile » (p. 120), tandis que les port-royalistes forment « un collectif imaginé seulement dans la persécution » (p. 200). Le vocabulaire de la dissidence est l’enjeu crucial ici, déjà posé par les études médiévales sur l’hérésie : « Petite Eglise », « Incommunicants », « Enfarinés », Chambristes », « Patarins », « Illuminés »… autant d’appellations qui traduisent la difficulté à nommer la dissidence. Cela doit interroger, en dernier lieu, sur les sources disponibles à l’historien de ces communautés des marges et de la rupture : qui nomme qui ? qui regarde qui ? qui définit qui ? J.-P. Chantin rappelle comme de nombreuses contestations « n’ont été rapport[ées] que par les policiers étonnés, des fonctionnaires locaux parfois compréhensifs, des prêtres concordataires très critiques” (p. 43). L’imagine qui nous en est parvenue est ainsi dépendante de « la parole des cadres, religieux, notables ou administratifs… » (p. 358).
Une contribution importante à l’histoire du religieux à l’époque contemporaine
L’ensemble de l’ouvrage forme donc une somme très riche, abordant des aspects peu traités du fait religieux aux XIXe et XXe siècle, dans une dimension à la fois sociale et politique. Il est appelé à faire référence sur plusieurs courants qu’il réinvestit par une recherche approfondie en archives.
Quelques éléments empêchent néanmoins, selon nous, le livre d’accéder à tout son potentiel. Il choisit d’abord de s’écarter de la synthèse (peut-être impossible pour cette chronologie et l’ampleur du sujet) et, malgré une conclusion stimulante reposant quelques jalons, il est difficile d’en embrasser toutes les perspectives, laissant parfois le lecteur avec plus d’incertitudes que de réponses claires. La pensée de l’auteur est d’ailleurs complexe et l’écriture ne donne pas toujours toutes les clés pour en saisir l’ampleur : les phrases, souvent longues et alourdies de multiples appositions, sont un défi à la concentration du lecteur. Ces formulations poseraient moins problème si on ne sentait leur caractère décisif pour la compréhension de l’analyse : on s’inquiète ainsi parfois ne pas pouvoir accéder à toute la profondeur de la réflexion de l’auteur. Un exemple parmi d’autres : « La question centrale est de saisir cette distance de tous qui semble trancher avec la précédente anticoncordataire, plutôt conservatrice car elle a refusé une évolution de l’autorité ou de la norme, qui, elle, résultait non d’un choix mais d’une accusation consécutive à son refus de changement » (p.82). Quelques coquilles étonnantes se retrouvent aussi, comme cette mention d’« Eugen Weber » (p. 225), alors qu’il s’agit bien de Max, ou des références bibliographiques sans auteur dans les notes, et que l’on ne retrouve pas à la fin de l’ouvrage. Cela interroge ici moins les qualités de l’auteur, que le travail de relecture de l’éditeur.
Pour finir, un index et des cartes (sur la géographie de la Petite Eglise et sa concordance avec les mobilisations des années 1790, sur l’implantation de l’Eglise de Chatel, etc.) auraient été bienvenus pour donner à cet ouvrage toute sa dimension de référence. Car il ne faut pas se laisser décourager par ces quelques critiques de forme, et garder à l’esprit que ce travail demeure une lecture incontournable pour qui s’intéresse au fait religieux et à ses mutations à l’époque contemporaine.