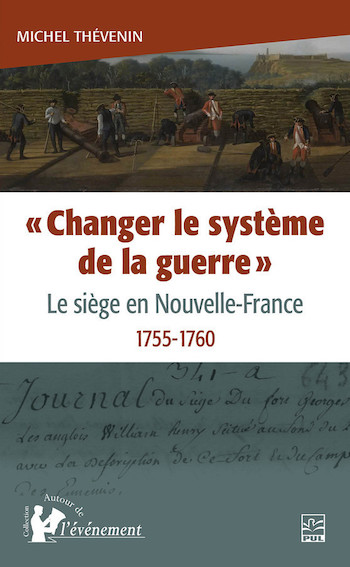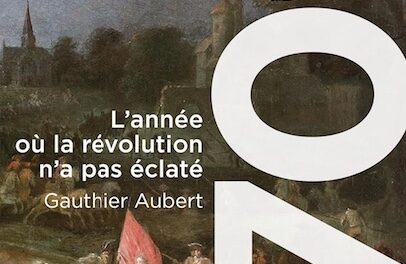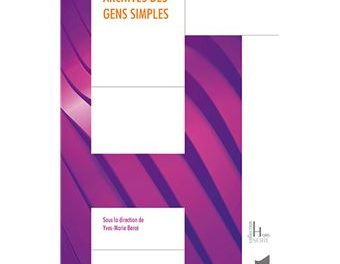Arrivé au Québec en 2014, Michel Thévenin est aujourd’hui doctorant en Histoire à l’Université Laval. Il s’est spécialisé sur la question de la guerre de siège au 18e siècle, avec un intérêt pour toutes les thématiques attachées : ingénieurs militaires, fortifications, artillerie, etc. et se montre particulièrement actif en matière de diffusion et de vulgarisation de ses recherches, par la participation régulière à des conférences publiques et l’animation de son blog Tranchées et tricornes1.
Le présent ouvrage, son premier, est directement issu de son mémoire de maîtrise, déposé en 2018 sous la direction de Michel De Waele et Alain Laberge. Il s’agit d’une version remaniée et augmentée de ce travail, des points étant corrigés, d’autres approfondis. Il a pour ambition d’y mettre en lumière la pratique de la guerre de siège en Nouvelle-France lors de la Guerre de Sept Ans2, en la comparant avec le modèle théorique du siège en vigueur dans l’Europe du Siècle des Lumières.
Vauban en Amérique
De fait, le premier chapitre de l’ouvrage (p.13-45) est tout entier consacré à la présentation de la pratique de la guerre de siège en Europe dans la première partie du XVIIIème. Une approche lexicale, à la lueur des écrits théoriques de l’époque (et en particulier de l’article très complet de L’Encyclopédie), est d’abord proposée : le siège peut décrire toute une série d’opérations menées contre une place forte par une armée établie devant elle, du simple blocus à la lancée d’assauts en passant par son bombardement, avec pour objectif sa prise. L’auteur rappelle ensuite comment le XVIIIè siècle constitue en la matière l’aboutissement d’un processus long, découlant de l’apparition de l’artillerie à la fin du Moyen-Age : l’abaissement et l’épaississement des murs, l’émergence de la fortification bastionnée, l’échelonnement des défenses semblent un temps rendre la supériorité à l’assiégé, jusqu’ à ce que Vauban, par la rationalisation de certaines pratiques existantes et l’introduction de nouvelles, perfectionne au plus haut point l’art de l’attaque, dont il livre un modèle théorique, finalisé en 1704.
Bien que contesté par certains (tel le hollandais Coehoorn), ce modèle, corrélé à l’augmentation du nombre de places-fortes qui matérialise la volonté d’emprise territoriale des Etats, et aux craintes nées du caractère aléatoire de la bataille, finit par imprégner toute la pratique de la guerre et les stratégies mises en œuvre jusqu’à la Guerre de Sept Ans, et il conditionne évidemment la pensée des officiers envoyés aux colonies. En Amérique du Nord, ceux-ci se retrouvent pourtant confrontés à des conditions spécifiques, détaillées dans le deuxième chapitre (p.47-59) : contraintes géographiques (climat rude, distances immenses, faible maîtrise du territoire), pratique exclusive de la « petite guerre » chez les autochtones (miliciens canadiens et Amérindiens), faibles qualités défensives, au regard des critères européens, des villes et du réseau de forts en possession des Français…
Tout cela va s’intégrer dans un modèle stratégique progressif, étudié dans le troisième chapitre (p.61-102). Dès avant les hostilités, le camp français a perçu le rôle pivot du Canada pour la préservation des possessions américaines, et identifié quatre zones-clé où pratiquer une défensive active : Louisbourg et le Saint-Laurent, le couloir du lac Champlain, le lac Ontario, et la vallée de l’Ohio. De 1755 à 1757, le « moment français » (E.Dziembowski)3 voit ceux-ci multiplier les succès sur ces différents fronts ; mais la disette et l’intensification de l’effort de guerre ennemi amènent la donne à s’inverser en 1758. Miraculeusement stoppés par Montcalm à Carillon, les Britanniques sont victorieux dans tous les autres secteurs, obligeant les Français à réévaluer leur stratégie et à se cantonner à la défense d’un réduit de plus en plus limité où ils sont finalement acculés à la reddition en septembre 1760. C’est dans ce contexte que prend place l’application tactique de la guerre de siège en Nouvelle-France, à laquelle l’auteur consacre le quatrième chapitre (p.103-152).
Du côté français, elle est menée grâce à l’apport scientifique et technique de professionnels qualifiés issus du corps des ingénieurs militaires, dont le nombre trop limité impose aussi le recours à d’autres officiers nantis de connaissances plus ou moins poussées en la matière ; et toutes les opérations de siège des deux camps (l’auteur en relève une bonne dizaine) sont conduites selon le modèle classique théorisé par Vauban, évidemment amendé par la pénurie de moyens disponibles sur ce théâtre, la faiblesse des effectifs empêchant ainsi l’isolement total des places ou l’envoi de secours. L’ensemble est aussi conditionné par la culture militaire qui imprègne les officiers combattants en Amérique, étudiée dans le cinquième chapitre (p.153-187).
La violence, indéniable, de la guerre de siège à l’européenne reste acceptable car codifiée, rationalisée, modérée par des pratiques de courtoisie et respect mutuel entre adversaires ; la supposée « cruauté » des Amérindiens (en fait l’application d’une autre culture guerrière) cadre évidemment mal avec ce modèle, ce qui conduit, en particulier après le « massacre » d’une partie de la garnison de Fort William-Henry au mépris de la capitulation accordée par Montcalm, le 10 août 1757, à son rejet par les officiers européens et à la justification par les Britanniques d’une dureté accrue lors des opérations qui suivent.
Le souffle de la guerre
Au terme de son développement, l’auteur conclut donc à une transposition réussie au contexte colonial de la Nouvelle-France du modèle militaire de la guerre de siège alors en vigueur en Europe, sur les plans stratégique et tactique. Ce qui est méthodiquement démontré par l’exposé n’apparaît de prime abord guère étonnant, et on voit mal vers quelles autres modalités que celles façonnées par la culture militaire contemporaine auraient pu, dans la volonté des décideurs tout au moins, évoluer les opérations nord-américaines à partir du moment (1755) où des troupes régulières venues d’Europe y furent affectées en nombre4, et que la Couronne britannique décidait d’y orienter une bonne part de son effort de guerre.
Le plus surprenant réside sans doute dans le fait que les belligérants furent capables de surmonter les contraintes logistiques immenses posées par ce théâtre d’opérations, au prix de probables tours de force semblables à l’expédition Knox5. L’ouvrage ne s’étend pas malheureusement pas sur ces aspects, ainsi que sur la thématique liée du concours qui a pu être apporté aux opérations par la marine, d’eau douce ou de haute mer (cette dernière joua par exemple, dans les deux camps, un rôle direct et déterminant dans les sièges de Louisbourg et de Québec). De par la nature originelle de ce travail, on ne peut cependant pas lui reprocher décemment cette frustration, dont l’auteur est d’ailleurs bien conscient, mais simplement souhaiter comme lui que d’autres études viennent s’intéresser à ces aspects des choses.
Au final, Michel Thévenin livre, dans le cadre qu’il s’est fixé, une synthèse érudite qui propose d’intéressantes mises en perspective au regard des pratiques de l’époque et plus globalement de l’art de la guerre, dont il maîtrise bien les problématiques. On ne s’en étonnera pas en constatant qu’il s’appuie sur une bibliographie fournie, qui allie aux sources contemporaines (écrits théoriques et témoignages laissés par les acteurs) nombre de travaux et d’ouvrages, d’approche générale (on sait que l’historiographie de la guerre a été largement remodelée depuis un demi-siècle), comme consacrés spécifiquement à la Guerre de Sept Ans (dont l’abord a là aussi été largement renouvelé depuis quelques années), et à la guerre de siège.
Bien structuré, écrit dans un style accessible, complété de quelques illustrations et de trois intéressantes annexes, l’ouvrage est en outre d’une lecture agréable. Tous ceux qui se passionnent pour cet affrontement épique qui devait modeler de façon décisive le visage de l’Amérique du Nord devraient donc y trouver une contribution supplémentaire à sa restitution concrète.
2 1756-1763 ; de facto dès 1754 en Amérique, où le conflit reste nommé « French and Indian War » par les Anglo-Saxons et « Guerre de la Conquête » par les Québecois.
3 La Guerre de Sept Ans (1756-1763). Perrin, 2015.
4 Du côté français, quatre bataillons furent envoyés à Québec et deux à Louisbourg, pour assister les compagnies franches de la marine qui étaient jusqu’ici les seules unités en poste dans la colonie ; les renforts envoyés de 1756 à 1758 allaient ensuite doubler cet effectif. Du côté anglais, trois régiments étaient positionnés en Nouvelle-Ecosse, et deux furent expédiés en Virginie (où ils subirent l’écrasante défaite de la Mononghela) ; l’effort devait être autrement conséquent les années suivantes.
5 Pendant l’hiver 1775-1776, le colonel Henry Knox réussit, sur ordre de Washington, à convoyer les pièces d’artillerie saisies au fort Ticonderoga, ex-Carillon, sur les bords du lac Champlain, jusqu’à Boston assiégée par l’armée continentale, précipitant l’évacuation de la ville par les Britanniques.