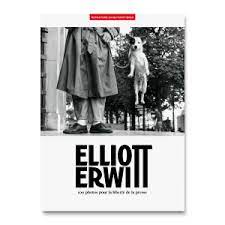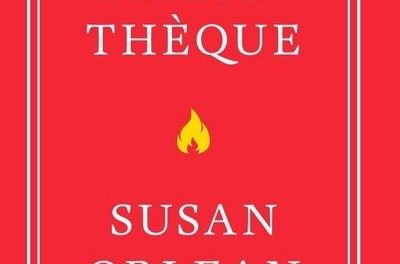On le sait, et Alexander Mikaberidze en a encore apporté la démonstration éclatante dans une récente et brillante synthèse, les bouleversements de tout ordre de la Révolution et de la période napoléonienne eurent un impact profond non seulement en Europe, mais aussi à l’échelle internationale. Egypte, Empire Ottoman, Inde, Afrique du Sud, Iran et Océan Indien, Etats-Unis et Antilles… la liste est longue des parties du monde qui furent touchées par des répercussions plus ou moins importantes du maelstrom venu de France – et il faut y citer au premier chef les Amériques Centrale et du Sud, jusqu’ici joyaux des empires coloniaux du Portugal (au Brésil) et de l’Espagne. C’est à l’étude de la chute de ce dernier, qui devait s’étaler de 1810 à 1825, que s’attache le présent ouvrage, dû à la plume de Gonzague Espinosa-Dassonville.
Docteur en histoire (2017), délégué Aquitaine du Souvenir Napoléonien et président de la Société de Borda basée à Dax, l’auteur enseigne aujourd’hui au campus de Bordeaux de l’Ecole (privée) des Hautes Etudes internationales et politiques (HEIP). Il s’est spécialisé sur l’étude du XIXe siècle, consacrant plusieurs publications à la figure du général Lamarque et à divers épisodes contemporains des Premier et Second Empires. Le présent travail est beaucoup plus ambitieux, puisqu’il se veut une histoire globale de l’indépendance de l’Amérique espagnole, et qu’il l’aborde avec un regard novateur présenté dès l’introduction. A rebours des « romans nationaux » forgés au XIXè siècle dans les différents Etats issus de cette décolonisation, qui la présentent comme inéluctable, l’auteur se propose en effet de montrer que ce processus découle avant tout du chaos dans lequel l’invasion napoléonienne jette, à partir de 1808, la métropole.
Acéphalie fatale
Bien loin d’être au bord de la révolte, l’Amérique espagnole est de fait, à la veille des événements, « un pilier de la monarchie » (1ère partie, p.15-120). Elle est un ensemble complexe, constitué, à l’image de l’Espagne elle-même, de divers royaumes unis sous la couronne de Castille et dans un catholicisme activement promu. Certes exploitée économiquement au bénéfice exclusif de la métropole et parcourue de tensions entre créoles et péninsulaires, elle jouit d’une autonomie de fait qui assure paradoxalement sa fidélité ; la politique centralisatrice entreprise par les Bourbons au cours du XVIIIè siècle ne parvient pas réellement à mettre fin aux corporatismes en place, et ne conduit pas non plus à une volonté d’indépendance des créoles qui se savent en minorité dans des sociétés multiethniques. Une véritable identité américaine existe, mais elle reste régionale et complémentaire à celle d’Espagnol ; avec les Lumières, les esprits évoluent, mais comme partout à la même époque (y compris en Espagne), et pour l’auteur, qui s’inscrit en faux contre la vision trop facile d’élites locales émancipées et ouvertes opposées aux élites péninsulaires réactionnaires, les préoccupations des Américains restent bien plus pragmatiques qu’idéologiques.
La Révolution française est d’abord accueillie avec une prudence qui évolue en hostilité ; puis à partir de 1796 l’Espagne en vient à se ranger aux côtés de la France, s’attirant dès lors les coups de la puissance maritime britannique. Si celle-ci ne parvient pas à prendre pied en Amérique espagnole, elle affaiblit grandement l’économie et les liens transatlantiques hispaniques, assujettissant d’autant le royaume à son puissant voisin. C’est alors qu’en mai 1808 Napoléon oblige la dynastie en place à abdiquer au bénéfice de son frère Joseph ; dans les mois qui suivent, les différentes parties de l’Espagne refusent de reconnaître celui-ci au profit du roi Ferdinand VII alors quasi-prisonnier de l’Empereur, et l’ensemble des possessions américaines leur emboîte le pas. La période qui s’ouvre est déterminante : la péninsule envahie par les armées françaises, le semblant de représentation nationale réfugié dans Cadix assiégée, ses maladresses quant à l’association des possessions espagnoles, la diffusion des idées progressistes, en particulier via la Constitution de 1812, tout concourt à une progressive autonomisation de l’empire et à un raidissement des rapports entre conservateurs et libéraux.
S’ouvre alors le temps de « la guerre civile américaine » (2ème partie, p.121-209). Le Venezuela connaît à partir de 1810 deux républiques avant une meurtrière reconquête royaliste en 1814, l’ensemble laissant le pays dévasté. Après l’ère de « La Patria Boba » (« la patrie niaise ») qui voit fédéralistes et centralistes se déchirer, la Nouvelle-Grenade (aujourd’hui Colombie, Equateur, Panama et une partie du Venezuela) est pareillement reprise en main par les loyalistes en 1816, tout comme l’éphèmère Etat de Quito, et le Chili, où la junte autonomiste est finalement vaincue en octobre 1814, clôturant l’époque de « La Patria Vieja » (« patrie héroïque »). C’est un sort auquel échappe le Rio de la Plata, autonome depuis la « Révolution de Mai » (1810), mais non sans de sérieuses dissensions régionales. Dans l’immense et riche Nouvelle-Espagne, les vices-rois Venegas et Calleja écrasent les révoltes successives d’Hidalgo et de Morelos au prix d’un autoritarisme mal supporté par les créoles.
Derrière « le masque de Ferdinand VII »
Dans ce contexte, le retour du roi en Espagne en mars 1814 va précipiter « la perte de l’Amérique » (3ème partie, p.211-326). Depuis quatre ans, tous ou presque se sont réclamés de ce commode absent, et attendent de lui qu’il associe la légitimité de la monarchie à un système politique représentatif moderne. Mais, incapable de tirer des leçons des années écoulées, Ferdinand VII impose un absolutisme réactionnaire complètement dépassé. Aux mouvements insurgés et autonomistes qui persistent au Nouveau-Monde, il oppose la force, envoyant (difficilement) « l’expédition pacificatrice » de Morillo définitivement reprendre en main les possessions septentrionales. Cette sévère répression entraîne un regain d’hostilité envers la monarchie et l’Espagne, transformant le conflit en une guerre patriotique, nourrissant libéralisme et républicanisme. Après bien des péripéties, Simon Bolivar parvient à imposer la république en Nouvelle-Grenade en 1819 ; dès 1816, les Provinces-Unies de la Plata l’ont précédé, prélude à un long et anarchique chemin vers les actuels Argentine, Uruguay et Bolivie. Au Chili, l’armée des Andes méticuleusement préparée par San Martin assure définitivement l’indépendance par sa victoire de Maipu (5 avril 1818). L’éphémère révolution espagnole (1820-1823) complique encore la position des royalistes ; Bolivar en tire profit pour libérer l’essentiel du Venezuela, puis de l’Equateur. Tous les efforts se tournent vers le Pérou, bastion loyaliste menacé par San Martin depuis 1820. Celui-ci s’étant effacé devant Bolivar lors de l’entrevue de Guayaquil (juillet 1822), c’est Sucre, le meilleur lieutenant de ce dernier, qui remporte la bataille décisive d’Ayacucho (9 décembre 1824), détruisant la dernière armée royale présente au Nouveau-Monde. Entretemps, Iturbide a proclamé l’indépendance du Mexique avec pour monarque théorique un membre de la famille royale d’Espagne, auquel il tente sans succès de se substituer ; la constitution de 1824 met en place une république fédérale qui s’avère instable et dont s’émancipe aussitôt l’Amérique centrale. Les particularismes régionaux de celle-ci aboutiront, après de nombreux conflits internes, à la création des Etats du Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa-Rica à la fin des années 1830. C’est par l’examen des sorts particuliers de Cuba et Porto-Rico (restés fidèles à l’Espagne et qui jouent le rôle de « têtes de pont » de celle-ci pendant toute la période), de Santo Domingo (annexé par Haïti jusqu’en 1844) et du Brésil lusophone (qui s’émancipe sous le règne de l’héritier de la couronne portugaise) que l’auteur clôt ce très riche exposé.
Sa conclusion (p.327-334) revient sur les « lendemains difficiles » de cette émancipation maintenant acquise : née, contrairement à ce qui sera ensuite prétendu, de la disparition du pouvoir métropolitain puis de son incapacité à gérer les évolutions en cours, et non d’une révolution libérale irrésistiblement issue des Lumières, elle laisse derrière elle de nouveaux Etats et une Espagne mal préparés, appauvris économiquement et instables politiquement qui n’émergent réellement en Etats-nations qu’à la fin du XIXè s., bien trop tard pour rattraper l’avance prise par les grands Etats européens (Grande-Bretagne, France, Allemagne…) et les Etats-Unis.
D’évidence, Gonzague Espinosa-Dassonneville livre ici un travail très complet. On peut se demander ce qu’il serait advenu de l’Amérique espagnole sans la crise de 1808, mais l’auteur développe une synthèse très convaincante, qui embrasse tous les aspects (politiques, sociaux, économiques…) de la question et se développe avec finesse. La complexité des évolutions rapportées est le reflet de celles des événements et de leurs protagonistes, et le texte, bien structuré, appuyé sur de nombreuses notes et quelques cartes, sait rester suffisamment clair et pédagogique. La bibliographie est riche, et repose à la fois sur des documents d’époque (journaux, mémoires, correspondances) et des études, le tout faisant largement appel aux sources hispanophones.
On ne saurait donc que trop recommander la lecture de cet ouvrage qui vient combler un réel manque dans l’historiographie francophone, guère prolixe sur ce thème. A ceux qui ne le connaissaient qu’à travers des publications plus générales ou la figure spécifique des Libertadors (l’auteur de ces lignes ne pourra s’empêcher de renvoyer ici au formidable album du même nom consacré avec brio à Bolivar par Antonio Hernandez Palacios et Jean-Pierre Gourmelen, les immortels auteurs de la série Mac Coy, chez Dargaud en 1987, et à la visite de la Casa San Martin, étonnant morceau de terre argentine situé à Boulogne-sur-mer), il apportera un solide et utile éclairage.