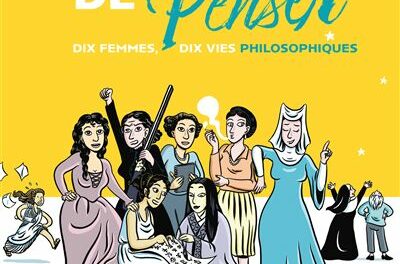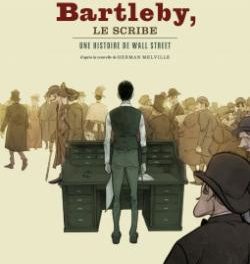De quoi s’agit-il ? Les auteurs font s’interroger deux moments de l’histoire des États-Unis : la guerre de Sécession qui s’amorce, avec la déclaration d’indépendance ; la seconde guerre mondiale. Un lien existe entre les deux : l’assujettissement (et la réification) des Noirs américains et le mouvement de leur émancipation qui s’amorce. Pour rendre ce lien plus explicite encore, les auteurs ont choisi un symbole qui se révèle particulièrement pertinentQue l’on peut indiquer, puisqu’il apparaît très clairement en quatrième de couverture, à savoir le premier drapeau de la jeune nation qui naît en 1776. Celui-ci a été cousu par Mrs Betsy Ross, tout juste veuve de guerre, à la demande de George Washington. Mais la domestique noire de celle-ci, Angela Brown, a inséré une étoile noire à l’intérieur d’une étoile blanche, façon de montrer symboliquement que la construction des États-Unis ne pourra se faire sans les Noirs (il n’est pas question des populations amérindiennes). On perd ensuite la trace du drapeau, dans des circonstances que je ne raconterai pas, mais celui-ci (s’il s’agit bien de lui) ressurgit dans les années trente, en Europe.
La bande dessinée s’ouvre toutefois sur les principaux protagonistes de l’histoire : Lincoln BoltonOn mesure bien le symbole que revêt le choix du prénom., Tom Conor, Aaron Johnson. Ces trois soldats noirs sont dans l’un des camps du sud-est de l’Angleterre, à l’approche du débarquement ; ils savent qu’ils ne participeront pas aux opérations de combat, alors qu’ils se sont engagé pour défendre leur pays, et qu’ils resteront cantonnés à des tâches subalternes, commandés par des Blancs. On les devine amers, et ils le sont. S’ils sont dans l’armée américaine depuis décembre 1941, ce n’est certainement pour nettoyer des latrines ; ils estiment que leur participation active doit conduire l’État américain à mieux les reconnaîtreOn a un propos identique dans un certain nombre d’œuvres, comme le film de Rachid Bouchareb, Indigènes, sorti en 2006..
L’un d’entre eux, Lincoln, reçoit une lettre de sa sœur, Johanna Bolton, étudiante en histoire à Raleigh (Caroline du Nord). Il apprend ainsi qu’elle a hérité de différentes choses de sa tante, Camilla Brown, dont le journal rédigé en 1777 par Angela Brown. Le récit lui révèle l’existence de cette fameuse étoile noire insérée clandestinement dans le premier drapeau américain, celui-là même que George Washington présenta aux émissaires des États colonisés, unis contre l’Angleterre. Rien ne permet d’étayer cette histoire, mais l’idée de récupérer l’un des emblèmes fondateurs des États-Unis leur paraît suffisante pour s’impliquer dans sa recherche. Différentes manœuvres sur le pouvoir permettent au trio de rejoindre une unité spéciale, chargée de retrouver les œuvres d’art volées par l’Allemagne nazie. Sa mission sera donc de retrouver le drapeau, en progressant au rythme des armées libératrices. On traverse ainsi Saint-Lô totalement ravagée, Paris, et on se retrouve en décembre 1944 dans les Ardennes belges, du côté de Malmédy et Bastogne.
Ainsi résumée, l’histoire a tout de la fiction. Ce serait oublier que des groupes spéciaux furent effectivement mis en place par les Alliés, pour remplir des missions très particulières : enquêter sur les crimes commis, sur l’industrie aéro-spatiale du régime nazi, ses avancées en matière nucléaire, etc. Mais au-delà de ce récit, l’accent est surtout mis sur la ségrégation qui sévissait alors pleinement, aussi bien aux États-Unis même qu’au sein de ses armées. La bande dessinée s’ouvre sur la phrase prononcée par Martin Luther King en conclusion de la grande marche à Washington, en août 1963 : « I have a dream today ». Cette phrase pourrait être le principe de vie de bon nombre de personnages de l’histoire : chacun se bat à sa manière pour améliorer le sort de la population noire, que ce soit à l’université, dans les combats, dans les organisations militantes, etc. Les trois combattants ont ainsi pour projet de remettre le drapeau retrouvé au président Roosevelt. Si celui-ci a négligé de serrer la main de James Owen, après ses victoires aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, il sera alors bien obligé de la tendre pour recevoir le trophée.
L’imparfait que j’utilisais pour évoquer de la ségrégation n’est pas de mise : la violence des rapports dont les auteurs nous rendent spectateurs n’a pas disparu, si l’on se réfère aux assassinats gratuits perpétrés par des agents de police, jamais réprimésToutes proportions gardées, la situation de certaines autres « démocraties avancées » ne laisse pas d’interroger. Quatre-vingt-neuf cas d’usage illégal de la force par des membres des forces de l’ordre en France, entre 2007 et 2015, ont provoqué la mort de vingt-six personnes, appartenant essentiellement à des « minorités visibles » ; une seule condamnation à de la prison ferme pour leurs auteurs, quand bien même ils ont été reconnus coupables.
Source : rapport de l’ONG ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), 14 mars 2016.. Les pouvoirs traitent avec désinvolture l’adage de Thucydide, selon quoi « de toutes [ses propres] manifestations, celle qui impressionne le plus les hommes, c’est la retenue ».
Le scénario très fluide permet de s’insérer dans l’histoire : ce ne sont pas les quelques va-et-vient chronologiques qui en gênent la compréhension. Les perfectionnistes seront attentifs aux moindres détails dessinés par Steve Cuzor. On s’étonne seulement de voir les soldats, américains ou allemands, évoluer dans les Ardennes enneigées et au moment d’un hiver particulièrement rigoureux, avec de simples vestes de combat, comme il s’en porte en été. Mais ce n’est qu’un détail, perdu dans un travail d’une grande qualité : les portraits insérés entre les différentes parties suffiraient à se convaincre du talent de Steve Cuzor. La simplicité des couleurs utilisées en plus de l’encre noire des dessins renforcent l’insertion du lecteur dans le récit : du vert (comme en couverture), du rouge, etc., mais toujours des couleurs froides qui accentuent le poids qui semble peser sur les épaules des héros.
On regrettera, s’il faut vraiment verser dans l’acrimonie, l’utilisation de quelques rares expressions anachroniques : un « bar » est évoqué (p. 37), ou, dans un registre psychologisant, Angela Brown qui devait « poser un geste » (p. 51). Ou encore les phrases en allemand prononcées par l’un des trois combattants, mais ma maîtrise de cette langue n’est pas suffisante pour m’en assurer totalement.
Quoi qu’il en soit, cela n’altère en rien le souci qu’ont eu les auteurs de s’appuyer sur une documentation sérieuse, que l’on peut difficilement prendre à défaut.
–