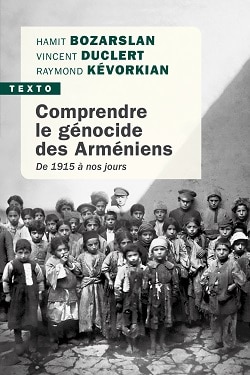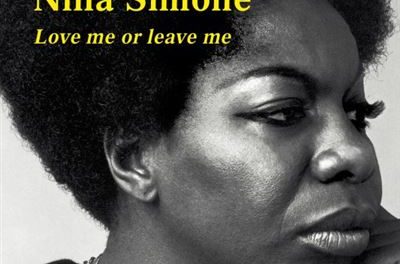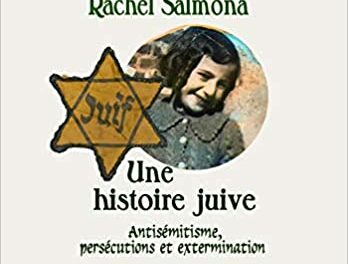Dans cet ouvrage, publié aux éditions Tallandier en 2015 et remis à jour en 2022 dans la collection « Texto », Hamit Bozarslan, Vincent Duclert et Raymond Kévorkian unissent leur talent afin de nous offrir une somme magistrale ainsi qu’une synthèse rigoureuse et très complète sur le génocide des Arméniens perpétré dans l’empire ottoman.
C’est une véritable enquête au cœur de la recherche actuelle sur un des évènements qui inaugure le XXe s., l’« âge des génocides » (Samantha Power). Ce livre fait bien-sûr écho à l’actuel tournant répressif du régime du président Erdogan (criminalisation, purge et arrestation de la dissidence intellectuelle) et à la participation de la Turquie à l’offensive de l’Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabagh en 2020. Fort heureusement, la recherche historique sérieuse se poursuit (principalement à l’étranger). Ce livre en est un très bel exemple !
L’introduction est une synthèse brève mais rigoureuse du reste de l’ouvrage. La première partie, rédigée par Raymond Kévorkian, fixe le cadre chronologique en traitant du contexte ottoman et du déroulement du génocide. Hamit Bozarslan, dans une seconde partie, s’occupe des questions portant à la fois sur le temps long et le temps court : la « trahison » arménienne, le darwinisme-social, les acteurs de la destruction, le lien entre unionisme et république kémaliste, … Enfin, Vincent Duclert se charge de replacer la « question arménienne » dans un cadre européen et mondial. Des notes nombreuses et précieuses ainsi que des annexes (tableaux chiffrés, chronologie, glossaire, notices biographiques, bibliographie) viennent clôturer cet ouvrage.
Premiers symptômes des violences de masse : l’époque hamidienne
Après le congrès de Berlin de 1878, les spoliations et le poids de l’impôt ont pour conséquence la paupérisation, l’exode rural, l’émigration et la conversion à l’islam d’une partie de la population arménienne vivant dans l’empire. En 1891, le sultan Abdülhamid II fait suspendre la constitution nationale arménienne de 1863 et dissout l’Assemblée nationale du millet. Il instaure une milice tribale kurde, les régiments hamidiye, qui permet de réprimer et de contrôler les régions de l’Est par les meurtres, les pillages et les spoliations. Ainsi, le sultan espère la fidélisation voire la soumission d’une nouvelle génération de chefs tribaux. Les grands massacres hamidiens de 1894-1896 vont confirmer la nature tyrannique du régime d’Abdülhamid II. La désobéissance face à l’impôt des populations arméniennes dans les massifs montagneux du Sassoun est alors qualifiée de « soulèvement » et semble justifier l’envoi de l’armée. Une centaine de villages sont ravagés et plus de 7000 Arméniens sont massacrés. La manifestation du parti arménien social-démocrate Hentchak est réprimée à Constantinople faisant plusieurs milliers de morts. D’autres massacres ont lieu à Trébizonde puis dans toute l’Asie Mineure, ils font 250 000 victimes pour la période 1894-1896.
Radicalisation et darwinisme social : l’arrivée au pouvoir du CUP (Comité Union et Progrès)
En 1908, la « révolution » porte au pouvoir le CUP qui a déjà largement marginalisé les autres groupes jeunes-turcs plus libéraux et a glissé d’un « ottomanisme de façade vers un nationalisme turc exclusif ». Le régime unioniste va réussir à détruire tout mécanisme de contrôle et d’équilibre des pouvoirs avec un système de parti unique et de contrôle de tous les rouages de l’État (le monarque Mehmed V, le Parlement et le Premier ministre n’ont pas/peu de marge de manœuvre) incarné par le triumvirat : Talât, Enver et Cemal. Ils imposent le modèle d’un état centralisé et ethniquement ou du moins confessionnellement homogène en développant les thèses du darwinsime-social. A la fois science (à même de charmer les médecins militaires du Comité comme Nazim !) et mécanisme naturel (le lion mange bien l’agneau et aucun juge ne le lui reprochera !), il est érigé en véritable doctrine. Les sociétés humaines sont vues comme des entités biologiques engagées dans une guerre à mort pour leur survie. La guerre s’est alors « déplacée du contrôle des espaces à celui des espèces ». Les chrétiens sont considérés comme des « microbes » rongeant de l’intérieur la communauté musulmane. Il faut donc exclure ces « corps étrangers ». Cette doctrine permet l’invention d’un univers romantique basé sur la constitution d’une « race des vainqueurs ». Elle exige la création d’une communauté fraternelle, disciplinée, sans pitié qui devra accomplir une mission que le « destin » leur a confié. Dans ce contexte, où islam et turcité se confondent pour se renforcer mutuellement contre les minorités, la diffusion de rumeurs qui voudraient que les Arméniens préparent une révolution va justifier les massacres de 1909 en Cilicie causant la mort d’environ 25 000 Arméniens.
Entre continuité et rupture, des logiques opératoires qui annoncent la destruction ?
Pour les auteurs de l’ouvrage, ces persécutions et massacres sont les révélateurs de la violence latente de la société ottomane et des menaces qui pèsent sur les non-musulmans. La pression fiscale, les spoliations (terres, êtres humains, razzias de femmes et d’enfants) sont suivies de persécutions qui semblent suivre un même modèle opératoire : fausses rumeurs, réunions préparatoires des notables, rôle d’incitateur joué par le clergé (prêches dans les mosquées pour exterminer les chrétiens), participation aux violences des populations urbaines et rurales, emprisonnement et exécutions des élites, commerces pillés et incendiés, … Un lien existe donc entre l’acte génocidaire et les violences de diverses natures à l’encontre des populations arméniennes durant les vingt ans qui précédent la Première Guerre mondiale. Cette période, par la légitimation de la violence par les dominants, ses logiques opératoires et la stigmatisation collective des Arméniens, sont les symptômes des violences et des crimes de masse à venir. Mais, si le génocide s’est produit dans une société où la stigmatisation des communautés chrétiennes était quasi institutionnalisée, rien n’indiquait clairement que la communauté arménienne se trouvait à l’aube d’une opération d’extermination pure et simple. Par exemple, les pogroms visant principalement les hommes et les biens matériels se distinguent d’une élimination systématique de la population. L’unionisme est à fois la continuité du hamidianisme (tout en le radicalisant à l’extrême) et une rupture portée par un « jeunisme » capable d’abattre en quelques mois les structures d’un pouvoir ancien.
La guerre et la « trahison » : justifications et accélérateurs des violences de masse
Avec les défaites et les pertes territoriales lors des guerres des Balkans (1912-1913), le CUP continue de se radicaliser notamment sur le question arménienne. A ce moment, la guerre offre le contexte propice à la destruction des éléments non turcs afin de produire l’homogénéisation ethnique à l’échelle de l’empire indispensable à sa survie et à la construction d’un État-nation turc fort. La « trahison arménienne » aurait menacé la sécurité intérieure et affaibli l’armée ottomane en guerre. Ce concept de « trahison » a servi à légitimer tous les génocides, de la Shoah à celui des Tutsis au Rwanda. Cette responsabilité du crime commis par un ou des individus s’étend à la communauté puis se propage à l’ensemble d’une religion ainsi racialisée. Aussi, pour Talât, « ceux qui sont innocents aujourd’hui, peuvent être coupables demain ». D’après l’historien Taner Akçam, dès le mois d’avril 1914, un premier premier plan de nettoyage de l’Asie Mineure contre les Grecs et les Arméniens est discuté. En mai-juin 1914, Enver Pacha organise des réunions secrètes visant à planifier l’« élimination des masses non turques » et le nettoyage des « tumeurs internes » à déporter vers la Syrie et la Mésopotamie mais pas encore à exterminer. Dès le mois d’août 1914, un traité lie le sort de la Sublime Porte et de l’Empire allemand, l’entrée en guerre se fait le 29 octobre 1914. A partir de là, des massacres ont lieu dans les zones frontalières (7000 morts avant Sarikamis) et dans l’Azrbaïdjan iranien (21 000 victimes chrétiennes de décembre 1914 à février 1915). La débâcle de Sarikamis (décembre 1914 – janvier 1915) radicalise encore plus la politique intérieure du gouvernement unioniste. Il est nécessaire de justifier le désastre militaire sans questionner les responsabilités du commandement ottoman. La presse se déchaîne alors contre les « ennemis intérieurs » et particulièrement les Arméniens qui seraient des agents au service de l’ennemi. Cette théorie du complot va à nouveau servir de légitimation aux violences existantes et celles à venir.
Planification, décision et phases de l’acte génocidaire
En février 1915, les soldats arméniens mobilisés, accusés de désertion et de traîtrise, sont désarmés puis assassinés. Pour les auteurs du livre comme pour l’historien Vahakn Dadrian, ceci constitue la première phase de la destruction. D’après Hamit Bozarslan, une réunion au sommet a lieu à Istanbul le 26 février 1915 autour notamment de Talât et du docteur Nazim. Si aucun procès verbal n’est resté de la réunion, de nombreux historiens estiment cependant qu’elle est celle où « la pratique exterminatrice déjà lancée est érigée en projet commun et prioritaire », comme lors de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. La « révolte » arménienne de Van (20 avril 1915) sert de justification ultime au déclenchement du plan d’extermination. Autour du 22 avril 1915, au cours de plusieurs réunions du Comité central unioniste, le lancement de l’extermination est décidé.
▪ La première phase de destruction : déportations et massacres et marches de la mort (1915)
L’arrestation des élites intellectuelles, politiques, économiques et religieuses dans les villes de l’Empire commence dans la nuit du 24 au 25 avril 1915. Ils sont transférés puis assassinés quelques semaines plus tard (la tête fracassée bien souvent) par les membres de l’OS (Organisation Spéciale). Dans le même temps, l’organisation de procès politiques contre les hentchakistes donne une impression de légitimité judiciaire aux évènements. En mai-juin 1915, les hommes sont arrêtés et assassinés dans des endroits isolés par des membres de l’OS à la hache ou par des noyades collectives dans les eaux du Tigre et de l’Euphrate. La loi de déportation du 26 mai 1915 donne l’apparence d’une action légale mais ne vient qu’entériner des opérations déjà commencées principalement dans les provinces orientales. Le 21 juin 1915, un nouvel ordre du ministre Talât à tous les vilayets ordonne de déporter tous les Arméniens (plus question ici de zones frontalières à protéger !). Les déportations commencent dans les 6 vilayets orientaux, terroir historique des Arméniens, puis s’étendent à l’Anatolie, à la Thrace, à la Cilicie … Femmes, enfants et vieillards sont exterminés en cours de route selon le principe de la sélection naturelle ou assassinés par les tribus kurdes locales. Le long des routes, des « sites abattoirs » tenus par l’OS permettent d’égorger puis de jeter les cadavres dans les fleuves. Certains captifs sont parfois brûlés vifs afin que les miliciens récupèrent dans les cendres les objets ingurgités.
▪ La deuxième phase de destruction : dans les camps de Syrie et de Mésopotamie (1916)
A partir d’octobre 1915, la Direction pour l’installation des tribus et migrants ouvrent une vingtaine de camps en Syrie et en Mésopotamie. Ils suivent trois lignes ferroviaires comme celle de Meskene à Der Zor. Dans ces « lieux de la relégation », les conditions sont terribles : les maladies, les températures extrêmes, les scènes allant jusqu’à l’anthropophagie, … Après la prise d’Erzerum par les Russes, Talât ordonne la liquidation des derniers Arméniens le 22 février 1916. Ceci entraîne les déportations des groupes maintenus (catholiques, protestants, artisans, pharmaciens, médecins, …). Au camp de Ras ul-Ayn, à partir du 17 mars 1916 et en 5 jours, 40 000 internés encore présents sont égorgés par les Tchétchènes de l’OS. Puis, c’est au tour des camps situés sur la ligne de l’Euphrate d’être « nettoyés ». A Der Zor, de juillet à décembre 1916, 192 750 déportés sont assassinés par les Tchétchènes de Ras ul-Ayn. Aussi, le 24 octobre 1916, 2000 orphelins regroupés à Zor sont noyés deux par deux dans l’Euphrate.
Acteurs et rouages de la destruction
Les auteurs déclinent et décrivent les différents acteurs des crimes. Le Comité Union et Progrès contrôle tous les leviers de l’administration. Il n’est pas un État dans le sens légal ou constitutionnel du terme car l’administration est soumise à la volonté d’un « cartel » : Talât (ministre de l’Intérieur), Enver (ministre de la Guerre) et Cemal (ministre de la Marine). Ce cartel dure par sa capacité à diviser et à assurer la cohésion autour de « la cause ». Une garde rapprochée est composée de jeunes officiers liés par des attaches familiale, générationnelle et de carrière. Les unionistes prêtent un serment au Comité. Chacun doit jurer de « servir le Comité ottoman d’Union et Progrès jusqu’au dernier souffle de sa vie pour protéger la liberté de la patrie et à tuer, de ses propres mains, toute personne osant œuvrer ou complotant contre lui ». Les exécutions ne sont donc pas immorales, sont même une arme légitime du pouvoir et peuvent donc s’accomplir sans états d’âme. Les différents ministères transmettent les ordres : l’Intérieur aux préfets, la Guerre aux commandants militaires et la Justice aux magistrats. Sur le terrain, les tâches sont réparties : la planification des opérations pour la Direction pour l’installation des tribus et migrants, les listes pour la police, l’encadrement pour la gendarmerie et la confiscation des « biens abandonnés » pour les services du Trésor. Les « secrétaires-responsables » délégués par le parti dans les provinces sont là pour pour organiser. Il est à noter que la bureaucratie, nommée pour l’essentiel par le Comité, suit dans son ensemble les injonctions. L’Organisation spéciale (fondée en 1911) est le bras armé du CUP, c’est un « État dans l’État ». Ses cadres sont, pour la plupart, des anciens criminels de droit commun ou des membres des tribus tcherkesses et kurdes. Les bandes de « brigands » et les milices tribales mobiles sont recrutées par l’État et travaillent sous ses ordres. Enfin, pour ce qui est de la participation des populations, on ne peut parler d’une participation spontanée aux massacres que parce qu’il s’agit d’une spontanéité sous licence de l’État.
Un enjeu européen et mondial : du XIXe s. au génocide, dénonciations et renonciations
Dès le XIXe s. et les premiers massacres jusqu’au génocide de 1915-1916, diplomates européens et américains (Henry Morgenthau, Leslie Davis, Jesse Jackson, …) dénoncent les crimes commis, les caractérisent et relèvent même l’intentionnalité de l’État ottoman au travers de multiples rapports. Aussi, des journalistes, des intellectuels et des parlementaires (Jean Jaurès) relayent ces informations très précises auprès de l’opinion. Cela pousse les gouvernements à faire pression sur la Sublime Porte afin de faire cesser les atrocités et de garantir les droits des minorités (ex : déclaration du 24 mai 1915 des trois puissances de l’Entente accusant le gouvernement unioniste de sa responsabilité dans le « crime de la Turquie contre l’humanité et la civilisation » et annonçant leur intention de poursuivre les responsables et les complices de ces crimes). Pour Vincent Duclert, « l’ingérence » européenne dans les affaires intérieures de l’Empire a pu se retourner contre les Arméniens car elle les expose à la vindicte turque sans leur offrir la moindre protection. Le pouvoir prend prétexte des nouvelles attentes de libération pour infliger de terribles représailles. L’Europe conforte les Arméniens dans leur espoir d’un avenir prospère et d’une égalité politique dans l’empire mais n’a aucune intention d’intervenir pour protéger. Mais des intérêts supérieurs, économiques et géopolitiques (sécuriser les futures zones d’influence au Proche et Moyen-Orient), sont radicalement opposés aux idéaux moraux affichés et vont empêcher toute intervention directe. Vincent Duclert souligne aussi un aveuglement international au lendemain des massacres de 1909 : nombreux sont ceux qui croient que la nouvelle révolution unioniste sera synonyme de libéralisation de l’Empire et que les massacres commis sont encore le fait de l’héritage hamidien.
Un enjeu européen et mondial : au lendemain de la guerre, l’abandon
Des espoirs arméniens d’indépendance, d’unité et de sécurité existent afin de réunir les territoires Arméniens du Caucase, d’Anatolie et de Cilicie en une « Arménie intégrale ». L’embryon de cet État se forme autour de la petit république arménienne héritière des provinces arméniennes de l’Empire russe qui a arraché son indépendance après la révolution bolchevique. Le traité de Sèvres (10 août 1920) confirme la souveraineté de la nouvelle République mais dans les limites de ses territoires. Ces espoirs vont s’évanouir rapidement du fait de la pression conjointe des bolcheviques, des Azéris et surtout des kémalistes. La SDN n’intervient pas et se contente de répondre par une résolution qui reconnaît une « sympathie universelle » pour l’Arménie. Le 18 décembre 1920, par le traité d’Alexandropol, Erevan reconnaît sa défaite face aux kémalistes, la perte de provinces et le renoncement au traité de Sèvres. La République finit par se soumettre à Moscou le 2 décembre 1920. L’Arménie est réduite à 20 000 km². Face aux offensives kémalistes, la France évacue la Cilicie ce qui va accélérer la reprise des massacres contre les Arméniens. L’accord franco-kémaliste du 20 octobre 1921 établit la première reconnaissance internationale du gouvernement d’Ankara et annonce le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923. Celui-ci ignore tout du génocide et de ses conséquences, il annule le traité de Sèvres, rejette toute idée de jugement pour des actes contraires au droit humain. De la même manière, la libération des personnes séquestrées et la restitution des biens spoliés prévues par le traité de Sèvres disparaissent. Les puissances signataires ont choisi la voie de du pragmatisme et des intérêts internationaux. Pour Vincent Duclert, le traité de Lausanne est l’acte fondateur de la République de Turquie dont le discours anti-arménien devient un élément constitutif de l’identité politique. Désormais, « l’extermination n’est pas un but en soi mais la politique anti-arménienne obéit au même objectif que le génocide, à savoir l’éradication de toute présence et de toute influence arménienne en Anatolie là ou est né et s’est érigé l’Etat-nation turc ». Transmis par les anciens cadres de l’extermination, des traits de racisme anti-arménien émergent dans l’idéologie kémaliste. Ils encouragent les nouveaux massacres (Smyrne en 1922) et organisent l’occultation du génocide qui se transforme en déni puis en négationnisme.
Effacement et reconstruction de l’histoire : le déni turc
Le kémalisme s’inscrit dans la continuité organique et idéologique de l’unionisme. Avec l’avènement du régime d’Atatürk en 1923, l’effacement historique de la destruction des Arméniens découle de la mise en place d’une doctrine historique qui établit la république sur un nationalisme étatique et ethniciste. Avec cette relecture et cette réécriture de l’histoire, les minorités ne peuvent plus avoir d’existence historique. Les Turcs auraient été trahis de l’intérieur par les peuples qu’ils administraient avec amour, le sursaut turc a été nécessaire pour se défendre. Mustapha Kemal est l’homme providentiel de ce sursaut mais cet homme de salut est un ancien jeune-turc et ses cadres politiques sont pour la plupart issus de l’unionisme. Jusqu’à aujourd’hui, cette tradition d’une contre-histoire est encadrée par l’État, la pression sociale et la répression étatique qui imposent le silence sur les faits voire une adhésion à une histoire « officielle ». La lutte contre cette historiographie « officielle » s’avère difficile tant celle-ci est ancrée. Elle vise à minimiser, relativiser voire occulter et ne cherche donc aucun dialogue avec l’immense littérature disponible désormais sur ce sujet. Les arguments sont souvent les mêmes : des « éléments incontrôlés » seraient à l’origine des massacres, les Arméniens seraient responsables du fait de leurs agissements contre la nation, les Turcs ont été eux-mêmes victimes d’exactions, les Arméniens devaient être déplacés loin des lignes de front pour être protégés, la « question arménienne » a été entièrement créée par des puissances extérieures et ennemies pour fragiliser la Turquie … Ces partisans de la négation récusent toute intentionnalité criminelle de l’État ottoman. Le cinéaste turc Atom Egoyan suggère que la « spécificité du génocide arménien ne réside pas dans la nature de ses atrocités, mais dans leur déni ». Le combat pour la reconnaissance du génocide est alors vu comme un complot contre l’identité nationale voire contre l’existence même de la Turquie.
Le nécessaire travail de l’historien afin de faire face au déni
Si la volonté génocidaire du gouvernement unioniste ne peut être attestée par un document infaillible (de nombreuses archives étant détruites par les dirigeants unionistes au moment de l’effondrement de l’Empire), le travail des historiens permet de mettre en lumière « des systèmes d’explication qui confrontent tous les faits et les inscrivent dans des contextes larges avec pour résultat la construction d’un continuum historique prouvant l’intention et la réalisation génocidaires ». Aujourd’hui, des études interdisciplinaires menées en Europe, aux États-Unis et depuis peu en Turquie se basent sur le recoupement de sources variées : les discours officiels des unionistes, les ordres de déportation, les témoignages des diplomates étrangers, des congrégations enseignantes, des organisations caritatives, des représentants des Églises protestantes, … Aussi, les procès de 1919-1920 permettent de réunir toute une documentation à charge (copies certifiées conformes des ordres reçus par les autorités locales), de recueillir des aveux de culpabilité qui dessinent les « contours d’un schéma génocidaire ». Les auteurs soulignent l’importance du dernier ouvrage de Taner Akçam qui en authentifiant les ordres explicites du meurtre donnés par Talât Pacha doit permettre de porter un coup de grâce aux thèses négationnistes (Ordres de tuer – Arménie, 1915. Les télégrammes de Talaat Pacha et le génocide des Arméniens).
Le combat pour la qualification de génocide
Dès la fin de la guerre, plusieurs initiatives laissent présager une reconnaissance rapide des crimes commis :
- en 1918, le sultan établit une cour martiale pour juger certains responsables de l’extermination. Le verdict final (1919) reconnaît la culpabilité des responsables du CUP (Enver, le docteur Nazim, …).
- lors de la conférence de la Paix émerge le projet d’un « Haut Tribunal » préparé notamment par les gouvernements français et britannique. Des juristes doivent étudier les « violations des lois et coutumes de la guerre et des lois de l’humanité ».
- les autorités britanniques qui administrent les zones d’occupation à Constantinople décident d’appréhender et de juger sans délai les responsables des massacres qui sont déplacés sur l’île de Malte (118 détenus dont 12 anciens ministres).
Mais face à l’avancée kémaliste la justice punitive laisse la place aux accommodements politiques (Vahakn Dadrian). Ces projets sont abandonnés. Finalement, « l’Europe a été incapable de s’opposer à un génocide largement prévisible, dont elle était informée précisément et dont elle a été, par sa passivité, un acteur central ». Pour Yves Ternon, c’est la « faillite d’une justice pénale internationale ». Par la suite, ce sont les travaux de Raphaël Lemkin afin de conceptualiser le génocide en s’appuyant sur l’extermination des Arméniens qui vont s’avérer décisifs. Il a suivi une démarche historique afin de conceptualiser l’action criminelle d’un État sur une population entière. Le génocide n’est donc pas à la base un concept juridique mais une élaboration historienne conduisant à une qualification juridique. Le terme, qui fait son apparition dans l’acte d’accusation du procès de Nuremberg (octobre 1945), est reconnu par l’Assemblée des Nations unies en 1946 puis est inscrit dans la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide le 9 décembre 1948. La reconnaissance officielle du génocide par les différents acteurs internationaux est finalement tardive avec le Parlement européen (1987) puis les Parlements russe (1995), grec (1996), belge 1998), suédois, italien et français (2001) et enfin allemand, britannique et polonais (2005). En France, l’étude du génocide arménien fait son entrée dans les programmes scolaires en 2012 (classe de 3e).