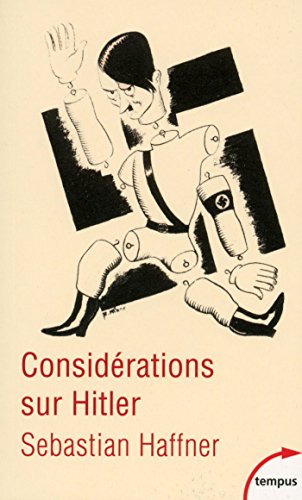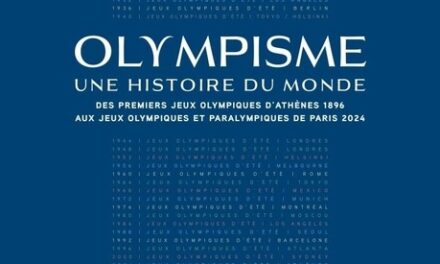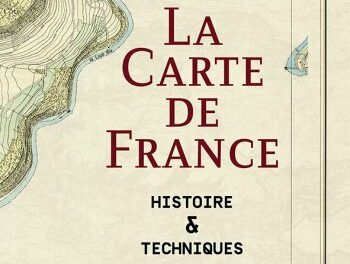Raimund Pretzel dit Sebastian Haffner (1907-1998), est un journaliste antinazi que l’exil (à partir de 1938) a momentanément anglicisé : c’est à titre de correspondant de l’Observer qu’il est revenu en Allemagne dans les années 1950, avant de trouver sa place dans la presse de RFA, à partir de 1961. Après plusieurs essais sur l’histoire allemande, c’est en 1978 qu’il livre sa vision du nazisme et surtout de son chef, par ses Anmerkungen zu Hitler. Cette synthèse bientôt traduite en français (Grasset, 1979) appréciée du public et des spécialistes, est la plus courte. Peut-être aussi la meilleure : celle qui tient ensemble le plus d’aspects du personnage, en les éclairant par les plus fondamentaux de ses propos. C’est aussi un bel objet d’histoire, dévoilant les acquis et les impasses de la recherche au moment de sa parution.
Haffner s’étend à peu près autant sur les côtés positifs et négatifs du personnage, tout en concluant à la domination et au triomphe des seconds. Son Hitler est un génie politique et militaire, qui a de ses mains gâché son œuvre. Mais si sa vie est divisée en quatre parties radicalement distinctes – trente ans d’obscure médiocrité, dix de ratages, dix de réussites éclatantes, cinq de gâchis et de destruction –, l’unité du personnage est aussi nettement affirmée que sa dualité. Le fin mot de l’aventure est la médiocrité de son héros. Ses succès ne sont obtenus que sur des moribonds – Weimar, la SDN, la France. C’est donc un charognard : si ses victoires s’expliquent par un sûr instinct politique, c’est celui « non de l’aigle, mais du vautour ». Ce qui suffit à le distinguer radicalement des grands Allemands, épris de durée et de continuité, que sont Luther, Frédéric II ou Bismarck, bref à l’éliminer radicalement de l’histoire allemande. Et l’auteur de gloser, d’autant plus lourdement que le reste de l’ouvrage ne comporte guère de répétitions, sur la volonté qu’il prête à Hitler de « détruire l’Allemagne ».
Par là, Haffner mérite une critique qu’on lui a rarement faite – les recensions défavorables lui reprochant surtout le ton trop laudateur de ses passages sur les « réalisations ». Il affirme en dépit d’informations contraires nombreuses et accessibles que Hitler ne préparait pas sa succession. Le comparant en particulier à Napoléon, Lénine et Mao, il note que tous trois s’étaient souciés de la transmission de leur héritage et il passe sous silence les dispositions prises dans le même sens, à plusieurs reprises, par Hitler. Il nie même farouchement qu’il y en ait eu. C’est, notamment, tenir pour un chiffon de papier son très dense « testament politique », dicté l’avant-veille de son suicide et promettant au peuple allemand, s’il savait maintenir les lois antisémites, des lendemains éclatants. Haffner, ennemi déclaré des historiens fonctionnalistes, leur fait le cadeau de pousser au paroxysme l’idée que le nazisme était un « hitlérisme » et que rien d’autre en Allemagne ne comptait, sinon une paralysie générale du sens critique devant les fameuses « réalisations ». Il pousse également à l’extrême, voire à l’absurde, l’idée que Hitler était double. Ainsi, l’antisémitisme serait une « bosse » cohabitant avec son sens politique comme un hostile voisin de palier.
En d’autres termes, Haffner concède que Hitler construit quelque chose, mais à peine l’a-t-il écrit qu’il s’empresse de préciser, sans l’expliquer, qu’il détruit d’une main ce qu’il a construit de l’autre. Si sa vie est une alternance de succès et de revers, les uns sont inscrits dans les autres, et si Haffner ne fait aucune allusion à l’histoire psychanalytique dont les hautes eaux sont contemporaines de son essai, la fascination de la mort et de la destruction est en filigrane presque à chaque page. Elle n’affleure guère qu’au chapitre sur le génocide. Hitler est assimilé à un serial killer : ses propos dits « de table » étaient pleins d’entrain à partir de 1942, en dépit des mauvaises nouvelles du front, parce que celui qui les proférait « pouvait désormais cultiver le plaisir du meurtrier qui abandonne toute retenue, tenant sa victime et pouvant en faire tout ce qu’il veut ».
En d’autres termes encore, Haffner s’approche de beaucoup de vérités (la psychose de Hitler, ses talents, sa centralité dans son propre régime) mais gâche sa synthèse par un certain nombre d’affirmations bien peu étayées : sa joie de tuer, sa haine des Allemands, son aspiration démente à la domination du monde…
Le caractère réaliste et raisonnable de l’offensive de mai 1940 et de ses buts (« la paix sur le sable de Dunkerque » -pour reprendre l’expression du général Jodl à Nuremberg-, plus que péniblement évitée par un Churchill jusque là bien en peine de convaincre ses compatriotes, et vierge dans la fonction de premier ministre) échappe complètement à l’observateur, qui ne pouvait certes bénéficier des apports des deux John, Lukacs et Costello (1990-91). Ils expliquent par des chemins différents que Hitler est alors passé tout près d’un succès durable, pour peu que l’Angleterre ait abandonné la lutte, et qu’elle en a été fort près. Au début de 2018, le film Darkest Hour et le livre homonyme ont pour la première fois popularisé ce constat, dont Haffner est on ne peut plus éloigné.
Mais Churchill est à peine mentionné dans l’ouvrage, et pas avant l’année 1944 !
Considérations sur Hitler
Sebastian Haffner
Perrin, 2014, 228 p., 17.90 €