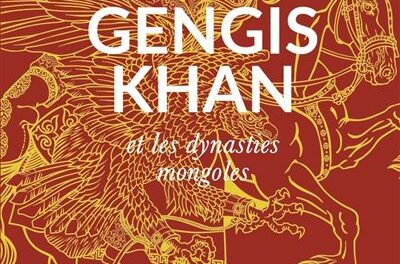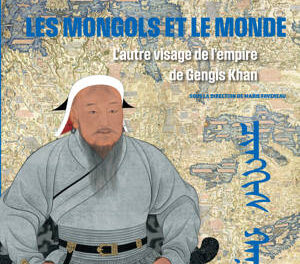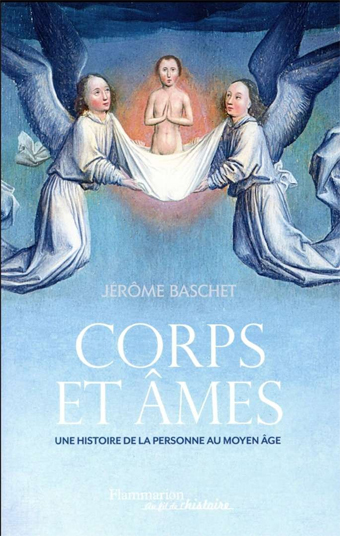
Le corps n’est pas une « prison de l’âme »
J. Baschet vise à démonter une des nombreuses idées reçues sur le Moyen Age, celle qui présente une opposition irréductible entre le corps et l’âme, un dualisme qui aurait été source de mépris pour le corps, véritable prison de l’âme pour reprendre une métaphore courante. Bien au contraire, nous dit J. Baschet dans le chapitre initial (« Âme et corps : une dualité non dualiste »), il faut envisager une articulation positive de l’âme et du corps. Certes, dans la lignée du néoplatonisme, une « pesanteur dualiste » est présente, particulièrement dans la spiritualité et la culture monastique du haut Moyen Âge. Mais, les XIIe-XIIIe siècles constituent une période de basculement : la dynamique anti-dualiste s’impose chez tous les théologiens, qui promeuvent une union positive entre l’animique et le somatique, comparée à une « harmonie musicale » par Hugues de Saint-Victor ou un lien d’amitié par Pierre Lombard. C’est avec Thomas d’Aquin que l’unité psychosomatique de la personne est affirmée le plus fortement. Ainsi, « les conceptions médiévales sont fondamentalement duelles mais non dualistes ». L’examen des conceptions du péché des Pères de l’Église aux scolastiques est un bon révélateur de cette dynamique. Augustin rend l’âme responsable du péché original ; Cassiodore ou Grégoire le Grand considèrent que l’âme a autant de responsabilité dans le péché que le corps, et distinguent plus de vices spirituels que de vices charnels (luxure ou gloutonnerie). Aux XIIe-XIIIe siècles, les théologiens accusent désormais l’âme d’être à la source de tous les maux, en particulier le péché d’orgueil.
Dans le second chapitre (« Spirituel et corporel : un modèle social »), l’auteur en vient à démontrer en quoi cette logique anti-dualiste était nécessaire à l’Église pour justifier sa position dominante dans la société. Ainsi, la relation entre matériel et spirituel renvoie à l’opposition complémentaire entre laïcs et clercs, au cœur de ce qu’il est convenu de nommer la « réforme grégorienne », les premiers en charge de la reproduction physique de la société, les seconds de sa reproduction spirituelle grâce au baptême. Ainsi, l’institution ecclésiale est-elle en charge de spiritualiser le corporel, à travers les sacrements, point nodal de la réforme. On comprend mieux dès lors l’enjeu que revêtait toute contestation de l’articulation entre corporel et spirituel. L’auteur évoque ainsi le danger que représentaient les hérésies qui prônent une séparation totale de l’âme et du corps (p. 79-82). Remarquons que les lectures plus récentes de l’hérésie médiévale viennent appuyer la pensée de l’auteur. Les prétendues croyances « hérétiques » nous sont parvenues uniquement à travers des sources antihérétiques et inquisitoriales, par nature très biaisées : il y a de fortes chances que l’émergence du dualisme soit un fantasme propre aux clercs, qu’ils connaissaient depuis les écrits patristiques et qu’ils projetaient sur leurs accusés. Cela renforce les propos de l’auteur, pour qui la répulsion pour le dualisme est liée aux efforts de l’Église pour légitimer son ancrage dans le matériel. Il faudrait aussi relativiser, dans ce contexte, la place des « cathares », que l’auteur, à la suite d’une longue et tenace historiographie, considère comme les tenants d’une pensée dualiste aux XIIe-XIIIe siècles. Uwe Brunn (que l’auteur cite d’ailleurs en note) a pu démontrer que le terme, peu utilisé au Moyen Âge et jamais dirigé contre des groupes du Midi, est une invention du moine Eckbert de Schönau dans les années 1160 à Cologne. Je renvoie ici à l’excellent dossier intitulé « Hérésie et inquisition », paru la revue Religions et histoire, n° 46, 2012, ainsi qu’au dossier « Les cathares, comment l’Église a fabriqué des hérétiques », L’Histoire, n° 430, décembre 2016.
Le troisième temps de la démonstration considère la distinction des sexes dans son rapport avec la dualité corps-âme, au sein de l’anthropologie chrétienne médiévale (« Masculin et féminin. Dualité de la personne et distinction de sexe »). Et de nouveau, l’auteur montre qu’il faut dépasser un préjugé selon lequel la chair serait associée à la femme, perpétuelle Ève, et l’âme à l’homme. Quant bien même on observe une distinction hiérarchique entre masculin et féminin depuis le mythe fondateur de la Genèse, cette domination ne concerne que les corps. « L’âme est dépourvue de sexe » nous rappelle Augustin, relayé par Thomas d’Aquin, puisque l’homme et la femme sont à l’image de Dieu. Ils dépassent ainsi la vision de saint Paul pour qui seul l’homme est à l’image de Dieu, justifiant au passage l’obligation du port du voile pour les femmes ! Plus globalement, la conception de la femme rapportée dans la Genèse conforte le caractère monogame et indissoluble du mariage, de même qu’elle est au fondement du lien social, puisque « la stricte unicité de l’origine est donc le fondement de l’unité présente de la société des hommes » (p. 109).
Quand l’iconographie révèle l’âme et l’au-delà
La deuxième partie de l’ouvrage accorde une place substantielle à l’iconographie, ce qui n’a rien de surprenant quand on connaît les travaux de Jérôme Baschet depuis 25 ans. Depuis sa thèse sur les représentations de l’enfer en Italie et en France du XIIe au XVe siècle, l’image médiévale a toujours été au cœur de ses réflexion. L’iconographie médiévale (2008) constitue à cet égard un ouvrage de référence à dimension méthodologique, qui alterne réflexions théoriques et étude de cas. Dans Corps et âmes, de lumineuses analyses iconographiques égrènent les trois chapitres consacrées aux représentations de l’âme, aux lieux de l’au-delà et aux jugements : certaines sont fondées sur la méthode sérielle, d’autres étudient l’invention de motifs originaux et parfois leur disparition.
Le chapitre 4 (« Donner corps à l’âme : variations et paradoxes figuratifs ») cherche à comprendre le choix de la représentation de l’âme sous la forme d’un corps. Alors que d’autres solutions iconographiques existaient, par exemple la représentation de l’âme comme un oiseau (y compris pour représenter l’âme du Christ, ce qui pouvait introduire une confusion avec l’image de l’Esprit saint), c’est pourtant le motif somatomorphe – de la corporéité de l’âme – qui s’imposa. Si l’âme est fréquemment représentée comme un petit enfant nu, par exemple lors de la sortie de l’âme par la bouche au moment de la mort, elle peut aussi être de grande taille, surtout à l’époque romane. Au paradis, ces êtres nus s’assemblent dans le sein d’Abraham, motif dominant jusqu’au XIIIe siècle, avant que la cour céleste n’en vienne à le supplanter à la fin du Moyen Âge, comme dans le Couronnement de la Vierge d’Enguerrand Quarton, du milieu du XVe siècle, conservée à Villeneuve-lès-Avignon. En enfer, ce sont des corps nus, sexués et de grande taille qui sont torturés. Quant au purgatoire, il est le lieu d’une métamorphose du corps sexué en corps vêtu, enfantin et asexué, à l’occasion du passage de l’âme vers le paradis. Car l’âme montrée habillée représente le corps glorieux des saints. Ainsi, l’âme se voit le plus souvent représentée comme un corps en réduction : la reproduction de la physionomie du corps et du visage signifie que « les traits corporels peuvent être conçus comme une expression de la qualité de l’âme et de ses mouvements » (p. 167).
C’est au destin de l’âme après la mort et à ses représentations qu’est consacré le chapitre 5 (« Les lieux de l’au-delà : une petite révolution dans le monde des âmes »). De l’Antiquité tardive au XIIe siècle, la théorie de la dilation, selon laquelle le sort définitif de l’âme n’est connu qu’à la fin des temps, s’impose dans la réflexion théologique. Il faut attendre le second quart du XIIe siècle pour qu’apparaisse l’innovation fondamentale (une « petite révolution théologique » pour J. Baschet) d’un jugement personnel immédiatement après la mort, preuve supplémentaire du caractère anhistorique des doctrines chrétiennes. Dès lors, les âmes peuvent être localisées et se trouver dans des lieux matériels, à la différence de Dieu qui seul demeure illocalis. À la fin de ce même siècle, une topographie de l’au-delà se met en place, divisée entre enfer et paradis, cependant qu’un troisième lieu dédié à la purgation des âmes apparait dans les années 1170-1180, comme l’a montré Jacques le Goff dans La naissance du Purgatoire. Enfin, la Somme théologique de Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, fixe le système scolastique des cinq lieux de l’au-delà, intégrant le limbe des enfants et le limbe des Pères. L’auteur effectue plusieurs remarques d’importance en relation avec cette configuration nouvelle de l’au-delà. La polarisation de l’espace céleste fait écho à la conception géographique dominante du monde féodal, organisé non comme un espace continu, mais comme un réseau de lieux dominants, parmi lesquels l’institution ecclésiale valorise édifices du culte et cimetières. Ainsi, les deux parties de la personne défunte sont-elles clairement localisées ici-bas et dans l’au-delà, ce qui ne peut qu’encourager les vivants à faire bénéficier aux âmes de leurs proches, inhumés autour ou dans l’église, des bienfaits des suffrages cléricaux. Au final, cette « petite révolution dans le monde des âmes » en vient à renforcer l’emprise de l’Eglise sur la société, en imposant un nouveau schéma spatial de l’au-delà dans les représentations sociales.
Après avoir considéré les lieux de l’au-delà, l’auteur en vient aux représentations des temps forts qui ponctuent l’existence de l’âme (chapitre 6 : « Un au-delà à deux temps : jugement de l’âme et Jugement dernier »). À rebours d’une historiographie qui a eu toutes les peines à concilier jugement de l’âme individuelle et Jugement collectif de l’âme et du corps réunis à la fin des temps, J. Baschet en vient à démontrer en images la compatibilité des deux jugements dans la logique eschatologique chrétienne, quand bien même un essor du jugement immédiat de l’âme au XIIe siècle a été formalisé par les théologiens, d’Abélard à Denis le Chartreux au XVe siècle, et dont témoignent nombre de tympans romans et gothiques. Mais ce serait méconnaître l’inventivité des images médiévales que de concevoir des formules iconographiques figées pour la représentation de ces deux jugements. Ainsi, le jugement de l’âme a revêtu différentes formes dans les images : l’évaluation des bonnes et mauvaises actions fait l’objet d’une figuration célèbre, indûment nommée « pesée de l’âme », apparue au Xe siècle, mais dont la diffusion massive intervient dans le second XIe siècle ; le combat pour l’âme entre un ange et un démon connait pour sa part un essor à partir du XIVe siècle ; enfin, au milieu du XIVe siècle, des mises en scène judiciaires apparaissent dans des manuscrits, en particulier dans Le pèlerinage de l’âme de Guillaume de Diguleville. Plus étonnant encore, J. Baschet démontre que le jugement de l’âme peut prendre une dimension collective. En témoignent les fresques de Buffalmacco au Camposanto de Pise dans les années 1330-1340, dont l’auteur avait déjà relevé une autre originalité, puisqu’elle montre le premier enfer structuré et compartimenté par les sept péchés capitaux. Une des scènes montre le combat des anges et des diables pour s’emparer du plus grand nombre possible d’âmes (p. 212). Or, le peintre a placé à côté de ce motif iconographique un Jugement dernier, preuve s’il en était besoin de la compatibilité entre les deux jugements. Quant au Jugement final, c’est au même moment et non loin de là, à Santa Croce de Florence, qu’est peint un Jugement dernier particularisé (planche XII), incarnant le seul commanditaire de l’œuvre ! Dès lors, est posée la question des articulations des deux jugements au sein d’une même image : sans entrer dans le détails d’analyse subtiles et pleinement convaincantes, l’auteur recense plusieurs images à deux temps, qui évoquent fortement ou juxtaposent explicitement les deux jugements. Ainsi, la représentation du jugement dernier « est comme la récapitulation et l’amplification de tous les jugements singuliers des âmes séparées (…) ; elle fait voir le futur de la fin des temps, mais elle fait aussi allusion aux jugements des âmes qui en sont la manifestation anticipée et imparfaitement révélée » (p. 218). Et c’est par une analyse magistrale d’un vitrail de la cathédrale de Bourges du début du XIIIe siècle que J. Baschet conclut ce deuxième volet de l’ouvrage (p. 224-226), analyse que l’on ne peut que conseiller aux enseignants pour une utilisation avec leurs élèves (J. Baschet a d’ailleurs conçu un numéro de la Documentation Photographique en 2005 sur « La chrétienté médiévale », dans lequel il propose de nombreuses analyses documentaires accessibles à un public plus large).
Un long Moyen Âge occidental à l’aune du comparatisme
L’ouvrage sous-titré « Une histoire de la personne au Moyen Âge » aurait pu logiquement en rester là. Mais c’est tout l’intérêt de l’anthropologie médiévale que d’élargir les perspectives d’un sujet dans l’espace comme dans le temps. Pour étudier au-delà de l’Occident médiéval les conceptions de la personne, à travers les relations entre le corps et l’âme, l’auteur n’hésite pas à recourir à une démarche comparatiste. Il prend en considération d’autres sociétés classées par Philippe Descola comme relevant de l’analogisme en terme de relations entre l’être humain et son environnement, de la Chine à l’Afrique de l’ouest, du Mexique à la Nouvelle-Guinée, même s’il est légitime de s’étonner de l’absence totale de la pensée de l’Islam sur le sujet (chapitre 7 : « Hors de l’Occident : que faire de la singularité européenne ? »). Il n’est pas dans notre intention de rentrer dans la complexité d’un chapitre foisonnant, dans lequel J. Baschet démontre que la dualité âme-corps est un quasi invariant des sociétés, même si cette dualité s’avère plus complexe dans le cas de la Mésoamérique par exemple (p. 249-256). La dualité corps-âme ne se retrouve pas chez les Nahuatl (Aztèques) à l’époque coloniale, ni chez les Mayas aujourd’hui, pour qui trois entités animiques différentes constituent la personne. Mais cette « cette ternarité des centres animiques, relevée pour les époques anciennes, s’éclipse pour faire place à un phénomène de concentration dans le cœur », de même que les âmes de la personne connaissent un dédoublement dans le monde animal ou l’environnement naturel (montagnes). Un autre écart dans la conception de la personne avec le monde chrétien se révèle quant à la résurrection des morts : malgré cinq siècles d’efforts de christianisation, cette croyance ne suscite chez les Mayas Tseltals qu’incompréhension et rire généralisé.
En héritier de J. Le Goff, l’auteur réexamine finalement la périodisation du Moyen Âge à l’aune de la conception de la personne (chapitre 8 : « Quand finit le long Moyen Âge : la nature sans personne et la personne sans relation »). C’est avec Descartes et la science moderne vers le milieu du XVIIe siècle qu’il date la naissance du dualisme corps-âme : l’espèce humaine devient une exception, dans le cadre d’une dichotomie entre nature et culture. Pour le dire dans les termes de P. Descola, l’ontologie analogique (les relations entre l’être humain et son environnement) a été remplacée par une ontologie naturaliste, dans laquelle l’être humain et l’environnement se voient dissociés. « Descartes ne fait rien moins que signer l’acte de naissance de la Nature » (p. 279) par la dissociation entre l’homme et le reste du vivant. Ainsi, la séparation absolue du matériel et du spirituel, du corps et de l’âme, le primat de la pensée conçue comme le commencement absolu de chacun, c’est-à-dire « le caractère auto-fondé et a-relationnel de la personne », ont donc permis l’apparition de l’individualisme moderne. Le Moyen Âge ne se finira vraiment que dans les années 1750-1780, lorsque le nouveau régime d’historicité remettra en cause la force de la tradition et d’une expérience collective héritée, au profit d’un horizon d’attente fondé sur la croyance en un progrès ininterrompu de l’humanité. Ainsi, « l’Occident a conçu la liberté comme une triple dissociation d’avec les déterminations naturelles, les appartenances collectives et le poids du passé. Sur ces trois versant, l’Occident s’est construit contre la relationnalité ou, pour mieux dire, dans le déni de celle-ci » (p. 306).
Après avoir éclairé le profil de l’homme post-moderne à la lumière du Moyen Âge tout au long de cet ouvrage conciliant exigence scientifique et volonté pédagogique, la conclusion de J. Baschet invite à une réformation de l’individu occidental, inscrit dans un ici et maintenant saturé de technologie, mais sans perspectives d’un avenir prometteur. À condition de remédier à sa triple dissociation d’avec la filiation, la société et l’environnement , il sera peut-être en mesure de se reconstituer un horizon d’attente, qui satisfasse à la fois les exigences de son corps et les aspirations de son âme.