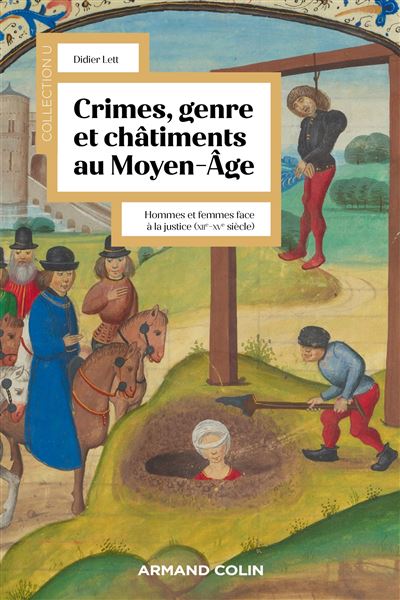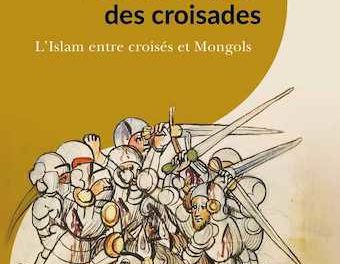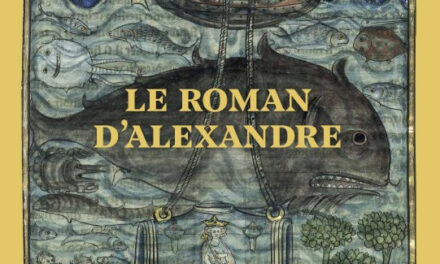C’est à la fois un ouvrage dur et passionnant que nous propose Didier Lett depuis le mois de mars. Dur par le catalogue de crimes et de peines présentés par l’auteur, mais passionnant et éclairant par son approche qui privilégie, non pas comme la plupart des études l’institution judiciaire, mais les victimes et les coupables, ce qui permet non seulement de revenir sur certains aspect méconnus de la justice médiévale mais aussi sur certaines idées reçues.
Le Moyen Âge est-il, comme l’affirment certains, une période violente et sexiste ? Didier Lett nous propose donc une synthèse éclairante sur le crime au sens large et sa pénalisation en Europe sur une période couvrant les cinq derniers siècles du Moyen Âge, de la Suède à l’Italie en passant par l’Angleterre ou la France. L’introduction du genre se justifie ici pleinement car il permet de saisir les différences de peines selon le sexe des individus et les inégalités de traitement. Le lecteur ne manquera pas de faire un parallèle avec notre époque en mesurant le chemin parcouru par la société et la justice ou en notant que quelques préjugés actuels restent hérités de cette époque. Quelques illustrations accompagnent le texte.
L’ouvrage, volumineux, est divisé en trois parties qui, chacune, vont de la situation la moins grave à la plus lourde en conséquences. Du chapitre un au chapitre huit, dans une partie intitulée « Des petits délits aux crimes graves », Didier Lett présente les divers délits passibles de diverses peines, tandis que du chapitre 9 au chapitre 13, la deuxième partie, intitulée « Entre le crime et le châtiment : de la dénonciation à la torture », analyse les suites immédiates du crime et la procédure d’enquête qui précède le jugement et la condamnation, phase qui va de l’arrangement à l’amiable à l’emploi de la torture. La dernière partie, qui couvre les six derniers chapitres, intitulée « Des peines pécuniaires aux peines infernales », s’intéresse, comme le titre l’indique, aux décisions judiciaires et aux diverses peines de mort encourues en fonction du crime, du sexe et de l’âge de l’individu concerné. Le lecteur pourra d’ailleurs jongler entre les différents chapitres et, selon le crime, se référer directement aux chapitres concernant les peines encourues à l’aide de la table des matières.
Qu’est-ce que le crime au Moyen-Âge ?
Le crime est défini « comme toute action qui viole le système normatif en vigueur et qui est donc détectée, poursuivie et punie par une institution donnée », ce système étant donc déterminé par les règles fixées par les sociétés. Le crime désigne quant à lui, à l’époque, l’accusation et non la faute, et pour qu’une peine soit efficace, il faut qu’elle apparaisse juste, réfléchie et acceptée par le corps social. Punir, protéger la société, réparer, consolider l’ordre public et prévenir les crimes, tels sont les objectifs de la justice, qui sont, globalement, toujours les mêmes actuellement. Mais il ne faut pas oublier la très grande variété des situations et des peines pour des faits identiques, car nous sommes à une époque où la justice n’est pas uniforme d’un territoire à l’autre.
Davantage d’hommes que de femmes, mais des femmes impliquées différemment
Un premier constat s’impose : il y a plus d’hommes que de femmes impliqués dans les affaires judiciaires. Elles représentent globalement entre 3 et 25 % des personnes incriminées selon le corpus de sources étudiées concernant 16 régions allant de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. Ce déséquilibre s’explique en premier par la construction de la masculinité et la socialisation des garçons. Ces derniers doivent être capables de défendre l’honneur familial et donc d’être capables d’intervenir dans l’espace public, y compris en utilisant la violence.
C’est ainsi que l’auteur commence par le délit le moins grave : l’insulte verbale et gestuelle. Elle est multiple, peu étudiée globalement par les historiens et pourtant très présente dans les sources. Selon la Cour temporelle d’Avignon, entre 1327 et 1374, 50 % des amendes infligées le sont pour injures verbales. Mais il y a différentes formes d’injures. La menace, la malédiction, le jugement négatif. Même si l’utilisation d’injures n’est pas recommandée aux femmes, elles ne s’en privent pas, loin de là ! L’insulte est un délit mixte où Marseille semble se distinguer. Sur deux ans, en 1330 et 1331, les femmes représentent 59 % des personnes condamnées pour injures verbales ! Les insultes s’effectuent en premier entre personnes du même sexe, mais il n’est pas rare de voir des femmes viser assez souvent les hommes. Pour ces derniers, l’insulte se distingue en étant suivie assez régulièrement de rixes, contrairement aux femmes, ce qui aggrave un peu plus la situation. Les rixes ont lieu autant le jour que la nuit, mais cette dernière concerne presque exclusivement les hommes dans les tavernes, l’alcool aidant au passage à l’acte. Les armes utilisées lors de ces rixes sont le plus souvent des couteaux, suivis du bâton. Les femmes portent peu d’armes sur elles, mais cela peut arriver, notamment en Normandie à la fin du Moyen Âge. La gravité de la rixe permet d’établir la peine, et cela se mesure à l’effusion de sang. Plus cette dernière est importante, plus l’amende est lourde. Le préjudice est d’autant plus grave si la blessure est causée au visage d’une jeune fille, car elle est considérée comme une source de préjudice lourd en cas de futures négociations matrimoniales.

Violences domestiques et relations hors mariage
La question des violences domestiques est abordée, bien entendu. À cette époque, l’homme est reconnu comme rex in domo propria, c’est-à-dire qu’il peut et doit corriger toute personne vivant sous son toit et sa dépendance. Mais … il doit battre avec modération ! Si le seuil de correction maritale est dépassé, une plainte est légitimement reçue et peut déboucher sur un procès. Passé un certain seuil, la brutalité est jugée inadmissible, surtout si elle provoque une fausse couche. À la fin du Moyen Âge, les violences maritales sont d’ailleurs devenues un véritable problème pour les autorités judiciaires qui y voient une menace pour une institution sacrée par-dessus tout : le mariage, le but étant d’éviter la dissolution de ce dernier.
Le chapitre deux concerne les vols et atteintes aux biens, avec une réflexion sur le vol par nécessité, les uns comme Jean Gerson recommandant une clémence, les autres comme Nicolas de Clamanges, une sévérité accrue. Les voleurs sont plutôt jeunes, laïques, mais les clercs ne sont pas en reste, comme pour tous les types de délits. L’adultère, le concubinage et la bigamie sont des comportements tolérés, mais dénoncés si on veut se venger d’un voisin si une grossesse hors mariage survient. C’est un délit lorsque la situation remet en question des préceptes religieux sapant les bases du mariage grégorien monogamique.
Un droit canon égalitaire : messieurs, donnez l’exemple !
L’adulterium est défini comme un acte sexuel accompli par, avec ou contre une femme mariée, mais c’est un délit attribué aux femmes, car susceptible de déboucher sur une grossesse amenant dans le mariage des enfants étrangers ayant accès au patrimoine du mari, le Moyen Âge effectuant un lien étroit entre adultère et propriété. L’amant, bien sûr, est poursuivi car il a eu le tort de s’approprier ce qui ne lui appartient pas : la femme d’un autre. L’adultère masculin reste cependant très présent, mais il est surtout condamné aux quatorzième et quinzième siècles devant les tribunaux ecclésiastiques. À cette époque, le droit canon devient plus égalitaire en cherchant à promouvoir une certaine égalité pénale face à cette violation du sacrement du mariage. Deuxième raison : il remet en question la responsabilité des chefs de famille. Tromper son épouse signifie donc ne pas savoir tenir sa maison et donner le mauvais exemple selon Jean Gerson. Enfin, troisième raison : la stratégie des femmes au tribunal. Elles ont intérêt à démontrer et à dénoncer une infidélité pour obtenir une séparation, ce qui met à nouveau en péril l’institution du mariage.
Le concubinage est un délit considéré comme étant avant tout masculin. Ce phénomène est très répandu parmi les prêtres et, selon les archives de la Pénitentiaire pontificale, entre 1449 et 1553, ce ne sont pas moins de 38 000 pétitions d’enfants illégitimes qui sont envoyées pour laver une tache de bâtardise. Dans le diocèse de Genève, entre 1411 et 1414, 14 % des prêtres vivent en concubinage. Mais la fin du Moyen Âge se montre peu clémente envers les situations et, en 1387, en Castille les concubines sont déclarées criminelles. Chez les laïcs, le phénomène est assez largement répandu. Plusieurs explications peuvent être avancées : on attend un mariage plus prometteur, on cherche à contourner les exigences de la monogamie … Notons également que, à l’époque, la bigamie est un délit masculin avant tout. Pour une femme, il est jugé moins grave, car il vaut mieux contracter un second mariage que de rester sans mari.
La prostitution : un mal nécessaire
Le chapitre quatre est consacré à la prostitution illégale et au proxénétisme. Du 12e au 15e siècle, la prostitution n’est pas un délit en tant que tel. Elle est reconnue comme un mal nécessaire par l’Église, car elle permet d’éviter le pire, c’est-à-dire de détourner la jeunesse du vice sodomite, particulièrement redouté. Par conséquent, les mesures prises à l’époque pour l’enrayer voire l’éradiquer, comme l’ordonnance de Louis IX en 1254, qui souhaite jeter les prostituées hors de France, sont promulguées en vain. Généralement, la prostitution est gérée localement, les maisons closes appartenant à la ville ou à un seigneur. L’intérêt de cette gestion est un point débattu encore parmi les historiens, car pour certaines villes, les bordels sont incontestablement une éminente source de profits, mais ce n’est pas le cas partout. La prostituée est en général une fille étrangère à la ville et à la région, sauf exception comme Dijon où le recrutement est local. Elles sont jeunes et se distinguent par le port d’habits distinctifs où la couleur jaune domine souvent. L’interdiction de porter de la fourrure est également souvent préconisée, tandis que le port d’une aiguillette est souvent exigé. Un interdit cependant demeure : les prostituées travesties en homme. En effet, le travestissement général est interdit, car il franchit la limite de la frontière des sexes. La prostitution ne devient un délit que lorsqu’elle n’est pas sous le contrôle des autorités communales, s’effectue dans les lieux non autorisés et/ou débouche sur des activités sexuelles non autorisées. Les souteneurs sont d’ailleurs jugés comme des criminels. Le monde de la prostitution reste très largement exposé aux violences,mais, pour autant, la justice ne les ignore pas en cas de plainte.
À la fin du XVe siècle, on assiste à un phénomène de rejet global de la prostitution sous l’effet d’une forme de moralisation de la société. Les bordels sont soit fermés, soit rejetés hors de la ville. Plusieurs explications sont avancées, comme par exemple l’apparition de la syphilis.
Le viol, une atteinte à l’honneur des familles
Le chapitre cinq est consacré au viol des femmes et des filles. Il porte fortement atteinte à l’honneur des familles. La sévérité des peines est en fonction du maître du statut matrimonial de la victime. Mais qu’entendons-nous par viol à l’époque, le mot n’existant pas (en effet, le terme de viol n’apparaît qu’au XVIIe siècle, on parle à l’époque de stuprum en latin) ? Ce dernier se définit avant tout par une pénétration vagino-pénienne, tandis que le viol domestique n’est absolument pas reconnu. Pour qu’un homme soit accusé de tentative de viol, il faut qu’il ait clairement annoncé ses intentions et, par conséquent, à l’époque, il est conseillé aux femmes de hurler, ce qui est pris pour une preuve du non-consentement et l’absence de cris peut jouer dès lors en faveur du coupable. Cependant, les tribunaux semblent conscients des limites de cette recommandation, en particulier face aux femmes atteintes de handicap, ce dernier étant dès lors pris en considération. Quant aux violeurs, ils ont des profils très variés, et aucune couche de la société n’est épargnée par ce crime. Un âge limite est déterminé à l’époque et on considère qu’en dessous de 12 ans la responsabilité des enfants, en tant que victimes, n’est pas engagée. Le chapitre 11 aborde les suites d’un viol et son traitement judiciaire, l’expertise médicale menée par des matrones (rares moments où les femmes participent à une procédure judiciaire du côté des experts), sa difficile dénonciation et les stratégies des violeurs (quand ils n’ont pas pris la fuite) pour échapper à la condamnation, stratégies visant soit à nier, soit à calomnier la victime par tous les moyens.
Une chasse aux sodomites qui se recentre
Le vice sodomite fait également l’objet d’une répression. Mais relevons de suite que la sexualité illicite ne désigne pas exclusivement l’homosexualité, mais de façon plus générale les pratiques sexuelles jugées non conformes, essentiellement celles qui ne comprennent pas une pénétration vaginale. Cette limitation s’explique dans un contexte où, aux XIIe et XIIIe siècles, toute sexualité sans lien avec la procréation est condamnée. Un renversement s’effectue à la fin du Moyen Âge, période où le vice sodomite désigne désormais expressément une relation homosexuelle. C’est ainsi que des magistratures spécifiques contre les sodomites sont créées, comme par exemple à Venise en 1418 ou à Florence en 1432 avec l’Office de la nuit. D’ailleurs, la réputation de sodomite faite aux Florentins à cette époque est particulièrement répandue, tandis qu’héberger chez soi des rebelles et des sodomites expose à des peines très lourdes.
L’homicide, un fait masculin, excusable selon les cas
Enfin, l’homicide, crime qui débouche sur la mort d’un individu, est abordé. Particulièrement présent dans les sources, ce qui a longtemps fait croire que la société médiévale était une société violente, il doit être cependant remis en perspective. D’une part, il varie beaucoup d’une source à l’autre, et d’autre part, on constate qu’à la fin du Moyen Âge, le taux d’homicide a plutôt tendance à baisser de manière globale. Ainsi, il ne représente que 2 % des délits en Suède entre 1452 et 1543.
Au Moyen Âge, le législateur fait une distinction entre le « vilain fait » (l’homicide) et « le beau fait » ; le premier étant un assassinat perfide et crapuleux perpétré avec préméditation, en secret et parfois en bande. Notons d’ailleurs que l’utilisation du poison pour tuer son conjoint, contrairement à une idée répandue, est davantage le fait des hommes que des femmes à cette période. On constate en effet une très grande asymétrie : les hommes étant beaucoup plus présents que les femmes dans les affaires d’homicide. Par exemple, en Angleterre, les femmes sont coupables dans 6 % des cas à Oxford. Comment expliquer cette différence flagrante ? Sans doute parce que les individus ont parfaitement intégré leur assignation de genre, les hommes se devant de défendre à tout prix l’honneur de leur parenté quitte à utiliser la violence la plus extrême, tandis que les femmes sont censées s’y mettre à l’écart. Mais la meurtrière existe, comme en témoigne par exemple le cas de Marguerite de Bruges qui, en 1390, embauche des tueurs à gages pour se débarrasser d’un individu.
La criminalité intrafamiliale, l’uxoricide, le maricide seront jugés différemment selon la situation. L’uxoricide est un délit souvent pardonné, car pouvant être commis parce qu’une femme aura refusé d’obéir à son époux. De même, le meurtre du conjoint, en général consécutif à une maltraitance intradomestique qui a dépassé les bornes, peut être lui aussi excusé. Enfin, le cas de l’infanticide et de ses diverses problématiques, parfois complexes, est abordé. Enfin, Didier Lett ne manque pas de revenir sur le meurtrier le plus emblématique de l’époque : Gilles de Rais, le serial killer d’enfants au XVe siècle, condamné à mort le 26 octobre 1440 à être pendu et brûlé.
Blasphème !
Les crimes les plus graves, le déicide et l’acte d’homicide contre soi-même, sont considérés comme très graves, car causés par le fait de douter de la miséricorde divine et de penser que l’on ne peut être sauvé, et sont abordés avec une distinction de genre : les hommes se suicident davantage que les femmes d’après les statistiques. En conséquence, le suicidé ne peut bénéficier d’une sépulture chrétienne, car il devient un potentiel revenant susceptible de causer de nombreux ravages. Enfin, le crime ultime, le crime contre Dieu et le pouvoir souverain est abordé : le blasphème ou « vilain serment », qui se définit comme un tort causé à la foi catholique, voit sa prohibition prendre ses origines dans le Décalogue. Il est considéré comme une profanation, c’est-à-dire qu’il rend profane et commun ce qui doit être sacré. Ici, l’injurié est Dieu, mais aussi Marie et les saints. Ce délit est particulièrement puni. En France, c’est Louis IX qui fonde la tradition de législation antiblasphématoire en faisant adopter pas moins de quatre textes entre 1256 et 1270, textes repris par la suite et aggravés notamment par Philippe III et Charles VI. Mais, si d’un côté la législation se durcit, les sources montrent que le blasphème est rarement criminalisé. Il ne semble occuper que 1 à 2 % des affaires traitées en moyenne. Pourtant, il est particulièrement présent au travers des insultes, des pratiques de vie et de divers délits. Est-ce blasphémer, par exemple en pratiquant les jeux d’argent ? L’inceste et le crime de lèse-majesté relèvent également du crime contre Dieu, ainsi que le fait de battre monnaie (les faux-monnayeurs) et l’hérésie. L’auteur termine sa première partie en évoquant, à travers des pages passionnantes, la question de la sorcellerie et de la magie, cette dernière débouchant sur une chasse aux sorcières qui, au 14ᵉ et au 15ᵉ siècle, s’accentue dans une période de hantise du diable. La sorcellerie est féminisée au cours du dernier siècle médiéval et prend la forme que nous lui connaissons actuellement.
La torture, oui, mais rarement.
Le chapitre 13 revient sur « l’aveu par la force : la torture ». Cette dernière, qui souvent accompagne les clichés liés au Moyen Âge, obéit à un impératif : le criminel doit avouer son crime et, dès lors, la torture appartient pleinement à la procédure inquisitoire. Mais, contrairement à une idée bien reçue, elle est très rarement utilisée, le juge ne pouvant y recourir que dans certaines circonstances bien précises et de manière très codifiée. C’est ainsi qu’en 1488, sur les 600 prisonniers écroués au Châtelet, une vingtaine seulement ont été soumis à la question. À la fin du Moyen Âge, elle devient un enjeu de pouvoir étatique et une affirmation de la puissance monarchique en France. Et, en parallèle, le parlement de Paris intervient pour réglementer et adoucir les techniques utilisées et recommande de n’y recourir qu’en dernier recours.
Dans quels cas est-elle pratiquée ? Elle est pratiquée avant tout pour les crimes considérés comme énormes, excessifs, comme les meurtres, les viols, les hérésies et les crimes contre le roi et les crimes dits occultes. Mais la situation est variable. Ainsi, les statuts de Reggio en 1411 précisent que la torture peut être utilisée, par exemple, en cas d’incendie, de vol de grand chemin ou d’inceste. Il est possible également, selon les cas et les situations, de recourir à la torture pour faire avouer un viol. En théorie, les clercs sont censés, mais ils doivent prouver leur statut par une lettre de cléricature. Les femmes peuvent en être préservées si elles sont enceintes, et la torture ne peut pas être utilisée dans le but de témoigner contre le mari (et inversement). Quant aux méthodes utilisées, elles sont diverses et variées. Au Châtelet, la chambre de la question est située près des cellules et la torture se réalise soit par extension, c’est-à-dire qu’on exerce une pression sur les membres, soit par l’ingestion forcée d’huile, de vinaigre, mais aussi et surtout de beaucoup d’eau. La brûlure est plus rarement utilisée. Les séances de torture peuvent parfois durer très longtemps, jusqu’à provoquer des traumatismes irréversibles physiques et mentaux sur les individus. Mais une réflexion est entamée sur la torture en elle-même. Dans la mesure où la recherche de la vérité prime, certains ont conscience que la torture pratiquée de manière excessive peut aboutir à de fausses confessions. Par conséquent, il faut savoir l’utiliser avec modération !
Mais quelle peine pour tous ces crimes ?
Il faut le rappeler, la situation n’est pas uniforme dans chacun des royaumes de l’époque médiévale, et pour un même crime, la peine peut être sensiblement différente en fonction des circonstances, du juge, de la coutume, des précédents… C’est ainsi que, par exemple, en Espagne, pour les femmes comme pour les hommes, la sodomie ou le proxénétisme conduisent à la peine de mort. Les inégalités entre hommes et femmes sont bien présentes et si, d’un côté, les femmes risquent en général une peine moins lourde, dans certains cas, c’est l’inverse. Ainsi, certaines coutumes autorisent le mari à tuer son épouse et son amant si le mari les découvre en flagrant délit. C’est le cas, par exemple, en 1423, à Sefro, localité des Marches, et ce, même si le droit romain et le droit canon n’autorisent pas ce droit de vie et de mort octroyé au mari.
Des peines genrées
Outre l’amende pour les délits les moins graves, la pendaison est une peine de mort à la fois dégradante et masculine, mais aussi une peine relativement fréquente. Par exemple, en Navarre entre 1280 et 1360, elle est la principale méthode d’exécution avant la noyade et le bûcher. Elle est plutôt réservée aux voleurs récidivistes non-nobles, mais il arrive que certains notables, parfois, soient condamnés à cette peine. Notons le sort réservé aux juifs, par exemple, et aux sodomites qui sont pendus la tête en bas. À l’inverse, la décapitation, réservée en particulier aux traîtres et au fait de haute trahison (espionnage, complot contre le roi…), est une peine de mort réservée aux nobles masculins. Précisons d’ailleurs, après la décapitation, que le corps du condamné est également émasculé, écartelé, démembré et son corps en morceaux exposé aux quatre coins de la ville, voire du royaume. Pour les femmes, le bûcher est privilégié. Avec ce châtiment extrême, on cherche ainsi à faire disparaître complètement le corps et à purifier l’espace public. Ce sont en général les femmes ayant commis un infanticide ou ayant tué leur mari, mais aussi les sorcières et celles ayant eu des relations sexuelles avec des Juifs qui vont être condamnées à cette peine. De même, l’enfouissement et la noyade sont également plutôt réservés aux femmes.

Géographie de la mise à mort
La question de la géographie des exécutions est abordée à travers le cas de Bologne, où il existe deux endroits : la place du marché et la place de la commune, en plein centre de la cité. Les supplices comme pour la décapitation la pendaison ont lieu surtout le mardi le samedi et le mercredi. Aucune exécution n’a lieu le dimanche, jour du seigneur. À Paris, il s’agit de la place de grève qui accueille la potence et l’échafaud tandis que le parvis de Notre-Dame, lui, accueille plutôt le bûcher. Mais, comme le rappelle l’auteur la place la plus célèbre est celle du gibet de Montfaucon qui se situe en dehors de la ville, sur une colline située au nord-ouest de Paris. Construit au XIIIe siècle, il sera détruit vers 1760. Composé de 16 piliers, il pouvait accueillir et exposer simultanément une trentaine d’individus au XVe siècle.
Échapper à sa peine
Le dernier chapitre de l’ouvrage, dénote et redonne une pointe d’optimisme après ce catalogue de peines, qui pour le contemporain, depuis l’abolition de la peine de mort en 1981, peut parfois, donner le vertige. L’auteur se consacre ainsi aux grâces, aux repentances aux peines éternelles, ce moment où le condamné échappe à sa peine. Suivant l’adage « justice sans miséricorde est trop dure chose » (Jean Bouthillier 1350), les amnisties grâce et remise de peine peuvent arriver suite à une intervention divine et un miracle de dernière minute mais aussi, plus concrètement soit par ce qu’une jeune fille vient demander par exemple un futur pendu en mariage le jour de son exécution, soit parce que le roi, représentant de Dieu sur terre a le pouvoir de gracier collectivement ou individuellement. C’est ainsi que le roi accorde des lettres de rémission qui permet d’éviter l’application de la peine capitale. Les acquittements sont en général plutôt octroyés à des individus soient très jeunes, soit âgés, la vieillesse étant vue comme une circonstance atténuante. L’extrême pauvreté est également considérée comme telle, comme le montre le cas de nombreuses affaires survenues dans les communes italiennes de la fin du Moyen Âge où des individus, convaincus de vol sont néanmoins acquittés après démonstration que leur crime n’avait pas d’autre objectif que de nourrir une famille dans le plus grand dénuement.
Mais, comme le rappelle Didier Lett pour conclure il faut absolument éviter d’essentialiser les rapports de sexe : au Moyen-Age, il existe une multitude d’états féminins et masculins mais, de façon générale, et face à la justice, il valait mieux être une femme de notable qu’un étranger, une épouse qu’un vagabond, ou une nonne qu’un « sans nom ».