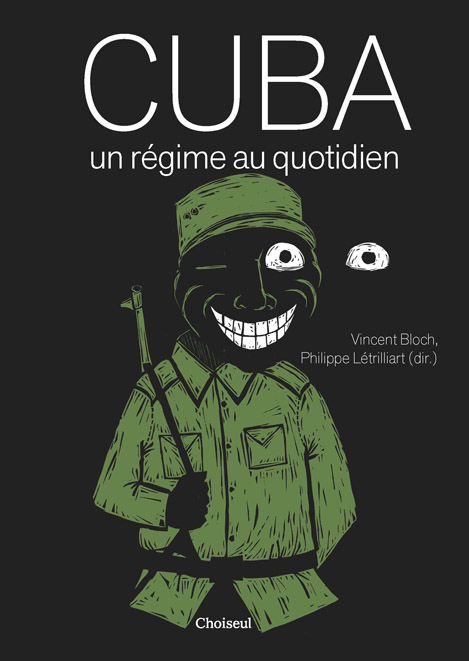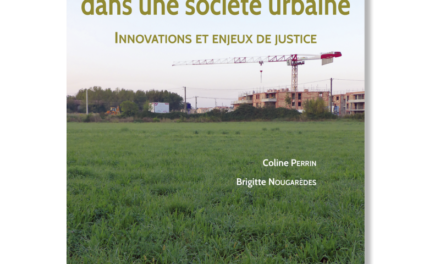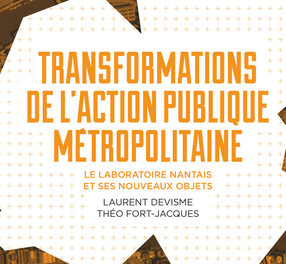Cet ouvrage collectif sur le régime cubain rassemble un panel varié de sociologues, politologues, anthropologues et historiens qui, en six chapitres indépendants, brossent un portrait des relations entretenues depuis 1959 entre la société cubaine et le régime castriste. C’est une occasion rare d’étudier de l’intérieur l’État révolutionnaire établi par Fidel Castro, son frère Raul, Ernesto Guevara et Camilo Cienfuegos, loin des clichés, qu’ils soient « guévaristes » ou anti-castristes.
Ni révolution ensoleillée et romantique, ni enfer totalitaire absolu, le régime cubain s’imagine et se représente lui-même en évolution permanente, à la fois auteur et prolongateur d’une révolution toujours en mouvement, qui se réinvente au fur et à mesure des évolutions contextuelles extérieures (tandis que, pour les régimes communistes européens, la révolution est un « acte de naissance politique » clos). Un régime qui se contredit, s’auto-critique, affirme une chose puis son contraire à des dizaines d’années d’intervalle, dans le seul but de prolonger autant que possible le pouvoir personnel de ceux qui incarnent et dirigent la Revoluciòn : Fidel Castro (pour le côté charismatique et dogmatique) et Raùl Castro (pour le côté pragmatique). Les Cubains, eux, agissent comme le régime : ils s’adaptent. Désorientés, stoïques et débrouillards, ils exploitent chaque faiblesse de l’État cubain afin d’améliorer leur vie quotidienne. Car la majorité des cubains ne cherche pas des portes vers la démocratie, les droits de l’homme et les libertés individuelles, mais tout simplement un accès à la société de consommation, dans son essence la plus basique. Dans un pays où le rationnement est la règle, où la lenteur de réaction des entreprises d’État est affligeante ( du moins jusqu’à la reprise en main du pouvoir par Raùl Castro, qui cherche à « désétatiser » un système où 90% de la population est employée par l’État), chaque kilo de sucre obtenu en sus, chaque réparation (rapide) de téléviseur réalisée ou chaque dollar empoché auprès d’un touriste étranger est une petite victoire. Et cela d’autant plus que, depuis 1989, la manne soviétique a cessé de tomber sur Cuba, provoquant un effondrement du PIB de 35% et le début de la « période spéciale » qui n’est, selon les dires mêmes de Raùl Castro, pas encore terminée.
Chaque chapitre de l’ouvrage apporte des enseignements complémentaires et utiles. Le premier, écrit par Vincent Bloch, décortique le fonctionnement du régime. On est frappé par la capacité à désorienter le citoyen afin que, pour lui, rien ne soit sûr et que tout soit soumis à un changement aléatoire, brutal et autocratique. Il naît de ce système une société où l’individu peine à exister, à stabiliser sa propre vie, car il est partagé entre la volonté de se fondre dans la masse et d’apparaître comme un « bon » révolutionnaire, qui manie ostensiblement la langue de bois marxiste-léniniste, et une aspiration à une vie « normale », dégagée de toute contrainte étatique et, surtout, de toute angoisse quotidienne. Vincent Bloch explique que le régime s’appuie sur trois fondements majeurs : la perversion de la loi, la perversion de la citoyenneté et le pourrissement de la concorde. La perversion de la loi signifie que rien n’est sûr, que les garanties habituelles ne sont pas respectées et que, par peur de commettre on ne sait quelle faute, les cubains adhérent en façade au régime. La perversion de la citoyenneté en découle : celui qui veut voir ses droits respectés en tant que citoyen doit avant tout prouver qu’il a un « comportement révolutionnaire ». Enfin, le pourrissement de la concorde provoque l’anéantissement de contacts sociaux usuels, du fait de la paranoïa permanente et de la défiance envers tous, rendant impossible l’émergence d’une société civile organisée.
Le second chapitre suit le quotidien d’une famille cubaine plutôt aisée. Malgré cette caractéristique favorable, l’angoisse sans cesse renouvelée de l’approvisionnement est constante, et on peut sans peine imaginer la situation des familles pauvres. C’est l’occasion de connaître les différents lieux d’approvisionnement des Cubains : magasins d’Etat faiblement achalandés, marché libre, marché noir et, surtout, les Shopping. Il s’agit de boutiques crées après 1989, où l’on paie en devises ou en CUC (Convertible Currency Unit, ou « peso convertible », qui équivaut au dollar). A titre d’exemple, quand le salaire moyen oscille entre 250 et 350 pesos par mois, une barre de savon achetée à la Shopping revient à 36 pesos. Cela explique que le recours à la Shopping se fasse en dernière extrémité.
Dans le troisième chapitre, Élizabeth Burgos se penche sur le système répressif cubain, et notamment son système pénitentiaire. C’est une des parties les plus intéressantes de l’ouvrage car il montre qu’en matière d’avilissement des prisonniers, le régime cubain n’avait (précision utile : le régime s’est depuis un peu assoupli sous la pression internationale) rien à envier à ses homologues communistes des pays de l’Est. Fidel Castro, fasciné par Robespierre, inspire dès 1959 les grandes lignes d’un système carcéral arbitraire et assumé, secondé jusqu’en 1970 par Ernesto Guevara qui s’était occupé de la liquidation physique des partisans de Batista, l’ancien dictateur renversé, dans la forteresse de La Cabanà. Elizabeth Burgos décrit un système où la peine capitale devient une méthode de gouvernement, où l’humiliation, la torture psychologique et les mauvais traitements sont monnaie courante. Elle dresse aussi, en fin de chapitre, un portrait actuel du régime qui ne peut plus réprimer comme avant et qui cherche surtout à limiter, à l’instar de la Chine ou de l’Iran, les impacts d’internet et de ses bloggeurs incontrôlables.
Les chapitres suivants s’intéressent au rôle de l’Église et des intellectuels dans la société cubaine. D’abord combattue et dénigrée afin de suivre le principe marxiste d’athéisme, l’Église a été de nouveau tolérée, puis acceptée jusqu’à permettre aux cubains d’obédience chrétienne d’être membres du parti communiste. Elle représente aujourd’hui plus un partenaire critique qu’un opposant au régime castriste, en possédant une liberté de parole dont ne peuvent se prévaloir d’autres éléments de la société. La situation des intellectuels est toute autre. Dans un discours mémorable prononcé en 1961, Fidel Castro édictait une règle absolue et irrévocable : « dans la Révolution, tout, en dehors de la Révolution, rien ». A partir de cette axiome, la volonté de la plupart des intellectuels et des artistes va être de recevoir la reconnaissance du régime, et donc de faire profil bas concernant toute critique, jusqu’à l’avilissement de certains qui deviennent les « intellectuels officiels du régime » et manient avec perfection la teque, c’est à dire la langue de bois. Mais les intellectuels font face à un régime retors : certains, comme le dramaturge Anton Arrufat et le poète Heberto Padilla vont, du jour au lendemain, tomber en disgrâce puis finir par être réhabilités. Ici encore le côté irrationnel, imprévisible et arbitraire de la dictature Castriste apparaît clairement. Toutefois, depuis le début de la « période spéciale », on s’aperçoit que l’Etat se désengage de plus en plus du débat intellectuel et artistique et permet un plus large espace d’expression et de tolérance.
L’ouvrage se termine de façon un peu plus ludique (quoique…) sur un texte intéressant de Sujatha Fernandes qui traite des rapports entre les rappeurs noirs et le régime à partir des années 90. A priori, les rappeurs noirs représentent tout ce que le régime castriste combat : individualisme « bling-bling », identité noire affichée, « gangsta » culture, codes vestimentaires revendicatifs affichés, etc. La micro-société du Hip-hop cubaine réussit pourtant à se faire entendre en utilisant des réseaux annexes et les contacts qu’elle noue à l’étranger. Certains groupes réussissent à sortir physiquement de l’île comme les Orishas, considérés ironiquement par ceux qui restent à Cuba comme des « vendus » au conformisme musical de la World Music. Chose curieuse, ces rappeurs « intègres » se révèlent finalement assez castristes dans leurs propos en reprochant à Orishas leur propension à célébrer la consommation sans frein et à se mettre au service du « grand capital » !
Ce compte-rendu ne peut être exhaustif. Le lecteur trouvera bien évidemment plus de détails d’approfondissements et d’informations dans chacun des six chapitres, que ceux qui ont étés mentionnés plus haut. On aurait pu ainsi évoquer la figure des plantados, ces prisonniers, souvent croyants, que le régime n’arrive pas à briser et qui forment aujourd’hui une sorte de « confrérie » extrêmement solidaire. L »ouvrage est donc très riche. Il induit et soutient une conclusion assez paradoxale : si le régime castriste (car la Révolution, c’est Fidel et Raùl, et personne d’autre !) manipule, subvertit, humilie, terrorise et réprime, il est aussi capable d’être reconnu pour son action positive en matière de santé et d’éducation, de laisser des interstices de liberté, de se maintenir et de s’adapter aux nouvelles situations internationales, ce qui explique sans doute sa longévité.
NB : les « cubanologues » intéressés par cet ouvrage pourront aussi lire, avec grand profit, l’article de Renaud Lambert dans le numéro 685 d’avril 2011 du Monde Diplomatique, Ainsi vivent les Cubains, qui traite essentiellement de la « période spéciale ».