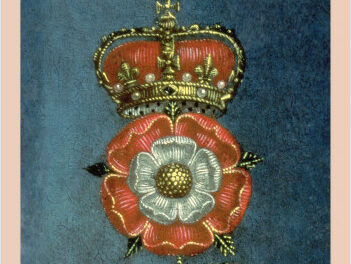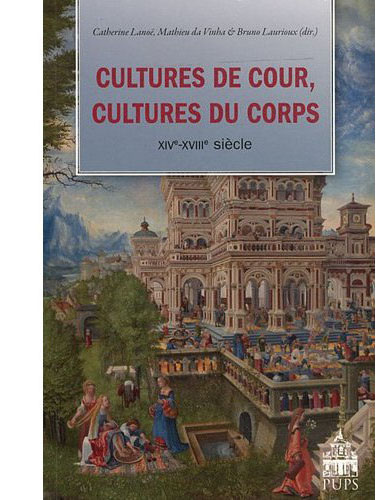
Cet ouvrage est le résultat d’un colloque sur les normes et les pratiques corporelles à la cour qui s’est tenu à Versailles, sous l’égide du Centre de Recherche du château, en décembre 2006 rapprochant des spécialistes de l’histoire de la cour et de celle du corps.
Couverture : Suzanne au bain, Albrecht Altdorfer, 1526, Munich
Pour les sociologues, il semble évident que le corps est une donnée naturelle devenue une construction sociale, objet, enjeu et produit de la socialisation (p 10). A la suite des analyses de Norbert Elias, qui avait montré la proximité du concept de cour avec celui du corps, un corps manipulé, discipliné, dominé pour accéder à un type de civilisation, il convenait de reprendre l’analyse de ce concept de distinction sociale où le corps est exposé et se construit en réalité et en représentation. Il fallait dépasser cette lecture politique et sociale des corps, qu’ont développé par la suite Bourdieu et Foucault.
Il est intéressant de considérer que dans les trente dernières années, les historiens sont parvenus à démontrer que le corps a été un lieu du social également pour les siècles précédents. De nouveaux champs se sont ouverts tant à la cour que dans la recherche sur l’histoire des corps. Cet ouvrage les présente ainsi qu’il fait le point sur la bibliographie la plus récente. L’histoire de la construction sociale du corps s’est développée avec l’histoire matérielle, biologique ainsi celle de l’hygiène, de l’alimentation qui accompagne le champ de l’histoire des désirs (sexe, séduction, fard…). Longtemps, l’analyse a porté sur les corps malades avec les modèles médicaux (la grande opération de Louis XIV, l’usage du quinquina, l’inoculation…) ou sur le rituel du corps mort. Désormais, la recherche s’intéresse au corps en bonne santé et à leur beauté (parure, modèle de perruque, carnation, couleur de cheveux…). Ce corps est modelé par des techniques et des corps de métiers dont l’étude s’amorce : coiffeurs, barbiers-perruquiers, apothicaires, dentistes, chirurgiens, parfumeurs, tailleurs… et les peintres en portrait.
Stanis Perez soulève le problème des codes, des normes et de définition de la propreté visible avec l’exemple de Louis XIV. Au XVIIe siècle, l’hygiène est une question de bienséance, de rapport à l’autre, pas de propreté personnelle (p 91 et suiv.). De plus, le manque de netteté qui est inconvenant n’est pas considéré comme pathogène. Que dire alors du toucher de milliers de malades lors des cérémonies thaumaturgiques ? Comment la main sacrée du monarque n’est-elle pas souillée par l’impur ? Par une toilette à trois liquides : vinaigre, eau, eau de fleur d’oranger qui s’apparente à l’arsenal hygiéniste de la religion purifiante.
Les canons esthétiques sont examinés avec l’art du portrait de cour, pictural et littéraire. On peut ainsi retrouver la carnation, la texture et la couleur réelle, imaginée, souhaitée, travaillée de la peau comme en témoignent les portraits de Fragonard où Mechthild Fend montre la finesse du rendu de la peau comme un toile nerveuse, incarnat et carnation rendant visible l’âme et les émotions de l’aristocratie.
L’usage du « vermillon terrible »
Le corps est aussi un tableau codé allant au delà de l’apparence et répondant à des critères physiques qui révèlent les qualités d’honneur, la lignée, l’identité. Georges Vigarello montre l’intérêt porté au haut du corps, objet de soins particuliers, voulant témoigner du raffinement et de la spiritualité. En découle l’usage d’outils pour les hommes comme les femmes: pince à épiler, brosse, huiles, eau, gants, éventails, talc, poudre, pot aux roses, boite à rouge … et le fameux blanc de cinabre.
Il s’accompagne également d’une tenue particulière, une attitude profilée pour le haut du corps, épaules repoussées en arrière, ventre en avant, visages renversés comme dans de nombreux tableaux ou gravures de mode. Ainsi se façonnent les représentations, et même la production culturelle des corps selon les critères esthétiques des modèles de corps ou de cour. Frédérique Leferme-Falguières développe la norme du paraître et du comportement à Versailles qui répond à l’exigence de la représentation curiale tout en construisant l’identité sociale du courtisan. Elle suppose des postures apprises, des parures et un mobilier adapté : tabouret, pliant ou chaise à dos comme en témoigne la hiérarchie des sièges à Versailles (p 147). Le grand corps (corset) entraîne la raideur du torse, cette attitude de retrait et de distance de l’aristocratie présente à la cour. Il suppose une lenteur de déplacement et des mouvements mesurés pour que ne s’échouent pas les hautes coiffures, ni ne se décale pas le grand panier. Il faut vivre entre inconfort et bienséance.
Ceci n’empêche pourtant pas le contournement des règles, l’émergence de nouvelles règles de politesse, le lancement de modes grâce à des habits, coiffures et fards où l’exubérance aristocratique, « mur banc » et « vermillon terrible » des princesses s’oppose à la discrétion bourgeoise. Ainsi une certaine forme de naturel affichée d’abord vers 1769 par Mme du Barry, influençant par là, Marie-Antoinette et Mme de Polignac sont des gestes significatifs ostensibles qui reflètent la nouvelle esthétique voire une nouvelle distinction de signes de classe, à la fin du XVIIIe siècle, affichant la supériorité d’une beauté naturelle sur les grâces artificielles de l’embellissement curial (Melissa Lee Hyde).
Louis XIV, victime de l’arrivée massive du sucre dans l’alimentation européenne dès la fin du XVIIe siècle
Colin Jones va plus loin dans l’analyse spécifique d’un aspect de l’apparence. Il s’intéresse aux dents de Louis XIV ou plutôt à leur absence, en partant du jeu de cache-cache de Rigaud entre le corps symbolique et le vrai corps biologique du roi. Les professeurs devraient relire cette analyse afin de donner toute sa dimension au Portrait du roi de 1701, analyse déjà étoffée par Peter Burke dans La fabrication du roi ou Les stratégies de la gloire (1995). C’est donc au début du XVIIIe siècle que se fait le passage du terme d’opérateur pour les dents, assistant avec fatalité à la chute de la dentition de Louis XIV, à celui de chirurgien dentiste, expert pour la théorisation de la prévention des soins dentaires et qui profite d’une grande promotion sociale. Mais le désir d’imiter Louis XIV en tout, conduit la cour à délaisser apparemment les soins des dents et de la bouche, si bien que Paris favorisant l’investissement sur les bouches saines et belles, dépasse Versailles et développe un marché qui entraîne une révolution du sourire à la fin du XVIIIe siècle.
Autre enjeu de l’apparence, la perruque (Mary K. Gayne), objet matériel susceptible d’être produit en quantité, vitrine des 3291 artisans de l’art capillaire français, adoptée par beaucoup dans les dix premières années du XVIIIe s, devient un objet marchand qui aurait pu être soumis à l’impôt. Question qui ne se pose pas à l’industrie du parfum tout aussi soumise aux modes définissant une nouvelle hiérarchie des sens dans laquelle la vue l’emporte sur l’odorat, le fard sur le parfum. Eugénie Briot rend visible à défaut d’olfactive, ce qu’elle nomme l’histoire d’un silence des sources qui évoquent rarement le parfumage des corps.
En ce qui concerne le corps de femmes, celui des princesses de la fin du moyen âge, étudiées par Élodie Lequain, il est objet de danger potentiel mais doit cependant devenir un corps de femme, d’épouse et de mère, éventuellement de princesse. La beauté physique étant fragile, il faut développer la beauté spirituelle, ce qu’elles peuvent faire en ayant à leur disposition une littérature médicale ainsi que des hommes et des femmes de l’art. Cependant, si les princesses apprennent à la cour à prendre soin de leur corps et de leur beauté, il leur faudra le faire avec retenue, en mangeant avec modération, ne pas trop user de « plaisances charnelles qui font vieillir prématurément ». Le corps des princesses est éminemment politique. Comme l’est la mise en scène du sacre, analysée par Pauline Lemaigre-Gaffier. Elle entend surtout montrer la logistique de l’expression cérémonielle du pouvoir royal (p 152) en rematérialisant le sacre qui a longtemps été analysé comme un temps symbolique. Il convient d’assurer la mise en état de la cathédrale de Reims, d’assurer le transport par voie d’eau et voie terrestre du matériel, de régler l’éclairage, le décor, la musique, l’ordre de la cérémonie, de fournir les objets du sacre, les trois couronnes, les manteaux d’hermine des pairs laïcs, de restaurer la main de justice de Henri IV et le fourreau endommagé de l’épée dite de Charlemagne. Ces actions profanes, voire prosaïques contrastent avec leur puissance symbolique. Et c’est donc le corps administratif de la monarchie (les Menus plaisirs) qui permet l’incarnation de la majesté royale.
La dimension matérielle apparaît également avec les outils et objets nécessaires au corps : peigne, habit… outils qui s’accompagnent d’un rituel d’utilisation qui est de plus en plus rendu public puisqu’il donne une puissance symbolique à l’utilisateur mais aussi au praticien. Ainsi qui du médecin ou du malade domine ? Et quand il s’agit d’un prince, qui dirige la politique en cas de protocole médical ? La question se pose encore de nos jours comme elle se posait dans l’Italie du XVIe siècle et dans la Rome des papes (comme le traite Elisa Andretta dans le régime de santé des papes où les enjeux liés au corps papal et à sa visibilité sont importants).
Manger en plein air, entouré de fleurs, entretient la bonne humeur (Grégoire XIII)
Ainsi la question est posée de l’existence du médecin, d’abord médecin du roi qui établit des pratiques (sur le poil, les cheveux, l’odeur et la peau) dont il sait qu’elles vont lui être rémunératrices à la cour, comme ce Henri de Mondeville, proposant de rectifier le corps du roi de la naissance à la mort, étudié par Laurence Moulinier-Brogi. Ces pratiques d’épouillage, d’étuves, d’épilation créent une norme qui distingue progressivement les femmes puis plus généralement la classe dominante à partir du XIIIe siècle, période à partir de laquelle le corps fut réhabilité et devient objet de soin dans le monde catholique.
L’histoire des pratiques du corps s’accompagne de celle des techniques au service du corps comme le thermalisme dans la cour des Sforza au milieu du XVe siècle, comme le met en évidence Didier Boisseuil. La cure thermale est prisée par les élites bourgeoises de la cité avant de devenir une pratique de la cour de Milan. La difficulté résidait, en partie dans la déplacement politique du corps du duc ou de la duchesse, difficulté résolue quand les médecins et les chaires universitaires démontrèrent que le lieu n’avait pas autant d’importance dans la guérison, que l’eau thermale pouvait être transportée et que la procédure thérapeutique ritualisée pouvait prendre place dans de nouvelles infrastructures, comme le nouvel hôpital construit à Milan. C’est le chemin qui mène du bain thérapeutique au bain de propreté. Ronan Boutier donne le détail des appartements des bains à Fontainebleau, longue enfilade de sept pièces empruntés aux bains antiques. L’usage de l’étuve diminue avec Louis XIII, pour favoriser le délassement dans un petit cabinet des bains, pièce de commodité à proximité immédiate de la chambre royale.
La gestion de l’eau à Versailles interroge également sur les lieux d’aisance décrits par Marie-France Noël dans une société moins pudibonde que la nôtre où les nécessités naturelles n’étaient ni honteuse ni cachées (p 243). Chaise d’affaire, chaise percée, avec ou sans lunette ou bourrelet, lieu à l’anglaise, fauteuil de commodités, bassin, vase de nuit, cabinet d’aisance, cabinet de chaise, mur à pisser, rien ne manque à Versailles pour satisfaire une envie pressante même en voyage ou adapté pour les princes enfants.
On le voit, les recherches sur les corps investissent de nombreux champs de recherche très féconds. Grâce à nombres de faits démontrés, elles remettent en cause un imaginaire fantasmé extérieur à la cour et très souvent dépréciatif. Les cours princières, cardinalices et papales sont des lieux d’expérimentations, d’échanges de pratique et de modèle mais aussi de création de savoir diététique, hygiénique. Elles sont des lieux de confrontation, d’exemples corporels qui établissent des règles et provoquent un mimétisme culturel, non pas en général comme le démontrait Elias, mais bien dans des pratiques intimes, quotidiennes et esthétiques.
Un intérêt supplémentaire à ce livre est de permettre la comparaison entre des époques différentes, médiévales et modernes, mais également de espaces éloignés en France ou en Italie. Il reste aux historiens à ouvrir les livres de comptes et les actes notariés mais aussi à analyser les cours plus modestes pour étoffer ces pistes prometteuses. Ce livre accompagne et rejoint un groupe de recherche européen (GDRE) dirigé par Marilyn Nicoud qui a travaillé le sujet entre 2008 et 2011 entre l’Italie et la France. Il s’agit bien de l’émergence du nouveau courant de la recherche historique. Tout lecteur intéressé par la culture matérielle du corps et les normes corporelles trouvera chaussure à son pied, thème cependant non évoqué dans l’ouvrage…