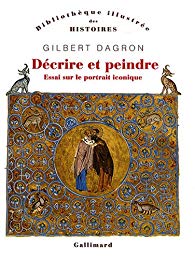Réflexions sur la question de l’image et du portrait dans le monde byzantin du 4e au 10e siècle
Recourant à la théologie par l’approche du divin, à l’esthétique dans l’attrait pour le sublime, à la philosophie par la recherche des voies de l’imago et à l’histoire, le traitement de l’Empire chrétien d’Orient (IIIe-Xe siècle), le dernier livre de Gilbert Dagron dépasse les limites établies des spécialités pour les utiliser conjointement. Professeur honoraire au Collège de France, et auteur d’une étude qui fait date sur le césaropapisme byzantin (1996), il propose ici une herméneutique du portrait iconique, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage Essai sur le portrait iconique. Ce travail rigoureux est exigeant à l’égard du lecteur dont il sollicite l’attention à chaque page par ses allers-retours entre l’abstraction, l’argumentation et l’illustration à tel point que, sortant de ces 234p, le critique n’est pas sûr d’avoir tout saisi, non pas à cause de l’écriture du livre, mais plutôt par la richesse foisonnante des abondantes pistes qu’il ouvre et qu’on aurait envie de poursuivre. En effet, si la matière de ce livre trait d’une époque et d’un espace particuliers, les concepts et la réflexion doivent être étendues à bien d’autres temps et domaines, comme Serge Gruzinski l’a déjà pratiqué dans ses nombreux travaux sur le Mexique et, plus généralement, le Nouveau Monde.
Reprenant les termes d’André Grabar et Hans Belting, Gilbert Dagron rappelle que le portrait représente « un personnage pour lui-même, hors de tout contexte, sinon décoratif, et ne participant à aucune action, même s’il prend la pose. Des objets peuvent environner ce personnage, mais seulement s’ils expriment et prolongent sa personnalité […]. Le portrait isole le modèle pour une réception plus directe et plus forte ! « c’est moi » semble dire le modèle, « c’est lui » dit le peintre » (p.8-9), qui doit s’effacer de son œuvre ». Par cette définition, on pense à l’élaboration de portraits et à ses conséquences pour d’autres périodes sur des thèmes proches, tel que celui du portrait d’Etat dont les travaux d’Edouard Pommier constituent une des références obligées (Théories du portrait. De la Renaissance aux lumières, Paris, Gallimard, 1998) ; les actes du colloque tenu à Rome en 2001 offrent aussi des perspectives intéressantes sur la question de la description imagée du pouvoir (Olivier Bonfait et Brigitte Marin (dir), Les portraits du pouvoir, Rome, 2003).
L’ouvrage fonde sa réflexion sur la représentation du religieux par les images, au moment « où se dessine une anthropologie chrétienne avant le lourd silence de l’Orthodoxie triomphante » (p.216). Après quelques riches rappels de l’héritage gréco-romain et juif, les références employées sont concentrées sur la haute époque byzantine pour se terminer entre le concile de Nicée II (787) qui autorise de peindre Dieu, mais avec de très fortes contraintes qui en limitent la portée, et la fin du millénaire siècle ; l’iconoclasme latent perdure jusqu’au nouvel humanisme byzantin du XIIe siècle.
Dans Décrire et peindre, les termes sont particulièrement importants et ils ne relèvent pas du snobisme intellectuel. Ainsi, l’adjectif iconique utilisé dans le sous-titre permet de comprendre sur ce qu’il revêt de charge intellectuelle y d’y insister. Provenant du grec eikön, image, ce terme souligne le double statut de celle-ci : de l’imitation et l’imagination (de la mimésis à la phantasia). Le premier chapitre, essentiel par les enjeux de l’image qu’il énonce, est intitulé « image, imagination, icône ». Partant de l’absence au début du 1e millénaire ap. J.C, des éléments techniques nécessaires à l’imitation-ressemblance, puisque les lois de la perspective ne sont pas découvertes avant la Renaissance italienne du XVe siècle, l’auteur examine la place et le statut de la vue dans la connaissance afin d’évaluer le portrait iconique. La vue, et son corollaire l’image, ont souvent un primat sur les quatre autres sens. Or la relation entre la vue et la perception, l’intériorisation et la spiritualisation débouchent sur l’opposition entre le monde intérieur et le monde extérieur, ce qui avait été souligné par les philosophes et par les Pères de l’Eglise. Ainsi, pour Platon, les images sont considérées comme le reflet (imitation imparfaite des idées) tout en laissant la possibilité d’un retour de l’image à l’idée (rôle représentatif de l’image comme la plus proche conception que l’Idée se fait d’une réalité), ce qui permet de s’accommoder de la difficulté d’allier dissemblance et ressemblance. L’apport augustinien marque une bifurcation car, selon Gilbert Dagron, saint Augustin fait l’économie de la théologie de l’image tout en étant le premier à souligner l’interactivité entre l’image et celui qui la regarde. Saint Augustin rappelle les trois étapes dans la re-création qu’opèrent l’artiste et le spectateur : d’abord, la mémoire reconnaît, puis le jugement identifie et enfin l’imagination intériorise et dématérialise ; par ce cheminement, l’image devient un composé/recomposé du regard. La vision est dialectique entre la contemplation et l’imagination. Un second courant épouse un cheminement différent. Il insiste sur la création dans l’image et sur sa place dans l’anamnèse (la mémoire du ressuscité) et dans l’anagogie (élévation de l’âme). La Hiérarchie céleste du Pseudo-Denys (L’Aéropagite), suivi par Contra imaginum calumniatores de Jean Damascène (début VIIIe siècle), identifient l’image-représentation avec le prototype-similitude (homoiôma) et dans le même temps, ils attribuent une fonction théologique à l’image face à l’idée (le logos), ce qui doit permettre au chrétien d’identifier et d’adhérer. Bien sûr, un des problèmes majeurs réside dans l’interdit vétéro-testamentaire de l’image et dans le silence de l’Evangile qui « ne fournit aucun élément permettant de tracer un portrait du Christ et recommande d’adorer Dieu “en esprit et en vérité” » (Jean IV, 23-24).
La lutte entre iconodoules et iconoclastes à Byzance se déroule à partir de 730, jusqu’au milieu du IXe siècle. Pour la concevoir, l’auteur rappelle la fondation de la théologie politique par Eusèbe de Césarée au IVe siècle, faisant de Constantin le délégué du Logos pour incarner l’ordre et l’unité contre la pluralité. Cette adoption offre un caractère éminemment politique à l’image, dans lequel le basileus joue un rôle important. Cependant, la querelle séculaire entre iconoclasme et iconodoulie serait principalement due à l’apparition de sectes (dans l’islam et le judaïsme) et à la réminiscence d’idées païennes. Ces « sectes » favorisent une systématisation théologique à propos de l’image puisque, auparavant, les pères du IVe siècle adhéraient globalement au dualisme âme-corps qui permettait d’analyser le portrait physique comme un « simulacre de simulacre » (p.35). Or, au VIIe siècle, on insiste sur l’unité sensible/visible et, dans l’orthodoxie, sur une déification de l’homme, laquelle ne considère pas le corps comme une punition divine infligée à l’homme. Dès lors, la conception du corps, la distance à celui-ci, la mort physique et la pensée de la résurrection ont un impact important sur la fonction même de l’image, à la fois souvenir et relique ce qui éloigne totalement du modèle antérieur du Sage antique : on lui préfère dorénavant celui du saint homme.
C’est dans le contexte de l’affrontement antijudaïque, qui se déroule autour de Jérusalem (retour juif en 618, reconquête chrétienne en 630), et de l’essor de l’islam que le statut doctrinal des images se trouve modifié par le concile In Trullo en 691-692 ; un canon y énonce la préférence pour la représentation du Christ et des Saints plutôt que celle de ses signes symboliques (agneau, vigne, poisson…). La conclusion de la violente crise interne favorable aux iconodoules permet le portrait iconique qu’elle installe en fait au cœur des pratiques religieuses. Gilbert Dagron souligne l’importance de ce passage du temps de la Loi au temps de la Grâce où l’on accepte le dépassement de l’interdit vétéro-testamentaire par le sacrifice christique qui réintègre l’homme dans la hiérarchie de la Création. Cette victoire n’introduit pas une liberté totale pour l’image et pour sa production, tant s’en faut. Cette production d’images, et les codes y afférant, est encadrée par un arsenal théologico-politique : le travail du peintre doit s’effacer, comme homme, au bénéfice de la représentation ; « de l’image à l’icône » est l’intitulé choisi par Gilbert Dagron pour décrire cette abolition de la distance du signe et de la représentation (on notera au passage une très belle citation du patriarche Nicéphore, p.68).
Cette codification n’est pas une création ex-nihilo, mais elle s’insère dans une longue tradition juridico-littéraire grecque de deux manières : d’une part, par l’ekphrasis dont le but était de peindre avec les mots, qui racontent l’image accomplie, et cela uniquement par le talent de la langue et du vocabulaire ; d’autre part, par l’inverse, l’eikonismos qui réduit les caractères à représenter (décrire). Véritable portrait-robot, l’eikonismos doit permettre de classer et d’identifier par l’emploi d’adjectifs qualificatifs appropriés. Ce procédé suit les traditions de la médecine hippocratique et des traités de Physiognomonica (revenus à la mode à partir de la fin du XVIIIe siècle) : leur but est d’attribuer des vertus et des sentiments aux modèles représentés. Ces « fantaisies littéraires » (p.135), créées au cours de ces premiers siècles, forment des types désormais adoptés par l’iconographie. Cette appropriation par Byzance s’effectue tout en modifiant des éléments descriptifs : certains s’épuisent (par exemple, la couleur des yeux dans le portrait), d’autres apparaissent (comme la barbe qui occupe une place de plus en plus grande p.161).
L’usage de cette façon de décrire est abondant ; on ne le retrouve pourtant que partiellement dans la constitution de certains livres. Ainsi, le monumental synaxaire de Constantinople (2e moitié Xe siècle) composé d’un millier de notices de Saints compilant les synaxaires et ménologes (vies de saints) antérieurs, comporte seulement 32 eikonismoi. En fait, on assiste peu à peu à un abandon des mots (eikonismoi) au bénéfice de l’image : l’image est devenue sa propre expression, sa propre référence.
La représentation du Christ peut alors se concevoir uniquement par certaines références, hors de toute vraisemblance, puisque l’essentiel réside dans la transmission d’un message ; ainsi, pour Jean Chrysotome, le Christ est laid pour mieux mettre en valeur sa beauté spirituelle. Sa polymorphie – à la fois vieux, jeune et enfant suivant le passé, le présent et l’avenir) – est liée à ses aspects changeants et multiples, dont la Résurrection et la Transfiguration) ; elle coïncide aussi avec son absence de nom puisqu’il est tous les noms car aucun ne lui convient (selon la citation d’Origène, p.183) : nous sommes donc en présence d’une aporie que le portrait iconique s’efforce de dépasser en visant, non la ressemblance et le naturel mais, à travers l’icône, l’âme du spectateur. On rencontre alors à nouveau une idée néo-platonicienne : il ne faut pas reproduire ce qui est, mais seulement l’idée qu’on s’en fait. Le peintre lui-même est impuissant, n’étant pas l’auteur de son œuvre, comme l’image achéiropoiète (c’est-à-dire miraculeuse) qui montre que c’est son modèle (un saint, un apôtre ou le Christ) qui l’inspire afin que l’icône réponde à sa fonction. De ce fait, le surnaturel de l’icône réside dans cette inspiration du peintre par son modèle.
Selon Gilbert Dagron, cet « auto-référencement » du portrait iconique à son sujet accentue encore l’importance de l’icône, puisqu’elle revêt désormais un caractère d’authentification : l’image est vraie car elle répond à l’image qu’on a de cette image. On retrouve ainsi des préoccupations contemporaines tel qu’on l’entend fréquemment : « c’est vrai parce que c’est à la télévision ». Par-delà le caractère ardu de certaines démonstrations de l’auteur, on voit que son objet se trouve au cœur de la question de l’image, principal horizon de l’information dont la présence apparaît omniprésente. D’une autre manière que Serge Gruzinski, et aussi par une démarche méticuleuse qui s’appuie sur une abondante et très belle iconographie, Gilbert Dagron offre là des outils puissants pour penser cet imago mundi.
CR de Alain Hugon, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Caen Basse Normandie, auteur de Rivalités européennes, 16e-18e siècles (2002) et de Au service du Roi Catholique (2004).