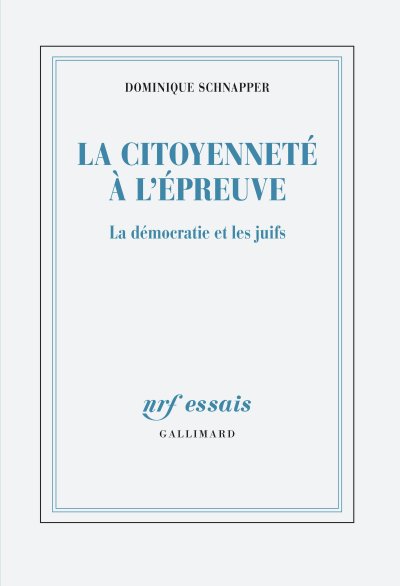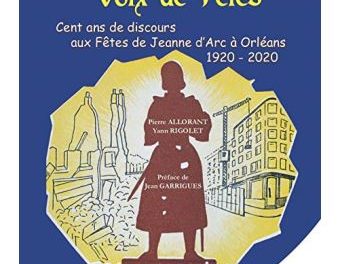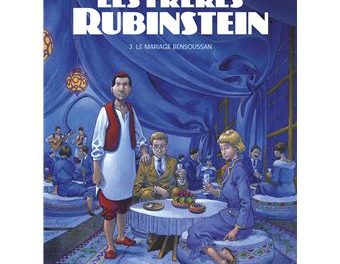Questionner la démocratie
Les réflexions d’Hannah Arendt sur les rapports des juifs au politique, notamment le distinguo qu’elle opérait entre d’une part les autorités supérieures et d’autre part, autorités subalternes et gens du peuple, conduisent Dominique Schnapper à questionner de nouveau le rapport des juifs au politique dans les démocraties occidentales. Elle entend ainsi poursuivre la réflexion entamée dans La communauté des citoyens1. S’il y a en effet prééminence de la citoyenneté démocratique et nationale, les citoyens peuvent aussi entretenir une histoire et des éléments particuliers à un grand nombre de juifs qui furent aussi enthousiastes dans leur citoyenneté nationale qu’ils demeurèrent attachés à des éléments divers de leur judéïté. Dans cette enquête, l’auteure entend, non pas écrire une énième histoire juive en Europe, mais questionner la démocratie elle-même à travers ce que nous enseigne son rapport aux juifs. Elle est consciente de deux obstacles à sa démarche : d’une part, la pléthore d’études historiques ou sociologiques sur les Européens juifs ; d’autre part, l’atomisation d’études en sciences sociales désormais définies par leurs objets concrets : les noirs, les juifs, les femmes, etc. Ces champs forment autant de groupes recrutant parmi les chercheurs issus du milieu étudié et entretenant l’entre-soi. La conséquence est que peu de chercheurs hors des ghettos intellectuels possèdent les mêmes repères. Aussi, en voulant ouvrir des portes, l’auteur avertit le lecteur qu’elle devra répéter des éléments connus des chercheurs des études juives mais dont la fréquentation de ses collègues non-juifs lui a enseigné qu’ils étaient méconnus en dehors. On l’approuvera en appliquant bien volontiers cette remarque à toutes les autres études possibles. Les études sur les expériences arabes (expérience française d’une apparence physique et/ou patronymique arabe), noires, féminines ou homosexuelles peuvent en effet mettre en évidence le même paradigme.
Expérience juive du politique
Dominique Schnapper pose pour cadre spatial l’expérience juive qui débute dans le monde occidental avec l’Émancipation liée à la Révolution française. Ce bouleversement constitue un défi majeur à l’existence même de groupes qui s’étaient préservés dans la séparation. La sociologue relève la marginalité relative de la question dans l’historiographie de la Révolution. Rendant compte de l’évolution de la condition juive en différents pays d’Europe, elle montre comment les juifs peuvent connaître une intégration qui relève de l’ethnicité, comme aux États-Unis, ou du religieux, comme dans les premières années de l’Émancipation en France. L’usage qu’elle fait de l’opposition nation civique/nation ethnique peut cependant être fragilisée par l’existence, dans certains États, demeurés il est vrai hors de son champ d’analyse, d’une citoyenneté englobant une nomenclature de nationalités très officiellement répertoriées. Cette opposition civique/ethnique est également relativisée dans sa pertinence par le fait que la République coloniale a développé l’exemple d’une nationalité où la citoyenneté demeurait minoritaire. Rappelant la culture de passivité attribuée aux juifs par Hanna Arendt, Gilbert Raoul ou par les acteurs de la fondation d’Israël, la sociologue convoque d’autres auteurs pour poser en contrepoint qu’on ne peut survivre plusieurs siècles sans un minimum de conscience politique. Elle rappelle également quelques fondamentaux comme le fait que « l’an prochain à Jérusalem » de la prière de Pessah/Pâque peut aussi renvoyer à l’aspiration des hommes à la perfection morale. On peut comprendre ici comment, après le ghetto (et l’on songe à Marx ou Freud hors du Judenviertel), l’individu émancipé d’une tradition religieuse, peut, par son rapport devenu critique à tout héritage intellectuel, développer une affinité élective avec la rationalisation qu’implique la modernité. Devant le constat du faible nombre de mariages mixtes dans les différents États au début des émancipations, Dominique Schnapper renvoie pertinemment à l’endogamie propre à l’ensemble des groupes dans des sociétés qui ne sont jamais fluides. Elle n’en relativise pas moins l’idée juive d’une symbiose culturelle entre juifs et non-juifs au XIXe, dans les pays germaniques, berceau de la Haskala (les lumière juives).
Promesse républicaine
On ne peut qu’approuver avec l’auteure la nécessité de décloisonner les frontières entre des groupes constitués autour d‘objets de recherches atomisés des sciences humaines. On acquiesce aussi au constat que les catégories des sociologues usent des même mots que le langage courant (l’histoire connaît le même problème). Cependant, l’ouvrage questionne les éléments d’un corpus documentaire académique mais ne relève pas d’une recherche au sens historien du terme. On peut ne pas valider tous les outils servant la démonstration. La référence constante à une chronologie pourtant malmenée par les recherches de ces dernières décennies peut manquer de prudence. On aurait également apprécié moins de légèreté à propos d’une loi de 1990, ici datée de 1972, ou à propos de Roosevelt dans le maintien de la législation antisémite en Afrique du Nord en novembre 1942. Il n’est par ailleurs pas certain que l’antisémitisme ait été aussi nettement perçu comme non « respectable » après le génocide : à l’aube des années 1960, chez les Français les plus âgés, il l’emportait sur les autres objets du racisme. Contrairement à une allusion répétée dans l’ouvrage, ce n’est pas tant à une « question juive » qu’on faisait référence dans les années d’après-guerre qu’à un « problème juif ». Un certain nombre de confusions lexicales ne sont pas évitées et peuvent surprendre sous le clavier d’une auteure réputée : le terme « laïc » employé selon trois acceptions dont l’une amalgamant sécularisme et laïcité, une confusion ethnonymes/ fidèles d’une religion ou l’usage sans guillemets d’une expression posant problème. L’un des axes essentiels de l’ouvrage est celui de la promesse républicaine déçue. Or, outre que le terme « République » renvoie en France au modèle laïque de la démocratie libérale, aucun des pays cités ne prétend à la démocratie au début des périodes étudiées, si ce n’est la France de 1792-1794. Aux États-Unis, le projet de départ est résolument libéral et récuse le principe démocratique. Ce dernier est appréhendé d’une façon quelque peu téléologique et sans le distinguo essentiel entre le libéralisme hérité de John Locke ou Montesquieu, et la poussée démocratique obligeant le premier au compromis de la démocratie libérale2. Cette chronologie opposant les libéraux (devenus les conservateurs à l’instar de Thiers) à la « vile multitude » varie selon les États mais, malgré le sentiment d’un progrès, on ne peut évoquer, sauf de façon téléologique, une promesse démocratique avant le XXe siècle.
Ce livre donne à connaître à des non-spécialistes la diversité des expériences juives. Il a une résonance particulière en un temps où la moitié des actes racistes visent des juifs, pourtant estimés à 1% de la population française. Malgré quelques imperfections, l’ouvrage a sa place dans la bibliothèque d’un enseignant désireux de mieux connaître et penser l’expérience juive, en particulier dans la société française, pas seulement pour elle-même mais parce qu’il y a nécessité d’ouvrir le champ par trop cloisonné des expériences de minoritaires comme de celles des femmes. Toutes nous disent quelque chose de l’état de la démocratie.
1Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Folio, 1994, 2003.