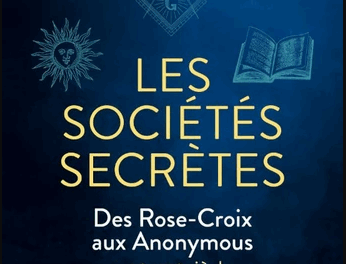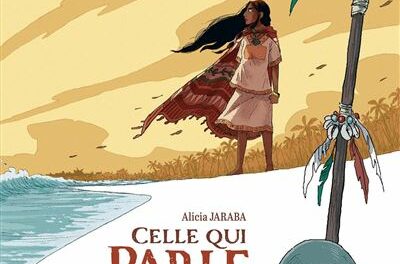À la lecture de la biographie de Doña Gracia Nasi publiée en 1948 par Cecil Roth, on ne peut que s’étonner que les vicissitudes de l’existence de cette femme exceptionnelle du XVIe siècle n’aient jamais inspiré un réalisateur de cinéma ou un auteur de roman graphique. Pourtant, la publication de trois romans entre 1994 et 2010, en français, anglais et portugais, ayant choisi Gracia Nasi pour héroïne, aurait pu y contribuerCatherine CLÉMENT, La Señora, Calmann-Lévy, 1994 ; Andree Aelion BROOKS, The woman who defied kings: The Life and Times of Doa Gracia Nasi—a Jewish Leader During the Renaissance, Paragon House, 2002; Esther MUCZNIK « Grácia Nasi. A Judia portuguesa do século XVI que desafiou o seu próprio destino », Lisbonne, A Esfera dos Livros, 2010.. Pour ma part, la première rencontre avec cette figure méconnue du siècle d’or européen s’est faite au hasard d’un manuel scolaire de Seconde, par un texte de l’écrivain espagnol Andrès Laguna décrivant son entrée digne d’une princesse dans l’Istanbul de Soliman le Magnifique en 1553 (extrait situé à page 96 de cet ouvrage). Malheureusement, la référence de l’auteur dans le paratexte était erronée et indiquait un certain « Cecil Rhodes », connu comme un homme politique et businessman britannique, fervent militant colonialiste.
Le « vrai » auteur, Cecil Roth, était un grand historien britannique, spécialiste de l’histoire du judaïsme. Comme il le confesse dans son introduction, c’est en préparant la biographie de Joseph Nasi, duc de Naxos, qu’il a fait la découvert de la tante, Gracia Nasi, personnage dont le destin d’exilée l’a immédiatement « captivé ». Ainsi, la même année, il rédigea la biographie du neveu Cecil ROTH, The House of Nasi : the Duke of Naxos, Jewish Publication Society of America, 1948. et de la tante (doc. 1). Si « ce travail s’accomplit avec une rapidité déconcertante » (p. 17), cela tient certes à la fascination pour son personnage, mais aussi à l’existence de travaux sur la famille juive des Nasi par un historien allemand du XIXe siècle, mais surtout à la publication d’un article par une historienne française en 1929, que l’on peut considérer comme la première biographie du personnage de Doña Gracia NasiAlice FERNAND-HALPHEN, « Une grande dame juive de la Renaissance – Gracia Mendes-Nasi », Revue de Paris, 1929, 36-17, p. 148-165..
C’est à une itinérance à travers une partie du continent européen que nous convie cet ouvrage (doc. 2). Née à Lisbonne vers 1510, celle qui se nomme alors Beatriz de Luna n’apparaît pas dans la documentation de l’époque, si ce n’est indirectement lorsqu’elle devient en 1528 l’épouse de Francisco Mendes de la riche famille Benveniste, puis sa veuve en 1536. L’auteur n’en sait guère plus sur sa fuite vers Anvers, la capitale marchande des épices en Europe, après une hypothétique escale à Londres. C’est donc à travers les activités commerçantes et financières de la famille Mendes que la vie anversoise de Gracia transparaît, mais aussi grâce au testament de son beau-frère Diogo Mendes. Après avoir fui l’Inquisition nouvellement créée au Portugal en 1536, Gracia et sa famille se retrouvent exposées aux menaces récurrentes qui pèsent sur la communauté des marranes d’Anvers et leurs fortunes. Ainsi, en 1544, notre héroïne s’enfuit-elle en direction de l’Italie, en compagnie de sa sœur Brianda et de deux fillettes, en choisissant la route à travers le royaume de France. Là encore, C. Roth avoue ne disposer que de très peu d’informations sur l’interlude vénitien. Pour des raisons liées au partage des richesses familiales, il semble que Gracia ait été dénoncée comme judaïsante … par sa propre sœur Brianda, puis enfermée par les autorités de la Sérénissime, bientôt suivie de sa sœur, jusqu’en 1549 ! Les deux femmes se réfugièrent bientôt dans la cité de Ferrare, en qualité de juives : c’est seulement alors qu’elle est appelée Doña Gracia Nasi.
Cette nouvelle étape de l’exil, durant près de trois ans, fait apparaître les traits principaux du personnage : non contente d’être une femme d’affaire devant gérer une immense fortune et des investissements dans de nombreuses places européennes grâce à son réseau d’agents (cf pages 124-129), elle commence sa carrière de mécène au service des lettrés, notamment le poète Samuel Usque. Surtout, elle investit une partie de sa fortune au sauvetage des marranes menacés par l’Inquisition portugaise, en accueillant des réfugiés et en facilitant les transferts financiers des membres de la communauté. Mais, après un court passage par Raguse et Salonique en 1553, c’est à Istanbul, installée dans le quartier de Galata, qu’elle dispose de toute latitude pour mener des actions philanthropiques de grande envergure, en finançant hôpitaux, synagogues, écoles talmudiques et en recréant un cercle littéraire. C’est aussi durant les années stambouliotes jusqu’à sa mort vers 1569 que l’on mesure l’influence de cette femme, au-delà des communautés juives de l’Empire ottoman (pour lesquelles on trouvera deux témoignages intéressants pour les enseignants aux pages 106 à 109) et des groupes marranes d’Europe qu’elle contribue à protéger. Elle a partie liée avec la cour du sultan, grâce au grand vizir Rustam pacha auquel elle fait appel en 1556 pour tenter de sauver la communauté juive d’Ancône menacée par la justice pontificale. Mais les divisions entre les communautés marchandes juives de l’Empire conduisent à un échec du blocus de la cité marchande des États pontificaux en 1556-1557.
La biographie de la marrane portugaise Beatriz de Luna, devenue Doña Beatriz Mendes par alliance matrimoniale, puis Doña Gracia Nasi une fois révélé son judaïsme à Ferrare puis à Istanbul, est symptomatique du destin des communautés juives d’Europe, obligées de fuir les persécutions conduites par l’Inquisition dans différents royaumes, empire et cités maritimes. Mais cette femme exceptionnelle n’en fait pas moins partie d’une élite privilégiée au sein de la diaspora juive, en mesure de monnayer sa liberté auprès de souverains et de poursuivre ses activités mercantiles aux quatre coins de l’Europe, y compris à partir de son ultime refuge d’Istanbul. Son itinéraire personnel témoigne d’un renversement historique séculaire : alors qu’au XVIe siècle, des communautés religieuses devaient fuir l’Europe intolérante pour aller se réfugier en Turquie dans un empire musulman plus accueillant, ce début de XXIe siècle voit des réfugiés issus de cet ancien empire tenter l’impossible pour accéder aux rives nord-méditerranéennes, synonymes de sécurité et de liberté.
La mise en exergue de la vie de cette femme par Cecil Roth en 1948 doit néanmoins être appréhendée avec une double mise en garde, inhérente au contexte de rédaction et sans doute aux affinités individuelles de l’auteur. Ce dernier ne cache pas son empathie et son admiration pour son objet d’étude, comme en témoignent les deux extraits suivants : « rien ne pouvait encore laisser supposer qu’elle deviendrait une des femmes les plus remarquables d’une époque particulièrement fertile en grandes figures féminines, et peut-être la femme juive la plus brillante de toute l’histoire » (p.31), ou à la toute fin : « Jamais dans l’histoire juive le décès d’une femme n’avait été pleuré par tant de juifs. Jusqu’à nos jours, aucune autre juive n’accomplit une destinée si exceptionnelle » (p. 192) Je laisserai aux lecteurs le soin de lire le morceau de bravoure de cette apologie de Gracia, situé à la page 143…. La narration n’est parfois pas très éloignée d’une histoire militante, avec un manque de recul et une volonté de juger les acteurs de l’histoire, la sœur cadette Brianda devenant sous sa plume une femme « égoïste, versatile, irresponsable » (p. 66) et « volage » (p. 95) ! Il est vrai que ce travail historique souffre parfois de l’absence de sources historiques directes sur le personnage central, remplacées par des contextualisations assez longues sur les communautés juives des différentes villes de résidence de Gracia et des tableaux individuelles de personnalités ayant fréquenté « la Dame » . On peut d’autant plus regretter et s’étonner de l’absence de textes de la main de cette dernière, alors même que C. Roth mentionne une lettre de 1559 à son associé Duarte Gomez… qu’il préfère ne pas citer pour des raisons de longueur et de complexité (p. 189), mais sans pour autant nous donner la référence de cette source.
Par ailleurs, il faut se souvenir que la rédaction de cette biographie d’une persécutée exilée se situe dans le contexte post-génocidaire : l’auteur fait d’ailleurs quelques références à la situation de la communauté juive d’Allemagne et d’Europe sous Hitler, pour faire le parallèle entre le projet de blocus d’Ancône en 1556 et la tentative de blocus de produits allemands en 1933 (p. 168) ou la persécution des juifs de la même cité et celle des juifs d’Italie entre 1943 et 1945 (p. 149). L’auteur insiste aussi à de multiples reprises sur la dimension pieuse de son héroïne, dont le projet de fin de vie consistait à s’installer en Terre sainte, précisément à Tibériade, où elle disposait d’une demeure et de privilèges du sultan pour « fonder une nouvelle colonie juive autonome » (p. 190). Il y a peu de doute que si cette biographie avait été rédigée quelques années plus tard, Cecil Roth aurait pu faire de Doña Gracia Nasi l’une des fondatrices du projet sioniste, avant que le flambeau ne soit porté par une autre femme juive au destin exceptionnel, Golda Meir !
Quoi qu’il en soit, on ne peut donc que se réjouir de la réédition de cet ouvrage à la lecture plaisante, facilitée par la présence d’une chronologie, d’une généalogie, d’un index et d’une carte de l’Europe au milieu du XVIe siècle. Néanmoins, pour remédier au biais historiographique et à la force du contexte sur la rédaction de l’ouvrage, il serait tout aussi important de procéder à la traduction de l’anglais de ce qui apparaît désormais comme l’ouvrage de référence sur ce personnage de Gracia Nasi, à savoir The Long Journey Of Gracia Mendes, par Marianna Birnbaum, professeure émérite à Université de Californie Los Angeles, paru en 2003.