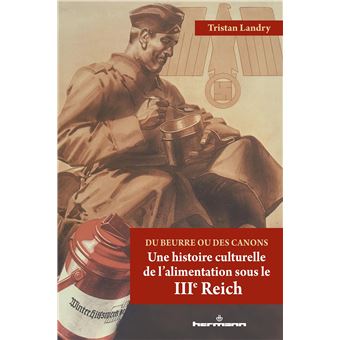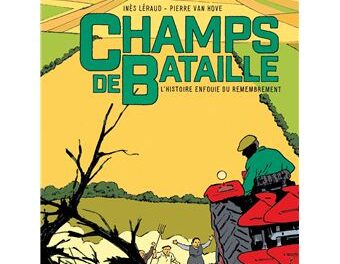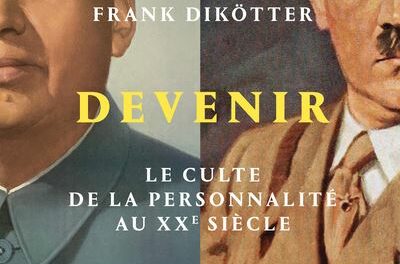Tristan Landry est historien, professeur à l’Université de Sherbrooke (Canada), où il enseigne l’histoire de l’Europe contemporaine. Il est l’auteur de La mémoire du conte folklorique de l’oral à l’écrit : les frères Grimm et Afanas’ev et La valeur de la vie humaine en Russie, 1836-1936 : construction d’une esthétique politique de fin du monde. Il a été bénéficiaire d’une prestigieuse bourse de la Fondation Alexander-von-Humboldt. Son ouvrage a été précédé d’un certain nombre de communications en amont sur la question de l’alimentation sous le Troisième Reich.
Cette étude se présente comme un ouvrage de synthèse sur la question alimentaire sous le régime nazi. Une abondante bibliographie en fin d’ouvrage ainsi que les sources allemandes consultées permettent de mesurer la somme de travail produite par Tristan Landry. Ce livre a également l’avantage, reconnu par l’historien de pouvoir être lu dans l’ordre souhaité par le lecteur soit en suivant la logique narrative des chapitres qui se succèdent, soit en adoptant une logique thématique, selon les centres d’intérêt ou les renvois effectués par l’auteur. Cette étude à l’écriture fluide se compose de neuf chapitres accompagnés de neuf recettes dont celle de « la fausse cervelle » et d’un gâteau aux noisettes d’époque. Leur présence pourrait intriguer mais la lecture des chapitres les justifie pour peu qu’on les lise attentivement.
L’introduction démarre sur plusieurs anecdotes montrant que, de nos jours, le nazisme se cache encore potentiellement dans l’assiette. Ainsi en 2016 le restaurant Goldener Löwe prend l’initiative de proposer un repas à 8,88 euros le 20 avril, manière non subtile de rendre hommage à Hitler tout en prétendant ne pas y toucher. Mais ces anecdotes sont révélatrices du lien entretenu entre le national-socialisme et la question de l’alimentation.
L’ouvrage part d’une hypothèse : celle de la faim endurée par les Allemands durant la Grande Guerre, cette dernière ayant constitué un champ d’expériences centrales à partir de laquelle la politique alimentaire de l’Allemagne nazie s’est bâtie. Or, justement ce champ d’études spécifiques s’est renouvelé depuis plusieurs années suivant deux axes :
- la fonction de l’importance de l’alimentation dans la politique de la propagande nazie,
- le lien entre extermination et sécurité alimentaire du Reich.
Si les débats restent encore nombreux et promettent encore des études intéressantes, Tristan Landry propose quant à lui une synthèse (convaincante) unissant ces deux axes et la manière dont l’idéologie du Blut und Boden s’est construite et exprimée.
De l’insécurité alimentaire …
Le chapitre I, intitulé liberté et pain remet en perspective le postulat de départ. En effet, Tristan Landry rappelle que l’histoire de l’Allemagne, ponctuée de périodes de disettes et de famines, reste marquée par une insécurité alimentaire qui a durablement et profondément frappé la population. Il part cependant d’une hypothèse : celle d’une exacerbation de cette peur liée à la Première Guerre mondiale et au blocus mené par la Grande-Bretagne dès 1914.
Or, pour l’Allemagne, la notion d’espace alimentaire rejoint celle de l’espace vital. Cette conjonction découle d’un problème formulé par Malthus à la fin du XVIIIème siècle : une population qui augmente en nombre est appelée un jour à excéder les ressources nécessaires à sa survie. Or, au XIXème siècle, d’un côté on constate que le nombre de calories consommées en Prusse par jour et par personne ne fait qu’augmenter et passe de 1900 calories en 1806 à 2900 en 1849. Mais de l’autre, il faut rappeler que ce nombre ne suffit pas forcément à assurer une bonne santé puisque le nombre de calories n’indique pas si les besoins nutritionnels sont couverts et, le plus souvent, il masque les carences en vitamines B ou C par exemple.
Plus globalement, si la révolution agraire du XVIIIe siècle a favorisé une plus grande diversité dans le régime alimentaire des Européens, pour autant certains problèmes de fond n’ont pas été résolus, notamment en Allemagne, ce que traduit l’immigration allemande au siècle suivant. En effet, entre 1820 et 1895, plus de 6 millions d’Allemands migrent et, souvent, pour une raison alimentaire. Mais ce problème, qui ne peut être surmonté en augmentant simplement les terres arables, alimente envers et contre tout une angoisse perceptible à la fin du XIXème siècle.
Cette angoisse est notamment liée aux années 1846 – 1848, marquées par des émeutes de la faim. Ce souvenir traumatisant, ancré dans la mémoire collective a eu, sur les moyens et longs termes, une double incidence : d’une part il provoque une prise de conscience chez les Allemands de leur précarité alimentaire, et d’autre part il alimente la question coloniale, puisque les colonies auraient pu résoudre, selon certains, le problème alimentaire rencontré par le pays. C’est ainsi que le désir de possession coloniale et les fantasmes qui l’accompagnent, émergent comme hypothétique solution à la question alimentaire. Pourtant, Bismarck, lucide sur les impasses d’une telle politique, rejette la solution coloniale contrairement aux rêves et aux ambitions d’une partie de la population allemande. Malgré tout, dès la fin du XIXe siècle, question coloniale et sécurité alimentaire sont désormais intimement liées en Allemagne. Or, au moment où démarre la politique coloniale allemande, le zoologiste Gustav Tornier publie un ouvrage en 1884 où il distingue trois types de combat :
- le combat avec la nourriture (qui permet de surclasser l’adversaire)
- le combat pour la nourriture (qui amène une sélection des individus)
- le combat comme nourriture (qui alimente le moral des troupes)
… au traumatisme de la Grande Guerre
La Première Guerre mondiale est marquée par la question du blocus et de ses conséquences. Ici, l’auteur reprend la thèse formulée par Avner Gopher. La Grande-Bretagne a effectivement préparé entre 1905 et 1908 un plan destiné à affamer les Allemands en cas de conflit. Ce plan, appliqué dès la fin de l’été 1914, est né de la prise de conscience que l’Allemagne dépend des importations en général depuis 1870. En effet, à la veille de la guerre, elle permet d’assurer un tiers de ses besoins alimentaires dont 27 % des besoins en protéines (page 46). Dès novembre 1914, un conseil privé, conscient de cette faiblesse, met en garde le gouvernement allemand sur ce point. Ce dernier pense malgré tout pouvoir tenir cependant jusqu’aux prochaines récoltes, car rappelons-le, à ce moment, les divers protagonistes n’envisagent pas une guerre de quatre ans.
Mais, entre-temps la crainte de manquer fait toutefois émerger dans la presse, des recettes de cuisine adaptées. Ces dernières sont adaptées au gramme près, tandis que des ersatz, des succédanés et des additifs sont proposés en remplacement ou en complément tout en suscitant des débats. Globalement le spectre de la pénurie alimentaire stimule l’imagination dès la fin de l’année 1914. L’auteur en profite pour nous rappeler que c’est justement durant la Première Guerre mondiale que se situe l’histoire, symptomatique, de deux tueurs en série allemands cannibales (des criminels rares par leur nature) dont celle de Karl Grossman qui tenait à Berlin un stand de hot dog composés … des chairs des jeunes femmes qu’il avait tué …
À partir de 1916 la situation devient dramatique puisque les pénuries alimentaires ont un impact démographique direct avec des avortements et des problèmes d’aménorrhée en hausse visible chez les femmes. 1917 est marquée par des manifestations de la faim dans la ville de Prenzlau par exemple. La signature du traité de Brest-Litovsk apporte un espoir vite déçu, puisque ce dernier n’ouvre pas le grenier à blé de l’Ukraine comme prévu. La situation de l’Allemagne devient catastrophique. La fin de la guerre n’est pas non plus la solution puisque le blocus est levé très tardivement le 12 juillet 1919 après la signature du traité de Versailles, le blocus servant d’arme politique pour forcer les Allemands à ratifier le traité de paix (quoiqu’il en coûte serait-on tenté de penser …). Cette utilisation du blocus pèse par la suite très lourd dans l’opinion allemande dans sa perception du Diktat de Versailles.
De même, on oublie souvent que le traité contenait un certain nombre de clauses alimentaires prévues en guise de réparation des « animaux détruits ». Ainsi, il est prévu que l’Allemagne doit livrer 810 000 vaches laitières, demande à la fois déraisonnable et catastrophique alors que dans le même temps les articles scientifiques démontrent le retard de développement des jeunes enfants. Rappelons qu’Hitler fait preuve d’une réelle lucidité politique en écrivant dans des notes que : « la liberté et le pain sont le slogan le plus simple, mais en réalité c’est aussi le slogan de politique étrangère le plus puissant qui puisse exister pour un peuple ». (Page 74)
Ces pénuries alimentaires excitent, logiquement les tentatives révolutionnaires et l’antisémitisme comme en témoigne le 5 novembre 1923 le saccage du quartier juif de Berlin. Dès lors, sous la République de Weimar la faim devient un thème politique pour tous les partis et plus encore après la crise de 1929. Rappelons ici l’impact du slogan choisi par le NSDAP : « pain et travail pour tous ». Dès leur accession au pouvoir, les nazis font de la faim un thème central de leur propagande et rappellent régulièrement le traumatisme engendré par le blocus et la peur de la faim ainsi que leur promesse d’y mettre un terme définitif. Ainsi l’une des premières scènes du Triomphe de la volonté met en scène des cuisiniers affairés à cuisiner tandis que le film de propagande Le juif Süss entretient la mémoire des émeutes de la faim de 1847.
Les vertus de l’agriculture biologique
Le chapitre II, intitulé sang et sol, aborde principalement la question de la fertilité des sols. En effet, la question de la sécurité alimentaire passe également par celle de leurs rendements. Suivant une loi formulée au XIXe siècle par Justus von Liebig, un système agraire ne peut se maintenir sans une méthode de renouvellement de la fertilité de ces derniers (sauf exception). Même si on peut multiplier le nombre de bras qui travaillent la terre, une lucidité scientifique s’impose : elle ne peut pas produire davantage si elle n’est pas enrichie de manière artificielle. Dès le XIXe siècle la question fait l’objet d’une recherche et, après utilisation du fumier, du guano, qui pour ce dernier suppose une dépendance également vis-à-vis des importations en provenance du Chili (faiblesse que très rapidement certains comme Wilhem Ostwalt souligne), puis la synthèse de l’ammoniac et les engrais chimiques. Mais, très rapidement leur utilisation se heurte aux problèmes de pollution constatés dès le début du XXe siècle.
Ce constat a pour conséquence de voir se développer en Allemagne très tôt une agriculture biologique qui, conjuguée au mouvement de la réforme de la vie qui est à la recherche de voies de développement plus naturelles, préconisant le végétarisme, le nudisme, la médecine alimentaire, mais aussi le refus des vaccins, du tabac et de l’alcool. Les nazis reprennent à leur compte ces réflexions. C’est ainsi qu’Heinrich Himmler et Rudolf Hess montrent leur grand intérêt pour l’agriculture biodynamique, intérêt et engagement qui ne sont cependant pas partagés par tous au sein du parti nazi, loin de là. Mais malgré les débats et les oppositions, l’agriculture biologique demeure pour beaucoup de nazis un idéal à atteindre.
L’ensemble de ces réflexions aboutissent à des expérimentations et des comparaisons dans des champs à Dachau et à Auschwitz mais aussi dans quelques territoires occupés, entre l’agriculture biologique et celle utilisant des engrais artificiels. Comme le résume Tristan Landry : « l’agriculture biologique est en accord avec l’idéologie nazie tandis que l’agriculture chimique était plutôt conforme à la réalité » (page 89). La sélection des plantes et des animaux fait également partie de la préoccupation des scientifiques dès le début du XXe siècle des élections sont opérés parmi les plantes fourragères, le lutin et le soya sont des plantes qui ont retenu l’attention. Mais là aussi, l’introduction de cette dernière se heurte à l’idéologie nazie puisque les plantes asiatiques ne correspondent pas à l’un des axiomes centraux de la nutrition nazie ; se nourrir uniquement de ce que la terre allemande porte depuis des centaines d’années, ce qui exclue de facto les plantes importées.
L’étude de Tristan Landry montre ensuite les tensions pouvant émerger entre les hommes et les animaux, ces derniers étant des concurrents et une menace pour leur assiette. À ce titre le porc a une place à part puisque ce dernier consomme la nourriture que les hommes sont capables de digérer contrairement aux ruminants. Dès lors, une question se pose pour le régime nazi : faut-il élever des cochons alors que ceux-ci sont eux-mêmes en compétition avec l’homme pour certaines ressources alimentaires ? C’est aussi là que se pose la question du sort des cochons en Allemagne, du végétarisme et de sa (non) pertinence, question non résolue voire insoluble pour le nazisme puisque supprimer l’élevage revient à éliminer l’apport de fumier naturel pour la terre.
Le sous-chapitre un peuple sans espace et un espace sans peuple revient sur le problème formulé par Malthus concernant l’insuffisance des terres agricoles en Europe. Si l’augmentation du rendement est une solution, d’autres sont également formulées tels que le projet Atlantropa d’Herman Sörgel (page 105). L’auteur revient également sur la solution maritime : « cultiver » la mer est envisagée comme une solution, mais elle s’avère difficile, les Allemands, attachés à la terre et à la campagne, n’étant pas des mangeurs de poissons, et ce en dépit des efforts pour convaincre la ménagère d’en proposer davantage sur la table comme le montre par la suite le chapitre trois de l’étude.
Dès lors, la colonisation intérieure (donc en Europe), solution logique, l’emporte dans les esprits. Elle est parée de toutes les vertus possibles, car jugée conforme au caractère des Germains. L’auteur démontre ainsi pourquoi et comment la question de l’expansion à l’est rejoint aussi des préoccupations agricoles liées à la sécurité alimentaire du Reich. Mais l’expansion suppose de se heurter au Slave, jugé incapable de cultiver mais aussi vu comme une menace par son expansion démographique. L’idéologie du Blut und boden a pour dogme de nourrir les Allemands grâce aux ressources de leur sol pour des raisons mystiques. Cet aspect fait notamment l’objet d’une analyse au chapitre quatre.
Frugalité et Eintopf
Le chapitre III qui donne son titre à l’ouvrage, du beurre ou des canons, s’ouvre sur une autre inquiétude des nazis : que faire face à la croissance annoncée de la population européenne puisque des experts estimaient que cette dernière allait doubler dans les 60 prochaines années ? Dès lors, quelle dynamique économique adopter ? Pour les nazis, comme le dit l’auteur : « déconnecter l’économie allemande des marchés internationaux et développer l’autarcie alimentaire était nécessaire afin de contrer la menace de la famine » (p. 128). C’est ainsi que la lutte contre le gaspillage et le calcul du seuil minimal calorique nécessaire pour chaque individu deviennent une préoccupation et un objet de recherches.
La frugalité devient une vertu vantée par les hauts dignitaires (même si on imagine mal Göring s’y livrer…), la question de la possession d’un réfrigérateur, moyen de lutter contre le gaspillage, est posée … mais tout ceci passe notamment par la rééducation de la ménagère, donc de la femme qui est amenée à jouer un rôle central (page 132). Cet aspect est assuré par une des rares femmes impliquées dans la propagande nazie : Gertrud Scholtz-Klink. C’est ainsi que, selon le discours établi, le devoir de ménagère est avant tout de remettre en valeur les ressources alimentaires locales, pratiquer le recyclage des déchets de table, cuisiner de saison en utilisant le moins d’énergie possible tout en proposant et en maîtrisant la gastronomie nationale. Elles sont encouragées à utiliser le soya malgré les débats entourant la plante, mais aussi à préparer le sang sous toutes ses formes, les recettes de boudin étant courantes dans les livres de cuisine. Le plat qui retient surtout l’attention est l’Eintopf, véritable plat populaire et national se déclinant sous de nombreuses formes mêmes si les spécialistes de la nutrition le jugent peu convaincant, c’est-à-dire peu nourrissant.
L’invasion de l’Europe s’accompagne d’une augmentation de la surface agricole disponible. À ce titre l’intégration du protectorat de Bohême Moravie dans le Reich au printemps 1939 permet d’intégrer 5,2 millions d’hectares et de réduire ainsi le nombre d’habitants pour cent hectares. De même, des calculs sont effectués lors de l’invasion de la Pologne. Tristan Landry revient aussi sur la question de l’invasion de la France qui n’a pas répondu qu’à des intérêts stratégiques, contrairement à certaines idées reçues. En effet, les experts nazis spécialisés dans les questions agroalimentaires avaient parfaitement perçu l’intérêt des terres agricoles françaises dans l’objectif de réaliser l’autarcie alimentaire allemande. Dès 1940 certains avaient donc envisagé de faire de la France un pays agraire uniquement dédié à la production alimentaire bien entendu en faveur du Reich, d’autant que, après calculs certaines productions de l’hexagone notamment céréalières, pouvaient être largement améliorées.
Les vertus de l’utopie végétarienne selon Hitler
Le chapitre IV intitulé une alimentation pure, pour une race pure peut être lu en parallèle du chapitre neuf à table avec Hitler dans la mesure où il aborde la question de la nutrition nazie, ses spécificités mais aussi ses expériences médicales menées sur des cobayes et la question de la pertinence du végétarisme. L’hygiénisme et la question du régime végétarien, sont-ils préférables pour la santé ? Ce questionnement et la politique qui en découlent sont bien entendu contextualisés et resitués sur un temps long. À partir des années 30, le but n’est pas de satisfaire l’individu mais bien de servir la race mais dès la fin du XIXe siècle, plusieurs mouvements völkish pratiquent déjà le végétarisme allié à l’exercice physique dans une optique similaire.
Hitler consacre une partie de Mein Kampf à la question de la faim et à la nécessité d’utiliser tous les moyens possibles pour assurer la sécurité alimentaire des Allemands. Il est lui-même végétarien avant tout par souci économique, mais aussi crudivore par conviction, persuadé que ce régime est source de longévité, comme le chapitre IX l’explique, dans le prolongement ce chapitre IV. Hitler, (dont la propagande exploite la sobriété alimentaire comme un exemple à suivre), méprise la haute gastronomie qu’il qualifie en 1942 de « racket inventé par une bande de coquins, les chefs » (p.432), et privilégie la formule du buffet plus apte à développer l’esprit de groupe.
Cependant, il est bien conscient des limites du modèle végétarien (un idéal difficile à atteindre), et reconnaît la nécessité de donner à la population et à l’armée une nourriture plus riche et plus consistante n’excluant pas la viande. Le chapitre IV d’ailleurs souligne bien que le végétarisme complet ne fut jamais encouragé au final mais, l’objectif privilégié fut de réduire plutôt la consommation de viande, et c’est en ce sens que les experts en nutrition formulent un certain nombre de suggestions en ce sens tandis que la consommation de viande de porc, concurrent alimentaire de l’homme, est encouragée.
Boire un petit coup … mais pas plus !
La question de la pureté de l’alimentation et bien sûre aussi primordiale. Par conséquent, elle doit être la plus naturelle possible et rejeter les procédés transformant les aliments. Le pain complet est privilégié au pain blanc, les bonnes bactéries sont distinguées des mauvaises. Il est préconisé de consommer du yogourt, des produits laitiers fermentés et des fromages non pasteurisés tandis que les recherches effectuées par les nutritionnistes nazis établissent un lien entre une mauvaise alimentation (dénaturée) et le cancer ; on en déduit que plus naturel est le mode d’alimentation, plus rare est le cancer. Dès lors, le traitement des sols et la transformation des aliments sont dénoncés comme autant de causes qui dénaturent le produit de la terre et par extension l’alimentation et la santé des individus. C’est ainsi que les colorants artificiels sont interdits ainsi que l’ajout de sel permettant la préservation visuelle de la viande hachée.
L’alcool est également visé mais il est l’un des plaisirs de la table auquel il est difficile de renoncer ou de s’opposer. Depuis le XIXème siècle de nombreuses campagnes de désensibilisation avait pourtant été menées mais les préjugés positifs entourant la consommation d’alcool en général et de la bière en particulier qui, selon la croyance populaire témoigne d’une soif originelle germanique ayant pour vertu d’unir toutes les catégories sociales autour d’elle, l’emportent (page 195). Par conséquent l’idéal de sobriété du nazisme se heurte à la réalité culturelle. Finalement, la consommation avec modération reste un pis-aller, et ce, en dépit de la mobilisation de tous les acteurs possibles pour tenter de dissuader la population d’en consommer (femme au foyer, médecin, instituteur…). La question est d’autant moins évidente que les autorités se rendent compte que la baisse de la consommation d’alcool pouvait également avoir un impact économique négatif : selon des statistiques effectuées entre 1909 et 1935, moins les individus boivent d’alcool, plus la consommation de gras a tendance à augmenter, or la production de gras est au cœur de la sécurité alimentaire.
Dans ce contexte, les Jeux olympiques de 1936 tiennent une place particulière dans la mesure où ils permettent aux nutritionnistes allemands de tester leurs théories. En effet, selon eux, « le type racial conditionnait le choix des calories consommées » (page 206) mais la conclusion est là : l’alimentation olympique, où la viande et plus généralement les protéines animales sont nécessaires, ne peut pas être considérée comme un modèle à suivre pour la population. Néanmoins, les Jeux sont vus comme le moyen de confronter les diverses alimentations nationales (et de prouver la supériorité germanique) comme en témoignent les écrits du chimiste Max Winckel : pour le nazisme, une race signifie un sol, des produits et une alimentation spécifiques.
Malgré tout, malgré cette volonté d’avoir une alimentation la plus naturelle possible, la guerre confronte l’armée allemande à la réalité. L’effort de guerre nécessite des apports nécessaires surtout à partir de la fin de l’année 1942 sur le front de l’est, où les soldats allemands manquent de tout (protéines, gras, vitamines …) contrairement à ceux de l’Afrikakorps qui ne manque de rien, au contraire !
En parallèle, de nombreuses expérimentations sont effectuées sur des cobayes humains dans les camps de concentration et les centres de mise à mort, Tristan Landry nous en expose quelquesunes en guise d’exemples dans ce chapitre. Ainsi à partir de décembre 1943 une recherche est effectuée à Mauthausen sur 370 détenus souffrant de sous-nutrition sévère, divisés en trois groupes ayant chacun leur diète. Une autre expérience menée sur des Tziganes à Dachau avait pour objectif de déterminer les intérêts de la consommation de l’eau de mer à raison d’une consommation pouvant aller jusqu’à 3 litres par jour. Il est inutile de préciser le bilan et les conséquences de telles expérimentations inhumaines qui, au final n’ont en rien servi la science, bien au contraire.
Le chapitre V, D’abord allemands, ensuite chefs (page229) aborde le thème du « nationalisme culinaire » en Allemagne (page 229). L’une des particularités de la gastronomie nazie comme le souligne l’auteur, est son intérêt pour les cuisines régionales allemandes longtemps négligées et même méprisées dans un pays qui prend pour référence la cuisine française à partir du XIXe siècle. Mais si Karl Friedrich von Rumorhr publie en 1822 un traité d’art culinaire Geist der Kochkunst, il s’agit là d’une initiative isolée n’ayant que peu d’emprise sur l’opinion publique, la référence restant Escoffier. Logiquement, le régime nazi se situe en rupture et favorise la diffusion des recettes régionales et parmi ces dernières, l’Eintopf tient une place de choix. Manger local et national en fonction de ce que le sol allemand propose est aussi une manière d’entretenir la mémoire collective d’un groupe attaché à son sol et à son histoire.
Certaines spécialités sont dont encensées en tant qu’ « aliments-mémoire ». Mais cette cuisine doit faire face un certain nombre de défis car une production et une consommation nationales remettent en question l’utilisation d’épices pour la plupart issues des importations. Des équivalents locaux jugés plus sains pour le peuple allemand car lui correspondant principalement et biologiquement sont privilégiés (page 240). Enfin, la langue fait l’objet d’une adaptation et les termes et expressions françaises utilisées en cuisine trouvent leur équivalent en allemand. Le mot cognac est remplacé par Weinbrand, crème par Krem.
Enfin, des leçons devaient être tirées de la Première Guerre mondiale, et amener la population vers une alimentation saine, variée, sans luxe ni superflu. La nourriture ne doit pas se perdre tout en offrant une certaine variété et une qualité au consommateur.
Enfin la gastronomie est aussi envisagée comme art de résistance (page 266) et cette sous-partie rappelle qu’« il ne faudrait pas oublier que le troisième Reich fut un règne de faim et de mort ». La situation alimentaire des ghettos et du front de l’est. Les aspects de cette sous-partie sont plus largement abordés dans le chapitre VIII intitulé les bouches inutiles.
La valorisation de la gastronomie allemande
Le chapitre VI, la force à travers la joie replace dans le temps long la question du tourisme culinaire dans l’Europe nazie. Si Karl Baedeker [1801-1859] avait révolutionné le guide de voyage au XIXe siècle en le rendant accessible et transportable grâce à l’adoption du format de poche, la nourriture y était peu présente contrairement à la bière (!), signe du peu d’estime porté alors à la gastronomie allemande. À partir des années 30, la rupture est observable et désormais le guide Baedeker met largement en avant les spécialités culinaires disponibles dans les différentes régions d’Allemagne mais aussi dans les territoires annexés. C’est à la fois une manière de démontrer l’unité du peuple allemand et de justifier ainsi les annexions territoriales dans les années 30, mais aussi de mettre ainsi en valeur les différentes régions comme autant de rivales possibles pour la grande cuisine européenne et la française en tête dont la présence en Allemagne est occultée volontairement. Si le guide est principalement destiné aux touristes étrangers, la cuisine allemande se met au service d’un soft power opportun au moment des Jeux olympiques de 1936.
Dans le même temps, une résistance est observable au sein du personnel des hôtels restaurants et cafés, animé par des socialistes. C’est ainsi qu’un petit livre de recettes publié par le KPD s’affirme comme acte de résistance en s’accompagnant de critiques sévères contre le régime nazi.
Enfin, une sous-partie est consacrée à la gastrophobie et à la critique des cuisines étrangères (condamnées à l’oubli) et en premier lieu la cuisine française (l’Alsace exceptée bien entendue). Cette volonté de déconstruire à tout prix cette dernière (page 299) est menée par les chefs allemands comme Walther Bickel qui insiste sur sa dégradation due en particulier à certains métissages. Mais, lors du déclenchement de la guerre la réalité de terrain refait vite surface et l’occupant allemand ne dédaigne pas le contact avec la gastronomie française en particulier dans les régions viticoles ! À l’inverse, certaines cuisines savent susciter l’admiration comme certaines recettes en provenance des États-Unis dans lesquels les commentateurs y voient une influence allemande. Quid de la cuisine juive ? La cuisine ashkénaze est, bien entendu, condamnée à l’oubli elle aussi, malgré sa place majeure en Europe de l’Est.
L’architecture, prolongement matériel de l’assiette
Le chapitre VII le grand laboratoire de la santé reprend les idées déjà développées dans les chapitres précédents pour le développer. En effet, « la cuisine était censée être le laboratoire de la santé du peuple allemand et elle devait être conçue en tant que tel : ordonnée, ergonomique et aseptisée » (page 319). L’auteur revient sur la place et le rôle majeur tenu par les restaurants, lieux de mémoire par excellence et par conséquent encadrés par un système juridique rigoureux. Ainsi, les verres, les assiettes ou encore les cendriers avec une croix gammée sont interdits de même qu’il est interdit de chanter ou de jouer l’hymne national dans le restaurant … question de respect ! Tristan Landry rappelle à juste titre les origines du parti ouvrier allemand fondé en janvier 1919 dans une brasserie à Munich.
C’est ainsi que le cadre du restaurant, de cantine ou de la cafétéria font l’objet d’une attention particulière aussi bien dans la conception que l’organisation des lieux d’une part parce que le nombre d’allemands venant y consommer un repas est élevé, et d’autre part, parce que le lieu est perçu comme pouvant renforcer un sentiment d’appartenance au groupe, le tout en privilégiant la santé et l’hygiène d’où l’importance accordée à la lumière, à la qualité de l’air ainsi qu’à la santé et à l’hygiène du personnel des lieux. Quant à la cuisine domestique, incontournable, elle fait l’objet de nombreuses réflexions et de propositions. Ainsi, la question de « la maison à cuisine unique », dont l’architecture la place dans le logement et le design font l’objet de réflexions depuis le XIXème siècle, est reprise par le nazisme, toujours dans le but de rendre la cuisinière plus productive, rationnelle et économe.
Évoqué précédemment, le chapitre VIII intitulé les bouches inutiles analyse la question des vies indignes d’être vécues (page 375). Le temps long là aussi s’impose puisque c’est durant la Première Guerre mondiale à nouveau qu’émergent le concept de « bouches inutiles à nourrir », (et qu’il est testé puisqu’on fait mourir de faim 50% des patients psychiatriques) et le questionnement autour du droit de vivre de l’individu. la conclusion est radicale : il devient acceptable de sacrifier des individus au profit du peuple, idée déjà présente chez Adolf Jost qui publie en 1895 Das Recht auf den Tod. L’Aktion T4 qui débute dès janvier 1940 s’inscrit dans cette réflexion. Tandis que les invasions de la Pologne puis de l’URSS sont censées apporter des solutions pour assurer la sécurité alimentaire du Reich, il reste que la population présente sur les territoires représente aussi un problème à résoudre. Enfin, la sous-partie qui sème la peur récolte la mort, remet enfin en perspective la question de l’élimination des juifs d’Europe envisagée sous l’angle de la question alimentaire.
Cet ouvrage, passionnant à lire il faut l’avouer, paraît le 9 juin en France aux éditions Hermann. Les références présentées ici sont celles de l’édition québécoise. Dense et exhaustive, l’étude de Tristan Landry permet d’aborder l’histoire sociale et culturelle de l’Allemagne nazie sous un angle peu habituel et le professeur trouvera des éléments susceptibles de compléter son cours à travers un thème qui ne manque jamais de susciter l’intérêt des élèves. À titre personnel, puisque l’alcool et cigarette sont souvent associés, je rajouterais que la partie consacrée à l’alcool peut être complétée par la lecture d’un autre ouvrage dont le propos rejoint celui de Tristan Landry, celui de l’historien américain, auteur du concept de l’agnotologie (l’étude de l’ignorance), Robert Proctor Golden Holocaust la conspiration des industriels du tabac publiée chez Équateurs en 2014 : le chapitre II intitulé « la découverte du risque du cancer » propose une analyse (forcément) similaire et très complète de la cigarette sous le IIIème Reich.