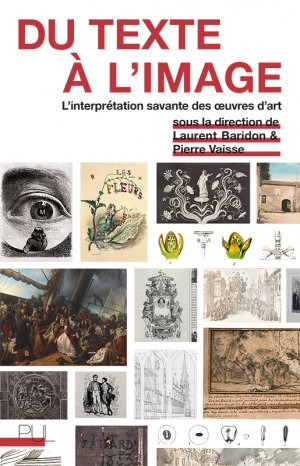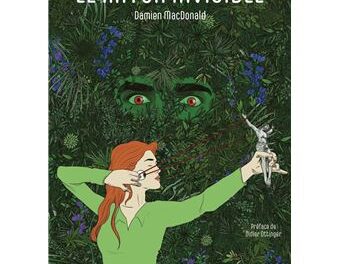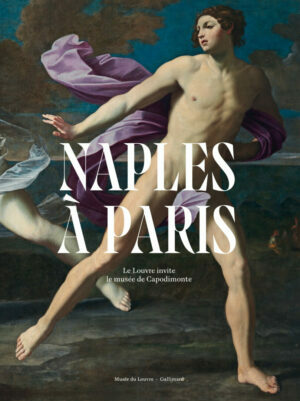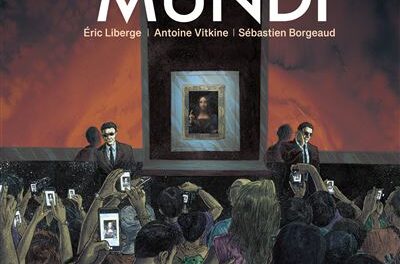L’ouvrage Du texte à l’image. L’interprétation savante des œuvres d’art, paru sous la direction de Laurent Baridon et de Pierre Vaisse, souhaite rendre hommage à la méthode de l’historien de l’art François Fossier dans l’étude des œuvres d’art au prisme des rapports entre les notions de texte et d’image mais surtout de l’œuvre dans sa dimension historique autant qu’esthétique.
Cette attention portée au contexte historique de création d’une œuvre n’allait pas de soit jusqu’il y a peu : la stricte séparation entre les disciplines de l’histoire et de l’histoire de l’art et leurs méthodologies différentes impliquaient que l’œuvre était rarement considérée comme une source historique et, inversement, que l’histoire avait peu à apporter à la compréhension d’une œuvre, contrairement à l’iconographie, aux aspects techniques ou à la muséologie.
François Fossier a rapproché les deux disciplines en choisissant d’appliquer à l’histoire de l’art les méthodes historiques apprises à l’Ecole des chartes, dont il est sorti en 1975 après une thèse d’école portant sur Le règne de Jean le Bon dans les histoires de France du XIVe au XVIe siècle. Essai d’historiographie.
Créée en 1821, l’École des chartes avait pour premier objectif de former les archivistes dont l’État avait besoin au niveau national et départemental. Très vite, la formation s’ouvre à d’autres domaines patrimoniaux, comme les musées, les bibliothèques, l’archéologie, les monuments historiques et bien sûr l’enseignement de ces disciplines à l’Université, tant en histoire qu’en histoire de l’art. Les élèves, rentrés sur concours, suivent un parcours généraliste, comprenant notamment archivistiques et diplomatiques médiévales, de l’époque moderne et contemporaine, ancien français, latin, paléographies française et latine, histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain, philologie, codicologie, histoire du livre, édition des textes. Les élèves ne se spécialisent vers l’histoire de l’art, l’archivistique ou encore la bibliothéconomie qu’à l’approche des concours de sortie d’école, qui les mènent à l’Institut du patrimoine, à l’École nationale supérieure de l’Information et des Bibliothèques ou aux concours de l’enseignement.
Ce que propose François Fossier est donc d’élargir l’étude d’une œuvre aux sources annexes, généralement textuelles : en témoignent ses nombreuses éditions de sources d’histoire de l’art, à savoir la série de Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome au XIXe siècle, mais aussi son Manuel de méthodologie paru en 2006, dans un dialogue permanent entre texte et œuvre (ou dans le cas de l’ouvrage concerné ici, « image ») et en replaçant toujours l’œuvre dans son contexte artistique certes mais aussi historique, intellectuel, social, etc.
Ce dont témoigne cet ouvrage hommage, c’est l’immense apport de cette méthodologie pour l’histoire de l’art. La diversité des contributeurs et des thèmes abordés atteste que l’application de cette méthode n’est pas réservée qu’aux chartistes (trois auteurs sur quinze), ni à une période en particulier ou encore à une typologie d’œuvres.
Les quinze contributions, rangées à deux exceptions près par ordre chronologique et majoritairement consacrées au XIXe siècle, certaines étant illustrées, ont toutes pour thème le texte comme source de compréhension pour l’œuvre et reflètent toutes la transcription à l’histoire de l’art du stemma codicum de l’histoire du livre.
L’article de Julien Defillon revient sur la notion d’authenticité en terme de patrimoine, de la charte de Venise au document de Nara : l’étude de la signification de ce terme et concept d’abord relatifs à un écrit dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti permet d’en mesurer les avantages et les inconvénients.
Les forces et les limites, cette fois de la méthode de François Fossier, sont également au cœur du très intéressant article de Franck Perrin, sur le motif de la feuille de gui chez les Celtes anciens : comment faire quand on doit se fonder sur un « corpus muet », les druides interdisant la mise par écrit de certains éléments de savoir et de sacré ? On peut alors s’appuyer sur les sources textuelles externes (sources romaines) et l’archéologie, et opérer par analogie et comparatisme, tout en prenant le recul nécessaire.
Lui font écho à des degrés divers cinq articles. Celui de Jean-Michel Leniaud, intitulé « Contextes sans texte : quelques dessins retrouvés de François Debret », revient sur une série de dessins relatifs à des verrières disparues. Ces dessins, qu’aucun texte ne vient commenter, oblige le chercheur à s’attacher au moindre détail afin de comprendre la finalité et la signification de ces dessins et dépasser l’absence de texte. Dans son article De l’influence des traductions françaises sur l’illustration d’un roman étranger : le cas du Don Quichotte de Cervantes aux 18e et 19e siècles Cyril Devés a été plus favorisé pour retracer la circulation des textes français et la reprise de motifs lui permettant de rattacher la série de dessins de la collection privée Fernandez, à Madrid à la thématique de Don Quichotte. Damien Chantrenne a pu s’appuyer sur un recueil de dessins pour retracer la production scénographique de Pierre-Paul Sevin, et notamment les décors de Scipione Affrico, un opéra créé pour Christine de Suède en 1671. La quête d’éléments biographiques de Sylvie Aubenas dans la correspondance privée de deux photographes récemment acquise par la Bibliothèque nationale de France lui permet d’éclairer leur œuvre sous un autre jour. Enfin, en s’appuyant sur la littérature produite à l’occasion des Salons, Stéphane Loire retrace la réception de l’oeuvre de François-Auguste Biard, artiste s’appuyant sur ses propres expériences et voyages pour trouver l’inspiration de ses œuvres.
Les articles de Daniel Alcouffe (« Horatius Coclès, héros des cabinets d’ébène »), de Ségolène Le Men (« Une innovation de l’artiste : le lancement des nouveautés littéraires romantiques par la vignette ») et Laurent Baridon (« Les lettres figurales de Grandville : des mots en image ») rendent hommage à l’intérêt de François Fossier pour la gravure, lui qui a été conservateur au département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France. Ces trois articles reviennent avec justesse sur trois cas particuliers d’échanges, d’influences et de communication par la gravure : le premier s’intéresse au cas d’un cabinet du XVIIe siècle dont le décor gravé est tiré d’une estampe illustrant un ouvrage d’histoire d’origine allemande. Les 2e et 3e rappellent les liens extrêmement fort entre l’image et le texte dans le cas des gravures d’illustration du XIXe siècle qu’une étude uniquement sous l’angle de l’image appauvrirait grandement.
La question du motif iconographique et sa grammaire sont l’objet de deux communications : celle d’Ingrid Junillon traite de la figure florale dans l’oeuvre du méconnu artiste Jens Lund, dans une œuvre d’abord livresque puis déclinée sur différents supports tout au long de sa carrière. La communication de Rémi Labrusse est consacrée à la Grammaire de l’ornement de Johann Eduard Jacobsthal publiée en 1874 : l’image se substitue au texte, sa diffusion et sa postérité étant étudiée selon la même méthode que les textes des manuscrits médiévaux (le stemma codicum devenant stemma operum) après avoir été replacée dans le contexte de son époque.
La question du stemma operum est également prégnante dans l’article que Thierry Dufrêne consacre à la Léda atómica de Dali : en retraçant les relations sociales et artistiques de Dali à cette époque, il parvient à démontrer de façon très convaincante le lien entre le tableau et la gravure de la Cassiopée de l’atlas de Bayer de 1603.
Deux articles reviennent sur les rapports entre iconographie et littérature au XIXe siècle : Pierre Vaysse s’inscrit dans la lignée de chercheurs qui cherchent à décrypter les liens entre Victor Hugo et les arts visuels de son époque en proposant une étude consacrée au poème le Rouet d’Omphale ; Christine Peltre montre une nouvelle facette de l’artiste orientaliste Gérôme, également acteur de la société littéraire de son époque, un trait qui permet d’observer son œuvre peinte sous un autre jour.
L’ensemble, à première vue hétéroclite, rend très bien compte des différents résultats que l’on peut obtenir avec la méthode de François Fossier, et de l’invitation à élargir ses points de vue en allant au-delà de l’œuvre elle-même. L’ouvrage contient également une notice bio-bibliographique de François Fossier, ainsi qu’une bibliographie générale.
Si on devait avoir un regret, ce serait l’utilisation du qualificatif d’« interprétation savante » à propos de cette méthode, qui n’est pas vraiment explicitée dans l’introduction : on y reconnaît peut-être là l’un des travers des chartistes, à savoir la primauté mise sur la source textuelle, qui serait jugée plus solide et sérieuse que toute autre. Comment devrait alors être qualifiée l’interprétation qui s’appuie sur les qualités esthétiques et techniques, voire sur « l’œil » du chercheur, pour attribuer une œuvre à tel artiste et pour lui donner une signification ?
L’hommage à François Fossier n’avait pas besoin d’aller jusque là pour en vanter les mérites évidents, ce dont l’ouvrage témoigne parfaitement.