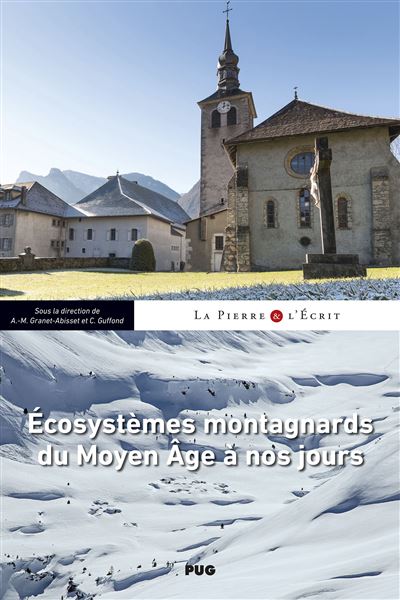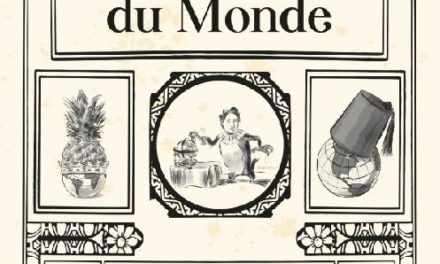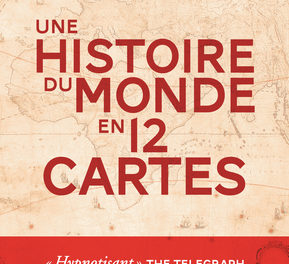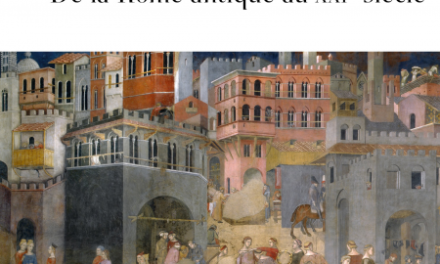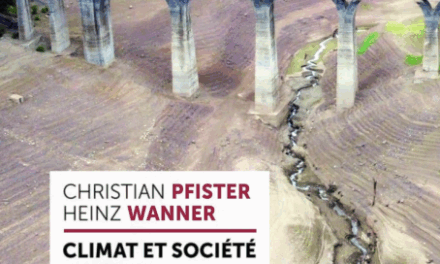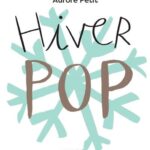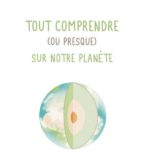Cet ouvrage est le fruit de la collaboration d’archéologues, d’historiens, d’environnementalistes, réunis pour décrire et comprendre les relations hommes-milieu et les évolutions dans le temps. Il couronne l’aboutissement du colloque final du projet Ecosystèmes montagnards du Moyen Âge à nos jours, de décembre 2021.
La recherche a porté sur trois sites en Haute-Savoie : le vallon de Sales (Sixt), le Salève et le plateau des Glières, du Moyen-Age à nos jours. L’introduction permet de délimiter et de décrire l’espace de cette recherche.
Accéder à la montagne
Nicolas Carrier introduit cette première partie qui montre le contrôle et la mise en valeur des alpages.
Hélène MaurinDirectrice des archives départementales de Haute-Savoie présente les sources déposées aux archives départementales, un patrimoine très diversifié. C’est notamment le riche fond cartographique, de la Mappe sarde de 1733 aux cadastres actuels. Ils permettent d’inventorier les voies d’accès. Les archives des communautés religieuses offrent une vision de l’exploitation de ces espaces et de la production fromagère. Pour les périodes récentes, les archives permettent d’aborder le tourisme.
Alain Mélo montre les données archéologiques qui nous informent sur le Plateau des Glières : le parcellaire, le bâti et les accès. Il décrit le « challay » dont une mention est datée de 1738 sur la montagne de Balmont, dans le Chablais, et les annexes liés à la production fromagère.
Denis Laissus, historien et guide du patrimoine, mesure l’empreinte de la propriété dans le massif des Bornes. Il interroge la notion même de propriété : pâturages communs, montagnes particulières. La situation est assez complexe comme le montre l’exemple de la montagne de l’abbaye d’Entremont : propriétaire éminent, usufruitier, obligation banale de conduire les troupeaux, association pour l’exploitation de l’alpage redevable de l’auciège. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, les formes d’exploitation des alpages de l’abbaye ont évolué. L’auteur tente une typologie des « montagnes ».
S’adapter au milieu montagnard
Karim Gernigon introduit cette seconde partie autour de la difficulté à appréhender les traces d’intervention humaine.
Une équipe pluridisciplinaire présente les travaux de fouilles archéologiques des grottes du Salève, occupées au néolithique. C’est un article technique décrivant les matériaux de quelques grottes, des sites discrets, certains difficiles d’accès.
Une autre équipe a travaillé sur les vires du Salève qui révèlent une « fréquentation énigmatique » de l’âge du Bronze à l’époque contemporaine. Les auteurs décrivent un bas-relief de la vire du canapé qui semble être daté du 1er s. av. Ce même secteur abrite un mobilier archéologique qui atteste d’une fréquentation au Bronze final, durant l’Antiquité. D’autre part, l’extraction de pierres à l’aide de poudre noire caractérise la période du XVIIe à la fin du XIXe siècle.
À Collonges-sous-Salève, les grottes de la forêt de Chavardon apportent d’autres informations : des céramiques de l’âge du fer ou plus récentes sont les traces d’un habitat en terrasses.
Christophe Guffond, archéologue, Christian Abry, ethnolinguistique et Matteo Rivoira s’intéressent à l’ethnolinguistique. L’alpage de Sales est une « haute montagne » de Sixt, entre 1900 et 2733 m. Ils décrivent son organisation sociale autour de la gestion du troupeau. Si le cœur de l’alpage est le village de chalets de Sales, en altitude se trouvent des « cramots »Photographie p. 138, sorte d’abris de rochers.
Les auteurs évoquent l’évolution des chalets, d’abord à usage seulement pastoral puis familiaux, à partir du XVe siècle, avec la privatisation de l’alpage. Les « cramots » sont des refuges pour les bergers en cas de mauvais temps. Le mot dont l’origine est étudiée, semble seulement présent dans le Chablais.
Patricia Chiquet et Christophe Guffond, archéologues, présentent leur étude zootechnique des ossements d’animaux de ce même alpage de Sales. Ils peuvent ainsi décrire le cheptel domestique entre le XIIe et le XIVe siècles, un cheptel à dominante bovine. Ils en déduisent la présence d’un troupeau bovin laitier et d’un troupeau ovin pour la production de laine et de viande. Ils ont aussi trouvé quelques ossements issus de la chasse au chamois.
Occuper la montagne
Hervé Richard coordonne les reconstitutions des écosystèmes.
Andrea Julien, Èlise Doyen,Charline- Giguet-Covex, Erwan Messager scrutent le paysage du haut-plateau des Glières à la recherche des traces de l’activité agropastorale. Les tourbières leur permettent de reconstituer l’histoire de la végétation sur 7000 ans. Ils présentent leurs sites d’étude et les résultats d’analyses polliniques.
Le couvert végétal a évolué en fonction de l’évolution climatique puis de la présence humaine selon 5 périodes :
- Entre – 5500 et – 3250 on a un couvert arboré de feuillus et de conifères, sapins puis épicéas.
- Entre -3250 et -2800, on assiste à un recul du couvert arboré parallèle au déclin du sapin avec, à la fin de la période, l’apparition de pollens de céréales et l’apparition de champignons qui signent la présence d’un troupeau.
- La période de l’âge du Bronze, puis du Fer est marquée par la présence d’un couvert forestier sans présence d’occupation humaine, contrairement aux zones voisines.
- Pendant l’Antiquité, le déclin de la forêt s’accompagne d’une augmentation des traces anthropiques . Certains pollens viennent des vallées comme celui de la vigne.
- À partir du VIIIe siècle et jusque vers 1750, une intensification des pratiques agropastorales est attestée par la diversification des espèces herbacées, le déclin du hêtre qui est un bon bois de chauffage.
- Aujourd’hui, on assiste à une déprise agricole et à une reforestation, avec fermeture du paysage.
Pascale Ruffaldi et Patrice Prunier ont étudié 3000 ans d’histoire de la végétation du Salève, grâce à la tourbière de Praz Fauraz à 1300 d’altitude. Avec la même méthodologie que l’équipe des Glières, ils déterminent des paysages correspondants à diverses périodes.
- De – 3000 à – 2750, la zone est couverte d’une hêtraie sapinière à noisetiers et à fougères qui serait le « forêt ancestrale ». À l’âge du fer, des clairières apparaissent.
- De l’époque romaine au Haut Moyen Âge, la hêtraie sapinière recule devant les pâturages qui prennent à la période suivante une place croissante.
- A l’époque contemporaine, le paysage évolue à nouveau : recul des landes et des pâturages, apparition d’un pré-bois.
Quelles furent les évolutions de l’exploitation et la gestion du couvert forestier du Salève, c’est la question à laquelle tentent de répondre Alain Mélo avec l’anthracologue Sandrine Paradis-Grenouillet et la botaniste Ilaria Pozzi.
La région est connue pour avoir été soumise à un important charbonnage pour la sidérurgie. Les auteurs ont étudié les vestiges des charbonnières en la comparant aux sources écrites. L’exploitation du charbon de bois s’est déroulée sur 2000 ans avec une réutilisation périodique des sites.
Leur étude nous apprend que les arbres étaient coupés en hiver, que le hêtre est dominant et que les arbres abattus sont, au fil du temps plus petits, peut-être la trace d’une surexploitation. Au XIXe siècle, les charbonniers fournissent le marché local, notamment Genève. Les traces de cette exploitation multiséculaire sont encore visibles dans l’inventaire forestier de 2019.
Une équipe pluridisciplinaire s’est consacré à l’étude du développement des activités agropastorales dans le Haut-Giffre (vallon de sales). Ils replacent leur étude dans le contexte alpin, et décrivent le systèmes de la « petite » et de la « grande montagne ».
Le site étudié renvoie à la « petite montagne ». Les auteurs présentent en détail leurs sources et la méthodologie de leur étude.
Vers – 2000 se développent des activités pastorales qui s’intensifient dans la seconde moitié de l’âge du Fer et pendant la période romaine. Les pollens d’aulnes confirment une baisse de l’activité autour de 300 jusqu’au Xe-XIe siècle. Les activités reprennent et se développent au Moyen Âge entre le XIe et le XIVe s. puis entre le XVIIe et le XIXe siècle. Au XXe s., l’activité décline et s’accompagne de reforestation.
Exploiter la montagne
L’historien Fabrice MouthonEnseignant en Histoire du Moyen Âge à l’Université Savoie Mont Blanc, il a publié : Le sourire de Prométhée – L’Homme et la nature, La découverte, 2017 – Montagnes médiévales – Les alpages de Savoie, Dauphiné et Provence du XIIe au XVIe siècle, Université Savoie Mont Blanc – Laboratoire LLSETI, 2019 et avec Nicolas Carrier Paysans des Alpes- Les communautés montagnardes au Moyen Âge aux Presses universitaires de Rennes, 2010. introduit cette quatrième partie.
Sylvain Couterand présente les entités géomorphologiques des trois espaces : Montagne du Salève, Plateau des Glières et vallon de Sales. Il en fait une description géologique, présente les formations de surface, les traces des flux et du retrait glaciaire. Il porte une attention particulière aux blocs erratiques et aux écroulements de versants, notamment la chute d’un pan de la pointe de sales en 1600 et les écroulements du Dérochoir qui ont modifié le cours de l’Arve (1471 et 1751).
Raphaëlle NapoléonAttachée d’étude à Asters-CEN 74 explique l’intérêt d’une étude de la végétation actuelle du site de Sales qui est inclus dans la Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-cheval/Passy. Cette étude permet de qualifier la situation actuelle, fruit de l’histoire. Elle présente les actions de sensibilisation de la Réserve et, en particulier, un jeu pour le jeune public : « Sur les traces de Marcel » qui montre la vie de berger.
La présentation des chalets de Sales par Christophe Guffond aborde le bâti, ses fonctions, son évolution vers un modèle type aux XVIIIe et XIXe siècles où se distinguent divers espaces : le plus grand dévolu au troupeau, la cuisine et la chambre à lait.
Olivier Pasquet géographe au laboratoire EDYTEM et documentariste présente un documentaire tourné en Beaufortain : « Après l’Écho », au village du Coin en 1991. C’est un témoignage des pratiques en perte de vitesse en cette fin de XXe siècle. Son article est aussi l’occasion d’évoquer la transmission de la propriété de cet alpage au pied de la Pierra Menta, un espace bouleversé par la construction de barrage hydroélectrique de Roselend. Ces chalets, aujourd’hui en sommeil, éveille l’intérêt des promoteurs du tourisme.
La conclusion revient à Anne-Marie Granet-Abisset. Elle met en avant l’intérêt des études pluridisciplinaires.
En annexe, les posters présentés au colloque viennent compléter une information de qualité.
Des contributions riches, parfois techniques qui permettent de comprendre l’histoire des écosystèmes de montagne et qui rappellent que le paysage n’est pas immuable.