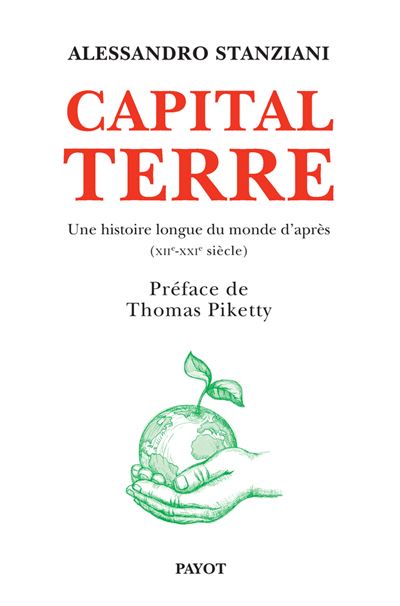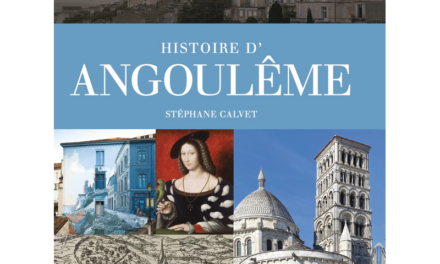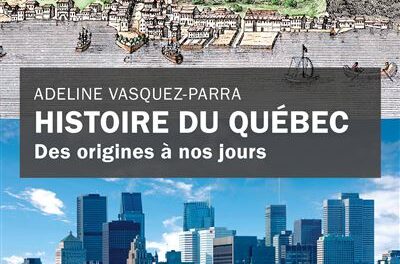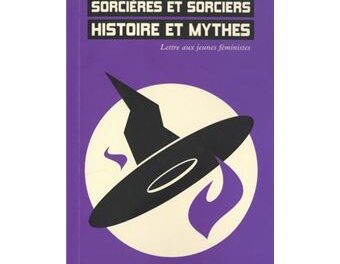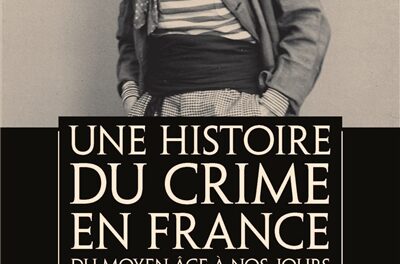Un ouvrage, comme l’écrit Thomas Piketty dans la préface, à l’intersection de l’histoire et de l’économie, une « éco-histoire ». Alessandro Stanziani propose, dans cet ouvrage Capital terre, une histoire du capitalisme sur le temps long du XIIe au XXIe siècle. Il s’intéresse principalement aux sources d’énergie qui se sont succédé et permet ainsi d’aller jusqu’aux débats contemporains dans un monde confronté aux changements climatiques. Un ouvrage militant qui met au centre de sa réflexion les relations entre alimentation, agriculture, environnement et inégalités.
Dans son introduction l’auteurL’auteur est un historien économiste, Directeur d’études de l’EHESS[footnote]Ilaz publié en 2005 L’histoire de la qualité alimentaire – en 2020 Métamorphoses du travail contraint – Les guerres du blé : une éco-histoire écologique et géopolitique en 2024, spécialiste de l’histoire des marchés et de l’histoire du travail.[/footnote] définit le mot terre : à la fois le monde, la planète et le sol pour nourrir des humains toujours plus nombreux dans un monde inégalitaire. Il envisage une périodicité en trois temps :
– Du milieu du XIIe au milieu du XIXe siècle, le temps de l’accumulation, fondée sur le travail
– 1870-1970, le temps du capitalisme marqué par la domination de l’Occident, le productivisme et la société de consommation
– Depuis les années 1970, un modèle qui se diffuse, productivisme dans les pays du Sud, accroissement des inégalités, épuisement des ressources.
Croissance verte et travail forcé
Le Travail
Le premier élément analysé est la question du nombre des humains. Durant cette première période, la croissance de la population est sensiblement parallèle à celle du PIB. Elle s’accompagne de déforestation en Europe et sur d’autres continents, de privatisation des terres.
Alessandro Stanziani montre une évolution, elle aussi parallèle du capital et du travail. Il appuie son raisonnement sur l’exemple anglais. Il analyse l’évolution des salaires et des rentes au XIXe siècle.
A l’échelle mondiale, à partir du XVe siècle, la population mondiale croît, mais surtout en Europe où le PIB/h croît lui aussi comme le montre la comparaison Europe-Inde-Chine.
Les sources d’énergie
Le bois demeure longtemps la principale source d’énergie. L’essor du charbon vient remplacer le bois, en Europe, au XIXe siècle.
La force de l’eau et du vent ne sont abordées que pour les moyens de transport.
La force animale et humaine est mise en lumière comme source d’énergie. L’utilisation de la force animale dans l’agriculture n’est pas la même selon les régions du monde et pose la question de la concurrence entre alimentation humaine et alimentation animale.
Du XIIe au XIXe siècle, l’économie se développe essentiellement en mobilisant la force de travail des hommes et des animaux et grâce à l’énergie du soleil pour produire la nourriture.
Plantes et civilisations matérielles
Ici l’auteur part des travaux de BraudelFernand Braudel — Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Armand Colin, 1967 et republié dans la collection Champs Histoire, Flammarion en mars 2024, civilisation du blé, civilisation du riz, qu’il met en débat.
L’auteur décrit chaque civilisation, de la domestication de la céréale aux besoins en travail, engrais et à l’adaptation des variétés aux conditions pédoclimatiques et à la diversité des usages. Il montre aussi le poids des habitudes alimentaires des populations avec notamment un paragraphe consacré aux pâtes (origines, différentes techniques…).
Le riz n’est pas seulement asiatique, riz irrigué et riz sec, les civilisations du riz sont abordées : Chine, Inde, Afrique.
Ce chapitre apporte d’intéressantes données sur l’histoire de l’agriculture, sur l’alimentation et aussi sur la civilisation du maïs. Un paragraphe est consacré à un produit qui a eu un rôle important dans les échanges entre continents : le sucre. C’est bien sûr l’occasion d’aborder le travail des esclaves.
Environnements, institutions et inégalités : les liaisons dangereuses
Ce chapitre met en évidence le poids des évolutions climatiques sur les dynamiques économiques : perturbations exceptionnelles ou plus durables comme le « petit âge glaciaire ».
Les famines furent-elles un effet du climat ou du marché ?
Alessandro Stanziani présente quelques crises frumentaires et leurs conséquences socio-politiques en Asie et en Europe. Pour faire face aux mauvaises récoltes, les autorités mettent en place des systèmes de réserves. Un interventionnisme limité apparaît en Chine comme en Europe. Il montre aussi une répartition sociale des produits alimentaires : viande, pain blanc.
Pourquoi la domination de l’Europe ?
En conclusion de cette première partie, l’auteur avance un autre argument que les explications habituelles : les inégalités entre travail et rente et la recherche de nouvelles ressources pour financer le capital aristocratique, une recherche qui s’accompagne des violences du premier colonialisme.
Le régime productiviste et la grande accélération
L’ère du capital
Les États sont désormais plus interventionnistes : réglementation du marché foncier, codes de commerce. En ce qui concerne les terres agricoles, la location par les paysans est, à l’échelle mondiale, une forme très répandue, hors régions de collectivisation forcée. L’auteur montre, partout, une standardisation de l’agriculture.
Cette période est aussi celle de l’apparition des théories du développement et d’une économie environnementale.
La description des facteurs de modernisation porte sur la hausse des productions, une intensification du capital avec la mécanisation et du capital humain grâce à l’éducation et à la formation. Dans le même temps, on assiste à une baisse de la part du travail agricole dans le travail total. Un paragraphe est dédié à la chimieSur ce thème voir Le cultivateur et l’engrais, Laurent Herment, Presses Universitaires François Rabelais, 2024 dans l’agro-alimentaire. Cette période est surtout caractérisée par un nouvel équilibre énergétique qui s’accompagne d’une augmentation des émissions de CO2. L’auteur montre aussi le rôle croissant des barrages hydroélectriques et de l’irrigation dans l’agriculture. Il développe l’évolution du mix énergétique charbon-pétrole et les conséquences géopolitiques.
Semences, plantes et génétique
Le sujet principal de ce chapitre est la question de la brevetabilité du vivant et l’irruption des multinationales dans l’agro-industrie. Les exemples choisis sont les maïs hybrides, hausse des rendements et de la dépendance économique, et le riz aux USA et des variétés japonaises de blé. Cette analyse s’accompagne de jalons dans l’histoire des semences de Mendel à la chimie de synthèse.
Maladies transmissibles et consommation : le cas de la viande
La standardisation de l’élevage, en particulier des bovins, a permis de rendre la viande accessible à tous (Europe, USA, Asie). Elle a aussi favorisé les épidémies dans les troupeaux : trichinose porcine, grippe aviaire, tuberculose bovine (un fléau mondial). Au XIXe siècle, se met en place un protectionnisme visant à éviter les crises sanitaires.
Capital, néocolonialisme et famines
Ce chapitre vise à expliquer les formes de spéculations, notamment boursières, et leurs conséquences. L’auteur décrit le rôle des marchés à terme sur les fluctuations des prix et les tentatives pour instaurer des mesures antispéculatives pendant l’entre-deux-guerres. À partir de 1870, en Europe, les salaires et les niveaux de vie s’améliorent. La protection sociale progresse grâce à la croissance économique durant les Trente Glorieuses, mais les inégalités se creusent entre les pays aux dépens de l’Asie, de l’Amérique latine et surtout de l’AfriqueSchéma p. 218. Ce qui génère des migrations de famines (Inde, Chine 1876-1879, Brésil) alors que la production mondiale de céréales est excédentaire. Sont aussi abordées les cultures de rente et la déforestation pour le cacao, le caoutchouc.
Conclusion de cette deuxième partie : deux processus : accroissement de la modernisation et État social au Nord / destruction de la planète et inégalités croissantes Nord-Sud.
Haute globalisation, effondrement et le monde d’après
Ce sont les évolutions récentes qui sont au cœur de la troisième partie : les marchés, les politiques économiques.
Néolibéralisme et euphorie de la spéculation
Entre les chocs pétroliers, la fin de Bretton woods, les politiques économiques sont allées vers la dérégulation accompagnée d’une privatisation dans les pays en développement au nom du monétarisme, de l’ultralibéralisme. La chute du communisme et le virage chinois ont généré une véritable vague spéculative.
En matière énergétique, la question du nucléaire est vue à partir du choix français, mais aussi de Tchernobyl, sans omettre la Politique agricole commune ou le scandale du chloredéconeSur cette question, on pourra se reporter à l’excellente BD : Tropiques Toxiques : le scandale du chlordécone, Jessica Oublié – Nicola Gobbi, Kathrine Avraam, Vinciane Lebrun, Steinkis / Les Escales, collection Témoins du monde, 2020. La spéculation sur les denrées agricoles entraîne une forte montée des prixSchéma p. 247 avec des conséquences sur les pays du Sud. La spéculation s’est aussi exercée sur le prix des terres pour des productions d’exportation Ex du Kenya : ressources pour les enseignants : Roses d’Afrique, roses du monde – The Human, Economic and Environmental impact of the Cut Flower Industry in Kenya – DNL anglais avec des phénomènes d’emprise sur les terres communautaires, de déforestation, malgré l’alerte des ONG et la mobilisation des communautés paysannes comme Via Campesina ou Ekta Parishad.
L’auteur aborde la notion de capital fixe agricole, en augmentation depuis 1967, et les évolutions économiques du monde rural partout dans le monde.
En ce temps de globalisation, la force de travail animal et humain décline au profit des énergies fossiles avec des consommations énergétiques par habitant très variables selon les pays.
L’agriculture est aussi confrontée à des pénuries d’eau face à une consommation qui explose.
Malgré la Révolution verte, les rendements agricoles stagnent entraînant un recours toujours plus important aux engrais chimiques et une détérioration des sols.
La génétique pour tous
Les recherches sur la génétique végétale comme animale semblent une solution malgré les tentatives de la FAO de défendre les semences comme bien commun. On assiste à une standardisation croissante des semences, on passe des hybrides aux OGM malgré les débats. En 2013, 90 % du coton, 93 % du soja cultivés aux États-Unis sont des OGM.
Le développement de l’élevage pour l’exportation gagne Amérique du Sud. L’élevage représente 40 % du PIB mondial, même si les modèles diffèrent entre formes industrielles comme pour le porc en Thaïlande, et très petits producteurs comme au Vietnam. L’élevage concurrence la consommation humaine (blé, maïs, soja – aliments du bétail) et représente 18 % des émissions de GES. Cet essor de l’élevage correspond à l’augmentation de la consommation dans certains pays du Sud. Il a des effets sanitaires en boomerang : vache folle, grippe aviaire, COVID.
Si les inégalités entre pays tendent à se réduire, les inégalités internes s’accroissent, notamment en lien avec le gaspillage alimentaire.
Vers le monde d’après
L’auteur compare l’efficacité possible des différents modèles économiques : utopies primitives, régulationnisme d’inspiration keynésienne, capitalisme moral (fondation Bill Gates), fiscalité verte avec l’exemple de l’État du Paraná (Brésil).
Une question : faut-il sortir du capitalisme ?
L’auteur ouvre des pistes de réflexion sur les questions de spéculation, de semences et de propriété intellectuelle. Il prône un retour à la valeur travail. Pour lui, le problème n’est pas économique, mais politique et idéologique.
Conclusion
Alessandro Stanziani est en faveur d’un nouveau contrat social.
Un ouvrage passionnant, un ouvrage dense qui repose sur un raisonnement rigoureux et une documentation approfondie, il offre des perspectives d’analyse en matière d’histoire de l’agriculture et de l’alimentation. Il trouvera sa place dans les CDI des lycées.
L’auteur est intervenu en janvier 2024 sur France Culture : émission disponible en podcast