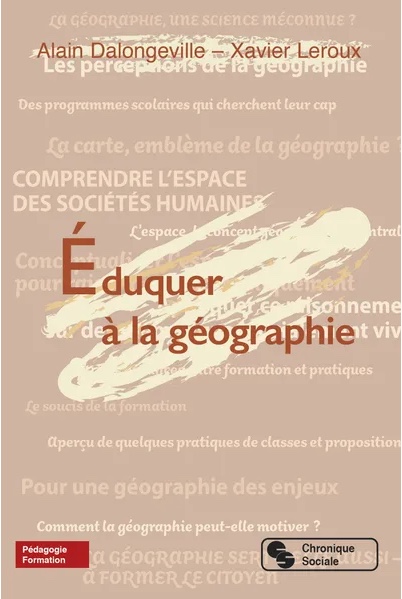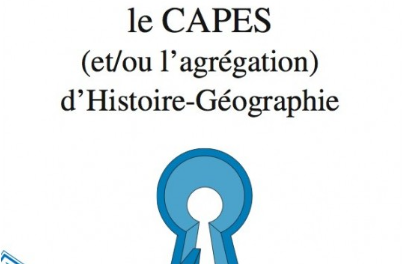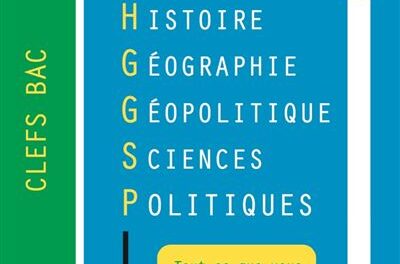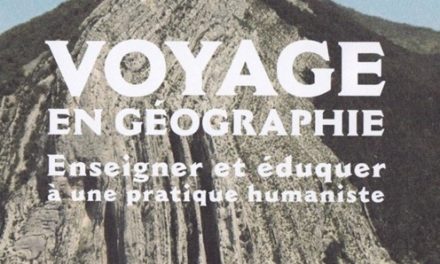Où en est la géographie enseignée aujourd’hui ? Le constat de départ n’est pas réjouissant mais les auteurs se refusent à céder au pessimisme. Au contraire, ils affirment haut et fort le besoin de géographie.
Les auteurs et leur projet
Ils déplorent que si l’histoire est objet de débat dans le grand public, ce n’est indéniablement pas le cas de la géographie. L’ouvrage est organisé en quatre parties et est accompagné d’un nombre important de documents. Leur objectif : comment faire en sorte que l’enseignement de la géographie permette une compréhension renouvelée du monde à l’Ecole et au-delà ? Alain Dalongeville est docteur en sciences de l’Education de l’université de Paris 8. L’essentiel de son activité est consacré à l’exploration et à la pratique de la situation problème. Xavier Leroux, clionaute, est docteur en géographie et a déjà notamment publié des manuels chez Access. Tous deux se penchent sur le problème de l’enseignement de la géographie.
Les perceptions de la géographie
Quelques indices posent le problème comme le peu de revue grand public existante. En effet, à part « Carto », rien à l’horizon puisque même une revue comme « Géo » se révèle en réalité plus tournée vers le voyage. Pourtant, la géographie ne se limite pas aux repères spatiaux. C’est une étape, certes, mais une étape seulement. Les auteurs relèvent que l’intérêt pour la géographie dépend de la génération à laquelle on appartient. Ils invitent à renouveler le lien entre géographie scolaire et géographie savante.
Des programmes scolaires qui cherchent leur cap
Trop souvent les programmes sont pensés par rapport à la mémorisation. Les auteurs retracent les grandes tendances des cinquante dernières années. Après un moment vidalien marqué par le local et le milieu, la géographie devient synonyme d’éveil dans les années 70. On assiste ensuite à un retour des éléments scientifiques qui donne lieu à une valse de programmes. Plus récemment, des thématiques comme le développement durable s’imposent dans les programmes. Quel que soient les programmes et leur angle, il y a loin de l’acceptation théorique de leur nécessité à leur mise en œuvre par les enseignants.
La carte, emblème de la géographie ?
Il est indispensable de savoir lire et interroger une carte. C’est un objet éminemment abstrait. Le meilleur moyen d’arriver à se débrouiller avec ce genre de document est d’en faire réaliser une par les élèves. Il est nécessaire aussi de prendre conscience qu’il ne s’agit aujourd’hui que d’un outil parmi tant d’autres. La géographie scolaire a besoin que les enseignants se construisent une autre conception de la géographie.
Comprendre l’espace des sociétés humaines
L’espace est le concept central de la géographie. Il est en même temps très hétérogène quand on l’étudie. Faire de la géographie, c’est analyser l’organisation des espaces par les sociétés humaines. L’espace est composé des formes (statique) et des dynamiques (ce qui bouge). Il faut ensuite appliquer ce raisonnement à des thématiques socialement vives. Il peut s’agir de maladies comme le Covid, mais pas seulement, ou encore de l’éducation. Les auteurs décortiquent d’ailleurs cet intéressant objet sous l’angle géographique.
Discordances entre formations et pratiques
Les auteurs pointent le souci de la formation en géographie. Ils évoquent un rapport de 2022 de l’Inspection générale sur l’état des enseignements en CM1. A propos de la géographie, la situation est jugée « préoccupante ». La formation initiale n’est pas suffisante en volume. Quant à la formation continue, elle est en voie de disparition. Même quand elle existe, les auteurs se montrent critiques sur le profil de ceux qui l’assurent.
Aperçu de quelques pratiques de classe et propositions
Les professeurs des écoles qui enseignent la géographie ne sont généralement pas des spécialistes et ils doivent, par ailleurs, gérer de nombreuses autres disciplines. Difficile de leur reprocher une méconnaissance des derniers aspects de la recherche en géographie. Pour faire autrement, les auteurs proposent de passer par le jeu et donnent un exemple concret. Ils invitent aussi à sortir, dès que possible, de sa classe ou encore à aller vers la transversalité.
Comment la géographie peut-elle motiver ?
Il ne faut pas tomber dans le travers de l’utilitarisme sous prétexte de vouloir redonner du souffle à la géographie enseignée. Il est fondamental de choisir des sujets socialement vifs pour susciter cet intérêt comme on l’a dit précédemment. Il convient également de s’appuyer sur des notions claires comme celle de territoire et de ne pas oublier les acteurs et leurs logiques. A ce titre, le concept d’enjeu territorial est essentiel. Les auteurs proposent un exemple concret et détaillé pour faire comprendre l’importance de celui-ci. Ils enchainent ensuite avec l’idée de situation problème en géographie en en définissant précisément les contours.
La géographie sert elle aussi à former le citoyen
On pense traditionnellement à l’histoire, et rarement à la géographie, dans la construction du citoyen. Tout se passe comme si la citoyenneté avait une dimension historique plus aisément perceptible. La géographie peut permettre l’expérience de l’altérité, mais aussi de tenir compte d’autres points de vue. Ce sont là deux dimensions essentielles dans la construction du futur citoyen.
En conclusion, les auteurs notent que les objets d’étude de la géographie sont donc plus nombreux et divers qu’il n’y paraît. Son apport à la compréhension du monde ne peut être ignoré. Les enseignants ont donc un rôle essentiel à jouer. La transformation du regard sur la géographie ne peut se satisfaire d’une refonte des programmes. La question est bien plus large et engage donc toutes celles et ceux qui ont à enseigner la géographie.
On ne pourra que recommander ce livre, notamment en formation initiale, afin que les futurs enseignants partent sur de bonnes bases et fassent vivre à leurs futurs élèves des situations géographiques intéressantes appuyées sur des cadres conceptuels solides.