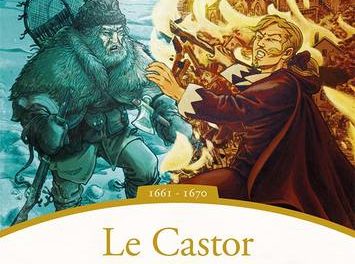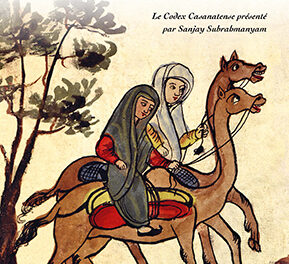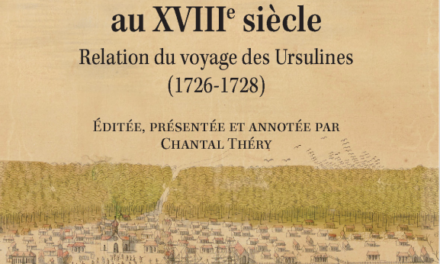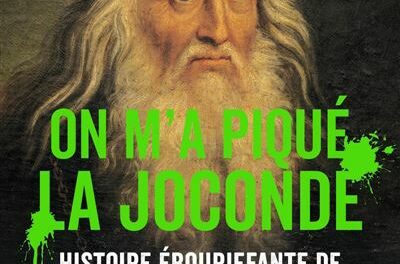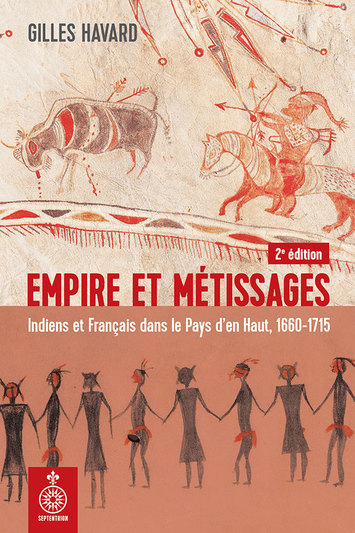 Dans son introduction l’auteur décrit le cadre spatial et temporel de son étude : la fin du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs, zone d’expansion aux marges de la Belle province, le pays d’en haut, centre du monde de quelques milliers d’Amérindiens carte p. 23, un espace d’interactions avec les Français où s’emboîtent deux espaces sociaux, deux sphères de souveraineté ». C’est un espace complexe au plan institutionnel, humain et même géopolitique. L’auteur affirme l’existence d’une région franco-amérindienne au cœur du continent américain. Cette recherche s’inscrit dans une ethno-histoire, une étude anthropologique et pose la question de la chronologie retenue : une chronologie étrangère ou la conception amérindienne du temps ? Se pose également la question des sources à utiliser et leur critique selon « la double prise en compte des valeurs culturelles de l’observateur et de l’observé » ‘p. 32). L’auteur est bien conscient du risue d’une interprétation ethnocentrique des données recueillies comme le montre sa présentation des sources.
Dans son introduction l’auteur décrit le cadre spatial et temporel de son étude : la fin du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs, zone d’expansion aux marges de la Belle province, le pays d’en haut, centre du monde de quelques milliers d’Amérindiens carte p. 23, un espace d’interactions avec les Français où s’emboîtent deux espaces sociaux, deux sphères de souveraineté ». C’est un espace complexe au plan institutionnel, humain et même géopolitique. L’auteur affirme l’existence d’une région franco-amérindienne au cœur du continent américain. Cette recherche s’inscrit dans une ethno-histoire, une étude anthropologique et pose la question de la chronologie retenue : une chronologie étrangère ou la conception amérindienne du temps ? Se pose également la question des sources à utiliser et leur critique selon « la double prise en compte des valeurs culturelles de l’observateur et de l’observé » ‘p. 32). L’auteur est bien conscient du risue d’une interprétation ethnocentrique des données recueillies comme le montre sa présentation des sources.
Le « Pays des nations alliées » : Une nouvelle géopolitique régionale
Le pays d’en haut, ces marges de la nouvelle France sont caractérisées par Une expansion sans peuplement, pays de la traite des fourrures avec quelques forts et magasins des missions sans colonisation comme celle qui existe sur les rives du Saint-Laurent où l’ambition était l’établissement « d’une société rurale stable d’agriculteurs capables d’auto reproduction » (p.44), dès 1660 la population d’origine européenne était majoritaire entre Québec et Montréal.
Si à Versailles certains ont pu rêver d’une colonisation du Pays d’en haut le gouverneur Denouville exprimait ses doutes en 1686 et prônait une occupation extensive par une poignée de voyageurs, coureurs de bois, trappeurs et soldats.
L’auteur décrit la chronologie et les motivations économiques de la traite des peaux, religieuses, géopolitiques des implantations plus ou moins précaires dans la région des Grands Lacs des voyages de Médard Chouart des Groseilliers vers 1650 à la politique du gouverneur Frontenac et à l’engorgement du marché de pelleterie vers 1695. La nature des postes et forts, le quotidien des trappeurs et résidents sont connus grâce aux contrats d’engagement, les partants pour le Pays d’en haut ne sont que des migrants temporaires, pas ou très peu d’installations définitives dans des postes isolés en territoire indien. La réalité est identique pour les soldats qui ne représentent qu’à peine 10% des troupes de la Nouvelle France.
Même si comme le montre l’auteur, quelques voix s’élèvent pour vanter une possible colonisation dans la région la plus méridionale , en pays illinois. Certains comme Cavalier de la Salle, La Mothe Cadillac obtiennent des concessions, privilèges commerciaux et seigneuries à Frontenac et à Saint-Louis sur les bords du lac Ontario ou à Fort Pontchatrain (Détroit).
L’auteur montre les hésitations de Versailles sur l’intérêt de cette région : lieu de traite ou installation de colons.
Le second chapitre est consacré à, un portrait du pays indien : espaces, populations, sociétés difficile à réaliser puisque les sources sont essentiellement françaises et que les groupes de population sont bien diversifiés. Il y a donc des sociétés amérindiennes entre culture de la forêt et cultures des plaines (carte p. 80). Le Pays d’en haut, expression européenne est néanmoins une entité géographique et hydrographique des Grands lacs ; il abrite trois grandes familles linguistiques : les Iroquoiens, les Algonquins et les Sioux, ils représentent quelques dizaines de groupes. Les évaluations démographiques très variées montent les limites de la connaissance de ces peuples.
L’auteur évoque les conceptions de l’espace, du territoire des peuples amérindiens, les mythes et les repères spirituels associés aux lieux. Les divers groupes connaissent clairement les limites de leurs territoires de chasse parfois cartographiés sur des écorces de bouleau. Ils n’hésitent pas à parcourir de grandes distances pour le commerce et la guerre.
Au plan démographique la période 1640-1650 est caractérisée par un déclin lié aux guerres iroquoises, aux migrations qu’elles entraînent comme pour les Hurons et au choc microbien du contact avec les Européens chute de population remarquée par les missionnaires ou les représentants du pouvoir royal.
L’auteur tente une prudente description des structures sociales : groupe, tribu, clan, ligue de paix ou confédération des Cinq-Nations (contre les Iroquois), des réalités difficiles à appréhender puisque le vocabulaire n’est pas amérindien, ni les sources d’information européennes pour XVII et XVIII e siècles, transcription de la tradition indienne eu XIXe siècle et que les structures ont évolué au contact des Français. Malgré tout Gilles Havard tente de cerner les réseaux d’alliance et parle de sociétés militaires tout en évoquant les différentes interprétations présentes dans l’historiographie. La recherche de prises de guerres (scalps, captifs) semble être un motif important dans les conflits comme le montre l’analyse de la constitution d’un parti de guerre chez les Iroquois, le rôle des femmes, le rapport à la mort et à la filiation, la signification du scalp et des rituels concernant les captifs p. 121 et suivantes. L’échange des femmes est souvent un élément des alliances et se manifeste aussi lors de grandes fêtes des morts (consommation du tabac, calumet de la paix, échange de colliers : les wampum). Lors de ces fêtes des jeux sont des substituts de la guerre jeu de la crosse, p. 141. L’alliance des amérindiens du Pays d’en haut repose aussi sur le partage des ressources et l’hospitalité.
Les alliances sont aussi scellées avec le roi de France, L’Alliance, fondement de la région franco-amérindienne se met en place dans la seconde moitié du XVIIe siècle, conséquence de la guerre iroquoise, de l’effondrement de la Huronie et les interactions croissantes entre amérindiens et français. La mise en place est progressive de 1654 à 1684 à partir du commerce des fourrures malgré la menace iroquoise, avec les Ouataouais puis les Poteouataouais, après 1678 l’alliance s’élargit aux Illinois, Miamis… Les Français sont confrontés à la difficulté d’établir une paix durable « Pax Gallica » entre leurs alliés. L’auteur prend l’exemple des Hurons pour comprendre ce que pouvait signifier cette alliance pour un peuple amérindien et montre le poids de la France qui fait de Montréal le centre du jeu géopolitique du Pays d’en haut, où se rendent les ambassadeurs indiens venant reconnaître « Onontio » « la grande montagne », terme utilisé pour désigner le gouverneur français et plus loin le roi comme partenaire mais aussi pour la traite des peaux en été. Il semble d’autre part que les postes français soient implantés sur le réseau existant des pistes et lieux de regroupements, d’échanges des Amérindiens, les missionnaires par exemple n’hésitent pas à suivre le groupe qu’ils christianisent. On peut alors parler d’attirance réciproque : fourrure , âme à évangéliser contre présents et marchandises européennes, ainsi naissent des lieux multiethniques comme Fort-Saint-Louis accolé à un village illinois. Sud-Ouest du lac Michigan, carte p . 177 ou le « complexe franco-indien » de détroit fondé en 1701.
Une marge impériale en pays indien : alliance et pouvoir
Espace et pouvoir : l’appropriation et le contrôle du territoire
Ce chapitre traite de l’intégration du Pays d’en haut dans la sphère impériale par les missionnaires dépendants des ordres religieux, les voyageurs rattachés à des marchands : un lien entre ces territoires et la colonie laurentienne.
La première forme d’appropriation évoquée est la toponymie. Noms de lieux, repères, cartes , sont une manière de s’approprier mentalement, symboliquement un espace. La riche toponymie indienne est adoptée non sans déformation Jaonniakare (portage bruyant) devient Niagara, traduction ou recouverte de noms chrétiensLac Michigan rebaptisé lac Saint Joseph. L’étude des cartes à différentes dates montre le recul des noms français et le retour pragmatique aux anciens toponymes.
L’auteur décrit une seconde appropriation : l’usage des étendards fleurdelisés matérialisant un rituel juridique d’appropriation au nom du Roi en associant les groupes qui vivent sur ce territoire. Il montre à travers différents textes que leurs auteurs rêvent le territoire, en font une description de pays de cocagne entre émerveillement et profusion comme l’expriment les lettres de Cadillac (p. 198).
Néanmoins un réseau de relations et d’autorité relie les petits forts, les établissements éparpillés et les institutions de la Nouvelle France et même au-delà de la métropole, une véritable chaîne de pouvoir et d’obéissance au roi et à Colbert, aux gouverneurs et aux commandants des postes, avec à chaque niveau une double fonction d’administration et d’ambassade auprès des autochtones.
La traite joua un rôle important dans le financement des voyages d’exploration et même l’entretien des postes. D’autre part le roi octroie des concessions qui ont un monopole sur la traite d’un espace défini. Face à l’étendue considérable du Pays d’en haut la circulation des marchandises et des informations est essentielle (carte p. 217). La voie d’eau, malgré les nombreux portages est prépondérante suivant le canotage habituel des Amérindiens dans une vaste forêt sans chemin, une circulation lente et interrompue par l’hiver. Chaque poste mais aussi chaque mission est un maillon du pouvoir royal. Au XVIIIe siècle le pays est pris dans un réseau de postes qui contrôlent le territoire cherchant à regrouper les alliés pour garder un contact étroit et les protéger des attaques iroquoises, un réseau économique aussi lié à la trappe.
Une autorité évanescente : les Français en marge de la loi
Cette marge de la lointaine colonie est très loin du roi et de ses lois. Les coureurs de bois, entre 300 et 500 hommes dès les années 1670 inquiètent le pouvoir en tant que menace sociale, ils sont considérés comme des débauchés, souvent assimilés aux hors la loi parce que pratiquant la traite sans autorisation contrairement aux « voyageurs », fournisseurs d’alcool aux Amérindiens en dépit de l’ordonnance de 1679 ou commerçant avec les Anglais, aux déserteurs. Toutefois l’autorité royale a aussi des limites chez ceux-là même qui devraient l’appliquer. La corruption, la participation au commerce des fourrures ne sont pas rares parmi les agents de l’État. Le gouverneur Frontenac lui-même n’est pas uj exemple de vertu. Au XVIIIe siècle les militaires participent généralement à la traite en particulier ceux qui sont en poste au Pays d’en haut comme le montre une mission d’inspection en 1707. Commerce souvent indispensable à la survie des contingents des forts. Il n’y a pas de véritable contradiction entre servir le roi et se constituer une fortune, ce que l’auteur analyse à la suite de l’historien Jay Githin avec le clan Le Moyne et divers autres.
L’auteur aborde les dysfonctionnements de la « Pax Gallica » du fait des intérêts divergents des missionnaires, des militaires, des voyageurs , des marchands.
Onontio et ses enfants : alliance et logique d’empire
Définir le contenu de l’alliance franco-amérindienne n’est guère aisé. Elle est le résultat de l’empirisme diplomatique qui l’a construit petit à petit. Elle est fondée symboliquement sur la relation du père Onontio (le roi) et ses enfants, une relation qui n’est pas comprise de la même façon par les deux parties : d’un côté le modèle patriarcal monarchique qui suppose obéissance au père et soumission avec l’objectif de rendre les Amérindiens dépendants qui de leur côté ne voit pas l’autorité dans le rôle du père mais amour ce qui implique respect et redistribution aux enfants, deux conceptions sources de malentendus. Les Indiens voient aussi dans les Blancs des êtres surnaturels grâce aux armes à feu. L’auteur décrit les rituels de contact où les Amérindiens cherchent à profiter de ces pouvoirs par exemple de guérison qu’ils attribuent aux Jésuites. Au début du XVIIIe siècle ce statut suprahumain a disparu notamment du fait de la convoitise des « voyageurs ».
Faire vivre l’Alliance n’a donc rien de simple et nécessite des experts et des hommes ayant une maîtrise des langues locales, ils peuvent être amérindiens. Les « truchements » servent d’intermédiaires avec d’autres groupes pour nouer des relations antre chefs avec échange de cadeaux qui n’échappent pas à la volonté très louisquatorzienne d’éblouir les Amérindiens. Un bilan terme à terme des différences culturelles permet de mieux comprendre le contrôle incertain sur le Pays d’en haut malgré l’instrumentalisation des chefs indiens.
Les limites de l’empire
Si la coalition franco-amérindienne était une réelle puissance utilisée contre les Iroquois au XVIIe siècle, les Renards au XVIIIe siècle et même les Anglais, au début de la guerre de sept ans elle est devenue instable. L’auteur montre les limites à propos de la guerre contre les Iroquois durant laquelle les groupes indiens n’ont pas toujours répondu aux demandes françaises, de surcroît guerriers peu disciplinés. Il cherche à en analyser les causes qu’elles soient dans la conduite de la diplomatie française comme dans les habitudes de guerre des Amérindiens, les hauts et les bas de l’alliance sont aussi liés à l’influence anglaise qui attire les Indiens au marché d’Albany.
D’autre part des heurts existent entre groupes amérindiens que les Français tentent de démêler.
On assiste aussi à des vols, des pillages sur les « voyageurs » et à des violences consécutives à la consommation d’eau-de-vie, affaires d’autant plus difficiles à régler que deux conceptions de la justice s’opposent comme le montre plusieurs situations relatées. Pour illustrer la « Pax Gallica » l’auteur évoque en détail un incident du début du XVIIIe siècle1706-1708 : l’affaire du pesant » qui oppose les Hurons et Miamis aux Ouataouais et la guerre des Alliés contre les Sioux à l’Ouest alors que les Français mettent en avant l’opposition aux Iroquois.
Au XVIIIe siècle petit-a-petit l’alliance se défait lors du conflit avec les Renards.
Au-delà des réalités du quotidien de l’Alliance, la question de la souveraineté coloniale est posée puisque située entre deux conceptions : la diplomatie entre puissances européennes (droite de conquête) ou la relation franco-autochtones (protection des peuples amérindiens alliés). « Les Français le savaient : ils étaient dans l’Ouest des invités, et les rapports réels n’épousaient pas le rêve impérialiste » (p. 368).
Une culture régionale : échanges et métissages dans l’empire du milieu
Il ne s’agit pas de considérer que les contacts ont défini une culture commune régionale, les Français comme les Amérindiens conservent et réaffirment leur propre mode de vie mais par culture régionale l’auteur entend l’apparition de nouveaux comportements inédits. Les Français confrontés à la survie en territoire indien font une expérience nouvelle de l’espace et de la mobilité, connaissent un sentiment de « bout du monde », un monde indien : les voies de l’acculturation. Ils doivent s’acclimater à un univers sans pain ni sel, un climat rude, face à l’immensité spatiale la crainte de manquer de nourriture. Ils dépendent souvent des guides indiens, et de l’hospitalité des villages, situation paradoxales pour des Français supposés incarner la force. On peut ainsi parler d’une dette pour l’exploration du haut Mississipi mais dans le même temps les missionnaires cherchent à éviter la trop grande promiscuité entre soldats, coureurs de bois et villageois d’autant que les coureurs de bois étaient considérés comme des vagabonds et des gueux, l’auteur montre que ces épithètes étaient attribués en métropole au petit peuple et aux jeunes gens. Ici à ces défauts s’ajoutent l’oisiveté et le nomadisme par opposition aux vertueux agriculteurs. Les mœurs des coureurs de bois sont dénoncés, car elles sont impunies vu l’éloignement, ils représentent la transgression.
Pour ce qui est des Indiens, si les autorités rêvent de les accoutumer à vivre parmi les Français, de diffuser le modèle français et de les christianiser pour peupler la colonie selon un modèle assimilationniste imaginé par Cadillac pour Détroit, elles prennent consciencer des limites de la francisation même dans la vallée du Saint-Laurent. On peut parler au contraire d’une indianisation des coureurs de bois, le même goût de la chasse, de la mascarade proche du carnaval, le recours aux guérisseurs, l’adoption du tabac car les coureurs de bois issus des classes populaires sont, au final, plus proche des Amérindiens que des Seigneurs qui gouvernent la colonie au point qu’on parle de créolisation.
Mode de vie et culture matérielle
L’auteur décrit le mode de vie des Amérindiens et les modifications permises par les échanges : objets du quotidien manufacturés : haches, couteaux, chaudières (seaux, chaudrons) puis tissus de laine mais aussi fusils pour la chasse au gros gibier, fer et eau-de-vie avec des variantes selon les groupes et leur degré de proximité avec les Français.
Malgré ces emprunts les modes de vie et de subsistance n’évoluent guère et en particulier un semi-nomadisme avec grands rassemblements l’été. L’auteur décrit lers différences entre groupes notamment en matière de surexploitation des ressources.
L’adaptation des Français dans le Pays d’en haut a donné naissance à une forme de culture locale puisant au mode de vie amérindien ; se déplacer en canotles conduire mais aussi les confectionner, en raquette en hiver, se nourrir ; adaptation à la bouillie de maïs (sagamités), utilisation des graisses animales et viandes boucanées, se vêtir à la façon des Indiens, se loger lors des déplacements, se soigner.
Malgré tout quand cela est possible il y a la volonté de trouver des produits pour vivre à la française : sel, pain, vin, huile qui viennent souvent de France.
Sexualité et mariage : le pays du métissage
L’auteur aborde ici un sujet intime. Les métissages furent semble-t-il nombreux entre les jeunes aventuriers coureurs de bois et femmes amérindiennes , les Françaises dans le Pays d’en haut ne dépassent pas la quinzaine au début du XVIIIe siècle et elles ont suivi leur mari. Les relations sexuelles sont plus permises chez les Amérindiennes au grand dam des missionnaires. Les a-priori des sources françaises sont influencées par la répartition européenne des tâches alors que le statut social des Amérindiennes leur confère un rôle économique majeur et reconnu. Les métissages sont aussi à mettre en relation avec un sexe-ratio défavorable chez les Illinois par exemple. Les mariages mixtes sont vus, par Colbert notamment, comme un moyen de peupler la colonie et un ciment pour l’Alliance.
Au XVIIIe siècle des réticences se développent : fluctuation des unions, ensauvagement des Français, libertinage et concubinages dénoncés par l’Église malgré le verni de religion tenté par les Jésuites avec le baptême des enfants le plus souvent élevés par leur mère et considérés comme indiens par les deux communautés.
Après avoir traité de la rencontre des corps l’auteur aborde « Dans la grande manitounie » : la rencontre des univers spirituels. Ce sont deux mondes qui, se rencontrent l’univers saturé des cosmologies amérindiennes et la religion chrétienne. Dans cette région se sont les Jésuites qui sont les moteurs de l’évangélisation après une immersion culturelle pour apprendre la langue et l’utiliser dans la prédication, une pédagogie déjà testée dans la colonie laurentienne avec les Hurons. Ce sont ces attitudes à la recherche de « passerelles entre les deux cultures » (p. 485) qui sont décrites mais comment en mesurer les effets quand les baptêmes concernent souvent les morts en sursis (vieillards, enfants en très bas âge), succès critiqués par les Récollets qui jugent ces conversions peu sûres même si les Amérindiens confèrent aux religieux une certaine sacralité à respecter, dont il faut se méfier. Les prières adressées au « grand Manitou » sont sûrement de même nature que celles adressées aux esprits : succès à la guerre, à la chasse. « Le dieu chrétien semble appréhendé selon la règle qui préside traditionnellement aux rapports avec le surnaturel.» (p. 492).
Les oppositions et le rejet ne manquent pas surtout de la part des chamanes au nom du respect de la tradition : rôle des hommes et des femmes, médecine face au choc microbien de la rencontre avec les Blancs qu l’on retrouve dans certains récits recueillis au XIXe siècle.
D’autre part les sources religieuses voient dans le Pays d’en haut un lieu de perdition pour les Français qui pourtant sollicitent les missionnaires de passage pour une messe. Face au danger, à la mort les coureurs de bois sont sensibles aussi bien à la religion qu’au chamanisme.
Guerre, diplomatie et mimétisme
C’est dans le domaine de la guerre que l’adaptation aux règles et techniques indiennes (embuscades, guérilla, rituels avant le combat) est la plus nécessaire quand la « Pax Gallica » ne réussit guère et le conflit avec les Iroquois, avec les Anglais est quasi permanent. La guerre est très présente dans les sources religieuses comme civiles. La violence n’est pas si différente de celle de l’Europe. L’auteur aborde les pratiques de torture souvent pratiquées aussi par les Français et les rituels anthropophages des Amérindiens. Les Français influencent à leur tour la guerre indienne avec l’usage des armes à feu. Le sort des captifs semble évoluer, sans que l’on puisse en être sûr, vers une forme d’esclavage.
En matière de diplomatie le récit des rencontres montre des emprunts réciproques pour s’assurer un bon accueil, négocier une alliance alors que se rencontrent un monde de l’oralité et un monde de l’écriture.
Conclusion
L’auteur conclut sur un rêve d’empire loin de la réalité dans ce pays d’en haut où les Français sont les invités des Amérindiens. L’influence française est alors une forme de métissage qui débouche sur une culture régionale originale représentée symboliquement par la chaudière, le chaudron objet européen qui sert à cuisiner à l’indienne à pot commun. La région est ainsi définie par l’espace de circulation des produits français et de l’Alliance autour de postes qui assure la présence permanente des Français. Le Pays d’en haut est vu par Gilles Havard comme une chance pour le Nouvelle France.
Un livre dépaysant qui se lit avec plaisir.