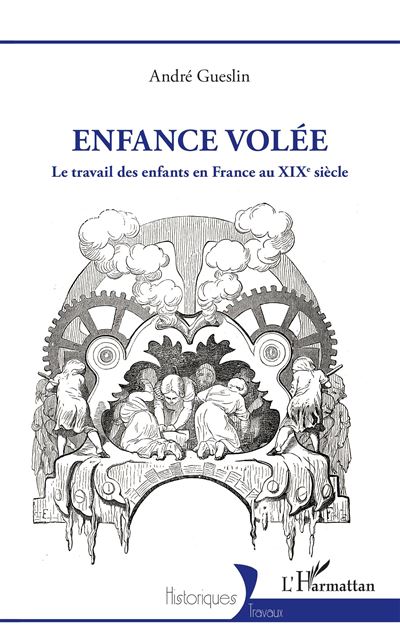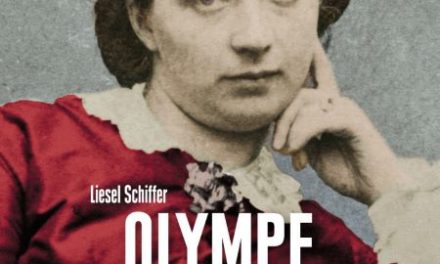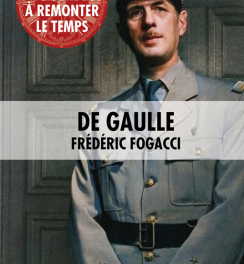André Gueslin fait partie des chercheurs les plus importants dans le domaine de l’histoire sociale. Professeur émérite d’histoire à l’université Paris -Cité, il s’est spécialisé dans l’histoire de la grande pauvreté. Parmi ses études les plus éminentes, on rappellera la publication de l’invention de l’économie sociale (1987), Les gens de rien – Une histoire de la grande pauvreté dans la France du XIXe siècle (2004) ou encore plus récemment D’ailleurs et de nulle part – Mendiants, vagabonds clochards, et SDF en France depuis Moyen-Age (2013) et Les peurs de l’argent en 2017. Depuis novembre 2022, il nous propose aux éditions de L’Harmattan une nouvelle étude intitulée : Enfance volée. Le travail des enfants en France au XIXe siècle. Bien que les travaux consacrés à l’enfance existent, André Gueslin s’appuyant sur les recherches de nombreux historiens comme Philippe Ariès par exemple, il vient combler ici une lacune sensible dans l’historiographie consacrée à la fois à l’enfance et à l’indigence, sur un sujet où les témoignages directs des premiers concernés sont extrêmement rares.
Divisée en neuf chapitres, l’étude débute au chapitre un aux origines du labeur enfantin et propose une approche du sujet à la fois économique et culturelle. André Gueslin retrace pour débuter, la place et le rôle de l’enfant dans la société. Les contraintes économiques ayant permis le développement du travail des plus jeunes sont connues depuis longtemps, à savoir la nécessité des familles pauvres de mettre leurs propres enfants au travail afin de compléter le budget et d’assurer la survie de la famille. Cet état de fait est compris par bon nombre d’observateurs à l’époque comme Louis Blanc et le philanthrope Charles Dupin qui l’analyse et le regrette. Mais les parents ne sont pas seuls responsables. En effet, la demande patronale en main-d’œuvre enfantine est également une des conditions expliquant ce travail : la finesse et la souplesse des doigts des enfants, et leur complémentarité avec le travail des adultes les rendent quasi incontournables dans la première moitié du XIXe siècle dans le contexte de l’industrialisation naissante.
Mais l’approche en termes culturels rappelle aussi une donnée fondamentale. Exception faite du très jeune enfant, emmaillotté, l’enfant n’acquière une identité propre qu’à partir de l’époque moderne (pensons à Jean-Jacques Rousseau qui propose une éducation idéale à travers Émile) et en commençant en premier lieu par les mondes aristocratiques et bourgeois qui, eux, n’ont pas besoin de mettre leurs propres enfants au travail. André Gueslin revient sur quelques facteurs ayant permis cette évolution au cours de ce chapitre : les sensibilités nouvelles qui s’affirment, mais aussi le développement des structures d’enseignement dont les collèges, au détriment de l’enseignement privé, à domicile. L’école publique se développe quant à elle au cours du XIXe siècle et permet de retirer : « certains enfants du peuple du monde du travail ». Les mentalités évoluent.
La question du travail des enfants
Le chapitre deux développe la question du travail des enfants et les secteurs qui les sollicitent. En tête de liste se trouve l’agriculture jusqu’au début du XXe siècle, mais aussi d’autre métiers comme celui de dentellières assuré par les petites filles principalement, notamment dans le département de la Haute-Loire première région dentellière en France au XIXe siècle. André Gueslin s’appuie ici sur les travaux de Geneviève Calle qui a analysé de près les dentellières dans son mémoire de maîtrise. Enfin, tout un panel de tâches artisanales sollicite également le travail des enfants comme le cas des coupeurs de poils sur les peaux (en particulier celles de lapins). La domesticité, activité déjà présente dès le haut Moyen Âge d’après diverses tous sources concordantes jusqu’aux jeunes bretonnes de la fin du XIXe siècle qui migraient vers Paris pour se mettre au service des familles bourgeoises. L’auteur ne manque pas de s’attarder et de s’appuyer sur des descriptions et des représentations bien connues des enfants travailleurs des lecteurs que l’on retrouve chez la comtesse de Ségur, George Sand (la Petite Fadette, 1849) ou encore Émile Guillaumin écrivain paysan auteur de La vie d’un simple publié en 1904.
Le chapitre trois prolonge le précédent en portant sur les mutations du travail enfantin de la proto industrialisation au seuil de l’industrialisation. En effet, au cours de la transition qui fait passer l’économie d’un système domestique à dominante agraire au système industriel, les formes d’organisation du travail se transforment tandis qu’eux en parallèle les structures éducatives destinées aux plus jeunes se développent. Malgré ces dernières, le travail des enfants résiste et se perpétue (les tisserands par exemple), pour aboutir à des journées de travail extrêmement longues et pénibles, le tout pour des salaires modiques voire même dérisoires pour les enfants, les jeunes ne gagnant couramment pas plus de 0,25 € par jour au début des années 1830 soient l’équivalent d’un peu plus 600 g de pain (page 85) alors que les conditions de travail sont insalubres comme l’attestent les diverses études publiées à l’époque.
Le chapitre suivant prolonge le propos en développant la question de la continuité du travail des enfants au cours du XIXe siècle industriel avec une approche spatio-temporelle et s’appuie sur la grande enquête de 1837, tandis que le chapitre cinq souligne la modicité des salaires coincés entre besoins des familles et logiques patronales. André Gueslin souligne ici parfaitement la double condition faite aux enfants : d’un côté la nécessité des familles de les mettre au travail afin d’assurer leur subsistance, mais de l’autre une médiocrité des revenus, démontrant une misère entretenue par ces niveaux de salaires. Mais les parents s’en contentent, ce salaire ne représentant qu’un complément familial. Cette situation ne manque pas d’interroger et de scandaliser les observateurs, peu dupes de la situation.
La violence à l’usine
De fait, et très logiquement, car la situation se pose à ce stade de la lecture, le chapitre six aborde la question de la violence à l’usine au XIXe siècle et de ses conséquences, tels que les accidents du travail. Le chapitre débute sur une observation réalisée par Louis Blanc en 1839 : « après avoir pris les fils du pauvre à quelques pas de leur berceau, on étouffe leur intelligence en même temps qu’on déprave leur cœur, en même temps qu’on détruit leur corps. Triple impiété ! Triple homicide ! (page 147). Cette remarque faite également dans d’autres termes par Engels ou encore le baron de Gérando qui n’hésite pas à y voir une certaine forme d’esclavage moderne. Mais André Gueslin ne sombre pas dans la dénonciation et un descriptif morbide, il établit les faits en s’appuyant factuellement sur le cadre et les conditions de travail, en particulier celui des mines au XIXe siècle. La démonstration ne manque pas de s’appuyer sur les représentations qui, certes, relèvent de la fiction mais aussi s’appuient sur une réalité documentée. Il s’agit bien entendu d’Émile Zola qui, pour rédiger Germinal, a procédé à des enquêtes minutieuses. Ce n’est dans sans doute pas un hasard si comme le rappelle l’auteur, la première personne que rencontre Étienne Lantier est justement le père Bonnemort qui lui explique être descendu dans la mine avant l’âge de huit ans. Autres auteurs invoqués : l’écrivain belge Camille Lemonnier ainsi qu’Alphonse Daudet et son roman Jack publié en 1876 que l’on redécouvre à l’occasion de ce chapitre. S’appuyant sur, entre autres les travaux de Michelle Perrot, l’auteur n’oublie pas non plus de revenir sur l’existence des violences sexuelles faites aux jeunes filles notamment dans le textile du Dauphiné sous le Second Empire. Pour autant les enfants subissent-ils ces formes d’asservissements modernes sans rien dire ? ce n’est pas le cas, et l’auteur expose le cas de certaines formes de rébellion allant de la pétition à la rébellion.
Le chapitre VII poursuit cette réflexion sur la violence au travers de ce chapitre intitulé : « enfants errants à la recherche d’un petit pécule ». En effet, outre le travail dans des structures clairement identifiées, d’autres moyens se présentent aux enfants afin de gagner d’argent. Parmi ses petits boulots en tous genres : distributeur d’imprimés, porteur de paquets, cireur de chaussure ou encore vendeur itinérant à l’image du héros de Sans famille publié par Hector Malo en 1878 : Rémi, loué par son père à un saltimbanque ambulant d’origine italienne, Vitalis. Mais, la violence n’est jamais loin avec notamment une dérive vers la prostitution et la mendicité instrumentalisée, pratiques fréquemment présentes non seulement dans des comptes-rendus officiels mais aussi dans la fiction : celle de Victor Hugo dans Les Misérables où il met en scène les enfants Thénardier en jeunes mendiants, mais aussi Eugène Sue avec son héroïne Fleur-de-Marie dans Les mystères de Paris publié à partir de 1842. Pourtant cette pratique ne constitue qu’une contribution très limitée à la vie matérielle de leur famille, signe que l’enfant n’a pas d’identité propre (page 185).
Ces violences faites aux enfants, largement commentée et décrite par les observateurs de l’époque, ce incitent peu à peu les législateurs à lancer l’offensive contre le travail des enfants. Ce thème est l’objet des chapitres huit et neuf. En effet, les abus engendrés par l’utilisation des enfants sont dénoncés tout au long du XIXe siècle par de nombreux auteurs mais aussi les philanthropes, et en premier lieu le docteur Louis-René Villermé mais aussi le baron Charles Dupin, et Jules Simon qui publie en 1867 un pamphlet intitulé L’ouvrier de huit ans. Le monde religieux n’est pas en reste, les chrétiens sensibilisés à la question sociale posent la question, certains comme un curé de la banlieue marseillaise dénonçant : « un véritable assassinat » (page 195). Frédéric Ozanam, le baron Joseph Marie de Gérando qui publie en 1824 Le visiteur du pauvre, Alban Villeneuve–Bargemont préfet du Nord sous la Restauration s’offusquent sans pour autant complètement condamner le travail des enfants, le travail étant malgré tout porteur de valeurs morales portées par le Christianisme. Parmi les milieux progressistes, Louis Blanc, Charles Fourier mais aussi Pierre-Joseph Proudhon dénoncent également cette exploitation tandis que les systèmes économiques qu’ils projettent excluent le principe- même du travail des enfants. Pourtant, un grand paradoxe est souligné, dans la mesure où le mouvement ouvrier a, en réalité peu remis en question ce dernier, ses priorités se situant certainement ailleurs. Une exception doit être soulignée avec le cas de Louise Michel qui, ayant exercé le métier d’institutrice, fait de l’abolition du travail des enfants une de ses préoccupations. À l’inverse, une bonne partie du patronat et des économistes ne le remettent pas en question. Pourtant, un certain nombre d’entre eux n’hésite pas à s’engager en faveur soit d’une législation protectrice telle que Honoré Antoine Frégier, Eugène Buret, ou encore Émile Bères qui souhaite limiter leur travail quotidien à 10 heures (!) en 1836. Mais les résistances aux réformes (page 213) sont tenaces de la part des patrons du textile et des mines. C’est ainsi qu’Amédée Burat, ingénieur des mines et géologue notoire, secrétaire du Comité des houillères françaises, rédige en 1868 un rapport sur la question. Il s’oppose point par point à une quelconque forme d’aménagement tout en soutenant que l’effort qui leur est demandé est proportionnel à leurs capacités et donc ne pouvait nuire à leur santé !
Les lois sur le travail des enfants
Le chapitre neuf s’ouvre sur une déclaration de l’industriel Oberkampf en 1797 qui déclare à ses ouvriers : « autrement que feriez-vous de vos enfants ? ». Néanmoins, le XIXe siècle est ponctué par le vote de lois qui viennent dans un premier temps limiter le travail des enfants puis l’interdire. C’est le cas avec la loi du 22 mars 1841 qui fixe par exemple un âge-plancher à 8 ans pour l’embauche, et une durée quotidienne du travail limitée à huit heures jusqu’à l’âge de 12 ans et à 12 heures au maximum jusqu’à l’âge de 16 ans. Des tournées d’inspection sont prévues afin de vérifier que la réglementation est bien suivie. Mais cette loi est un échec, le texte n’étant quasiment pas appliqué, le patronat y voyant une atteinte scandaleuse au principe libéral érigé en dogme selon lequel l’État n’a pas à s’insérer dans le fonctionnement interne d’une entreprise. Face à cela, diverses tentatives de remédier à la situation échouent. Néanmoins les mentalités évoluent. Le Second Empire est à l’origine de quelques initiatives censées réguler le travail et l’apprentissage des moins de 16 ans. Mais l’ensemble reste timide et les progrès sur le terrain rares. Il faut attendre la IIIe République et sa volonté de réformer en profondeur pour enfin fixer des règles et des interdictions durables avec la loi du 19 mai 1874 et celle du 2 novembre 1892 qui vise explicitement le travail des ouvrières, l’âge d’embauche étant désormais fixé à 13 ans âge correspondant à l’obligation scolaire. Cet effort législatif se fait parallèlement à celui qui rend l’école laïque, gratuite et obligatoire dans les années 1880, tandis que peu à peu les mentalités conservatrices finissent par céder du terrain.
D’une écriture fluide, l’étude d’André Gueslin est inspirante et ouvre de nombreuses voies de réflexions pour la recherche. Les démonstrations qui s’appuient sur des références nombreuses sont également susceptibles de fournir de nombreuses pistes au professeur. Elle leur permettra d’approfondir la question sociale abordée en classe de première sur un sujet qui ne laisse jamais insensible les élèves, … y compris les plus réfractaires au travail !